
Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Jeux de l’unique
Jeux de l’unique
Une école en Dordogne — II
,
Chaque jour une nouvelle vie, et cependant certains instants ont semblé s’étendre au-delà des journées, ainsi que des notes qui perduraient sous les sons qui changeaient, et ont semblé se propager, traverser toutes nos vies, presque les déployer.
A l’école en Dordogne, cet écran dans lequel je vivais n’était pas que la langue, crible d’étrangeté à jamais posé sur les choses et comme sur moi-même, et nous n’étions pas faits seulement de langage, tandis que je venais en effet d’un autre monde, celui des colonies, et que cet univers naissant de France et de Dordogne était pour moi à lui seul un pays.
Dans un étrange bonheur plutôt, à Périgueux, à Saint-Astier, je me coulais dans l’école, dans le plaisir des livres de tous côtés offerts, et comme dans l’écriture avec l’encre, la courbe des lettres formées, les buvards roses et les cahiers. Dans mes jeux et mes promenades sur les bords de l’Isle, revenaient des histoires que je commençais à lire, ainsi que des échos heureux de l’école et de la classe, et qui trônaient dans ce beau français imprimé que j’aimais. Y foisonnaient des pages de David Copperfield, ou de Michel Strogoff, ou d’une Vie d’Esope, ou encore les aventures d’une pauvre et abandonnée Eglantine. C’étaient des fascicules plutôt que des livres, des versions condensées ou simplifiées pour les enfants, avec de grandes illustrations, bien avant que j’accède aux beaux et plus épais volumes de la Bibliothèque Verte.
Mais dans ces heures heureuses, gorgées de vie immobile et de lecture, tous les récits déjà m’apparaissaient comme un monde tout proche et naturel, contemporain, émané de Dordogne, de France, des pourtours de Périgueux, de Saint-Astier, de l’école, des heures de lecture et des heures d’écriture, s’il y était mention cependant de montagnes, de forêts ou de ruelles boueuses d’une dédalique cité.
Et comme en ces dédales, je me souviens qu’un jour je suis perdu.
C’est incompréhensible, je suis dehors, devant la porte de l’école sur la place des marronniers, et cependant le sentiment demeure, puissant, terrible, indiciblement mien, comme la peur et l’écho, d’être perdu. Ainsi qu’en les vastes contrées des récits aimés, qui résonnent dans le vide de ma poitrine qui bat, je songe à des ruelles dangereuses et terribles, à des orphelins survivants, à des misères sans fin s’étendant jusqu’à moi depuis les mondes côtoyés d’un Oliver Twist ou d’une Petite Dorrit. Je suis perdu et n’ai personne à qui le dire. Je ne sais comment c’est arrivé. Mon visage se contracte, mes paupières se serrent, s’embuent.
Je me souviens de la grande salle dans laquelle je me trouvais, avec les autres enfants de mon âge. Je ne les connais pas et plusieurs classes ont été mélangées. Puis tous sont partis, leurs parents sont venus les chercher. Je suis resté le dernier et personne n’est venu pour moi. Alors je suis sorti moi aussi, j’ai attendu devant la porte de l’école. Et apparaît une très étrange unicité.
Je sais qu’il est midi, je le ressens dans les bruits et les odeurs de l’air, à travers les fenêtres ouvertes de l’école et les couloirs sonores. J’entends le choc des assiettes, des plats sur les tables, le crissement des chaises sur le carrelage. Le brouhaha des humains me semble un halo sombre, une touffe aveugle de l’autre côté des murs, à l’intérieur, hors de ma portée, et dont la vie lointaine, ignorante de moi, est posée cependant sur mes yeux et mes joues, comme une honte et une insurmontable rougeur.
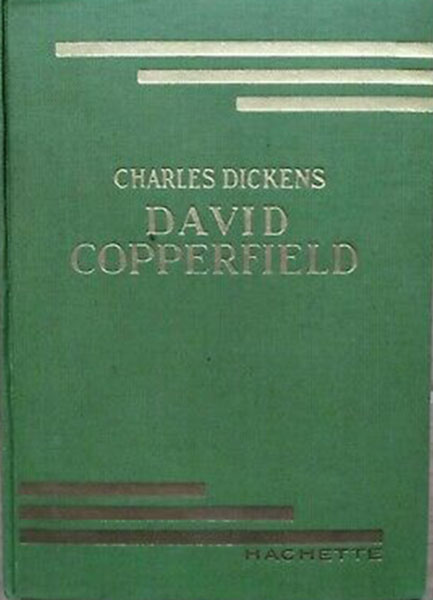
Puis une femme, grande et mince, au sourire doux, est venue me voir. Je ne la connais pas, ne sais si c’est une maîtresse, celle d’une autre classe ou bien d’une autre école. Elle me questionne, me sourit gentiment. Je comprends alors que mon père devait venir me chercher et qu’il n’est pas venu. Elle m’emmène avec elle, nous traversons des petites cours bordées de préaux et de plates-bandes fleuries. Il y a des voitures garées. Puis des couloirs encore, enfin des escaliers, et je la suis au long des salles et de vestibules où il n’y a personne. On dirait un grand silence ancien assemblé près de ma honte et de ma solitude neuve. Les couloirs ont des odeurs de cire, rassurantes et brusquement connues. Des tables sont rangées au fond des salles et les chaises sont empilées dessus. Puis naissent des sons et des voix. Le bruit des assiettes et des verres vient jusqu’à moi, m’emplit tandis que nous débouchons tous deux dans une salle animée et chaude où des adultes mangent. Les regards un instant se tournent vers moi, puis les adultes demeurent sur l’autre versant, dans le brouhaha sourd et vivant qui revient, qui avait été dehors cette touffe de leurs vies et des ombres tandis que j’attendais sur la rue. Ils continuent à manger, à parler et à rire. Certains ont allumé des cigarettes, et le trouble des fumées au-dessus entre dans le contre-jour des vitres opaques. La femme elle aussi a regagné une place à une table et m’a laissé, tout près, contre un mur, assis sur une chaise. Je regarde et me tais. C’est comme une classe d’adultes. Un crissement au sol, une chaise s’est déplacée. Je reconnais ma maîtresse dans la personne qui s’est levée et je me sens heureux, prêt à me précipiter vers elle, à entrer dans ses bras. Elle passe devant moi, me regarde, me sourit gentiment, mais je demeure assis sur la chaise. Des femmes en blouse claire débarrassent les tables, emportent les plats et les assiettes. Un groupe d’hommes s’anime. La fumée des cigarettes, fine, blanche et grise, flotte à présent au-dessus de toutes les tables dans l’odeur de tabac, s’étire, suspendue, s’effiloche, tisse ce monde aujourd’hui disparu et qui enveloppait les gestes des adultes, leur sorte de sérieux légitime et hors de ma portée. Dehors, brusquement, le jour s’est obscurci et le ciel s’est voilé, sombre tout à coup. Il me semble que c’est la nuit tout à coup et que je regarde les adultes s’exercer, dans la nuit, aux secrets qu’ils soumettent aux enfants dans le jour.
Puis la femme grande et mince revient vers moi. Les nuages dehors sont passés, et le jour resplendit à nouveau. Je me lève, je la suis. C’est un mystérieux passage dont elle détient le fil, et je suis seul, je n’ai que cette sûreté inespérée de la femme et des mères qui me guide, que cette marche folle dans les couloirs où elle semble sûre et très étonnamment pressée. Je traverse des pans insoupçonnés de l’école, sans les enfants et sans les classes, silencieux et vivants dans l’attente, et qui ne sont plus l’école ni un monde d’enfants, et ces pans ignorés de l’ombre habitaient dans l’école, m’avaient toujours vu, suivi, observé en silence. Je passe à présent dans le grand atelier, dans les rouages du monde, dont les trajets, les lieux et le très silencieux savoir se sont toujours posés en secret sur l’école.
Après des escaliers encore, avec une odeur brusque de pansements et de pharmacie, nous débouchons dehors. Je ne reconnais pas les lieux. L’école semble une cité entière, tout autant que la base militaire où nous habitons sur les hauteurs de Saint-Astier. Elle donne sur d’autres parties de la ville et du bourg, sur des passages inconnus du dehors et qui étaient cachés après les grandes salles de classe. Les heures ne passent plus, et le silence n’est plus interrompu par les sonneries des couloirs.
Je me trouve en bordure d’une cour goudronnée où il y a du monde, des garçons plus âgés que moi sont en train de jouer au ballon. La femme me laisse là, je la vois disparaître à l’angle du couloir comme une mère enfuie, et sa silhouette douce, flottante, demeure un instant dans le souffle de l’air et dans ma solitude.

Les garçons qui jouent au ballon portent des vêtements de toutes les couleurs, des chaussures de sport blanches et bleues, basses, qu’on appelait des « tennis ». Des insignes et des numéros flottent sur les maillots, comme l’orgueil de la force et de l’âge, comme les couleurs des différents pays sur les drapeaux ou sur les dessins auréolés des avions des images. Ils sont immenses et forts, à peine plus âgés que moi peut-être. Sur la cour qui s’assombrit lentement ils jouent et trônent dans cette France neuve de l’école et ce royaume d’aisance pour moi.
L’homme qui était avec eux, de l’autre côté de la cour goudronnée, souffle dans son sifflet ainsi que celui convoité d’un agent de police. Les garçons s’arrêtent, puis se remettent à courir. Et je comprends que je suis perdu, comme dans les ruelles boueuses et les plis sinueux des alentours de Londres de David Copperfield, je suis perdu, et ni personne ni mon père ne pourra retrouver où je suis.
Mais c’est aussi dans le plus beau malheur des histoires et de temps à venir, comme si c’était ma propre histoire enfin, et qui se déployait, unique, singulière, indiciblement personnelle et déjà générale cependant, universelle, écrite, et serait lue un jour chez les hommes. C’est une certitude brusque, sourde, inébranlable, pâle, amère et tranquille qui s’impose dans mon esprit d’enfant et s’étale, se dessine dans un bonheur très lumineux, dans la peur de posséder cette réelle et pauvre joie de se sentir unique, comme d’un triste sourire.
Il commence à pleuvoir. L’homme au sifflet traverse la cour et vient vers moi, puis me conduit sous le préau d’un autre côté de la cour. Et il me laisse là, disparaît lui aussi, m’abandonne. Alors je regarde les derniers garçons aux vêtements bariolés de couleurs et de chiffres qui s’en vont, quittent la cour. Il n’y a plus personne. Je reste seul, je respire l’humidité de la pluie qui frappe le goudron de la cour, où résonne un instant l’absence, le groupe des garçons qui jouaient et couraient. Je songe que tout le monde doit manger à cette heure et mes parents aussi. Je garde cette idée, elle enveloppe mon corps comme si elle était la matière de la pluie et du silence sur la cour. Il me semble y tomber. Je contemple l’absence devant, face à moi, je contemple ce rêve amer et beau cherché chez les hommes dans les histoires, cet arrêt vague et solitaire qui bat, se déploie dans le bruit lourd, doucement crépitant de la pluie sur le sol, semblant vivre d’une vie étrange, invisible et puissante, que nul ne connaît et où nul dans la solitude de l’école ne s’arrête. Ma poitrine se serre. Une crispation s’étend au-dessus de mes joues, gagne mes yeux, comme si j’allais pleurer, comme si je me voyais et que j’étais le seul, me disais que je suis perdu, et cette idée et les mots d’être perdu qui résonnent dans mon cerveau, et les histoires, et l’image des ruelles boueuses avec la fatigue et le froid des récits, et la crispation lente dont je sens la propagation forte et immense sur mon visage, font que j’allais pleurer. Mais je regarde. Je respire le silence et l’absence sous la pluie qui bat sur le goudron. J’ai tant erré ! J’éprouve la volupté inconnue d’un sourire figé dans mes joues. C’est étrange, comme si je devenais seul et me tenais en même temps à distance, et que c’est une même montée de la pluie dans l’air et d’auréole de toucher sur mon être.
Puis mon père apparaît. Je ne l’attendais plus et l’avais oublié, tout entier que j’étais à des émotions plus fortes de scènes de roman, de conscience et de troubles empruntés de lectures et de réalités mêlées, comme revenu d’autres pans du temps et de lieux abruptement surgis et écoulés aussi, situés non plus sur la cour dans la pluie mais dans mon être seul. Enfin le miracle des adultes est à nouveau rétabli, son monde opaque et retrouvé est si clair un instant. Mon père me prend la main, m’emmène. Je sens sa main si forte et si grande sur la mienne ! Nous retournons vers la maison, nous allons manger, le monde est à nouveau solide et sûr, avec ses heures réparties et posées, ses gestes revenus dans le grand cercle des personnes et de tous les trajets. Je me sens étrangement calme et heureux, comme si j’avais franchi toutes les ruelles, toutes les errances boueuses que je n’ai pas rencontrées, toutes les années que je n’ai pas encore vécues. Seule flotte un instant dans l’air une respiration entrevue, triste et large sous la pluie, puis elle disparaît de mon esprit, dans l’estompe d’un fin couloir qui se referme, et c’est comme si je regardais ma force, ma douleur et mon unicité, qu’elles me quittaient aussi.
Alors laissant au loin l’école, son préau solitaire, rentrant à la maison avec mon père, comme un acteur quittant la scène, toute sa vie remplie encore d’un rôle pleinement éprouvé, je sentais en même temps que la douleur, que la solitude et que l’unicité n’étaient pas si réelles, que je pourrais m’y consacrer un jour.
Frontispice : une ruelle à Périgueux.
