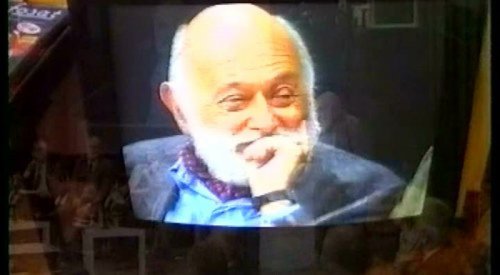Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Debord / Decept — II/V
Debord / Decept — II/V
Images, textes et dispositif de la conscience historique dans l’œuvre de Guy Debord
,
Deuxième partie : Parole, image, écriture : les formes d’un conflit
1. Corps, écriture et intériorité
« Être » une conscience, ou plus exactement inscrire sa pensée et ses actes dans le mouvement d’auto-engendrement qui caractérise le fonctionnement du dispositif de la conscience, implique de s’interroger sur le fonctionnement du langage et sur les limites que celui-ci impose à ce qui en est à la fois la source, l’instrument et le réceptacle, le corps. C’est le corps qui fait l’expérience du temps tel qu’il se manifeste dans et à travers la langue.
« La langue est bien un organe de perception, et pas seulement un moyen de communication Voilà le langage qui se déplace sur un axe synchronique, c’est-à-dire sans rapport avec le temps, vers l’espace du monde pour le décrire et le percevoir avec de plus en plus de précision. Mais le langage se déplace d’une autre façon, plus importante selon un axe diachronique, c’est-à-dire à travers le temps, et derrière nos expériences en se fondant sur la structure haptique de notre système nerveux pour créer des concepts abstraits dont le référent n’est pas observable, sinon dans un sens métaphorique ».
Le langage fonctionne comme un dispositif, et à ce titre il est, dans le jeu des inventions humaines, une médiation. Comme médiation, il accède à une sorte d’autonomie et peut ainsi devenir un obstacle au déploiement même de ce qui lui a donné naissance, l’être sentant et pensant.
Ce que montrent, chacun dans leur domaine, Julian Jaynes et Richard Broxton Onians est essentiel. Le langage prend sa source dans le corps. C’est à partir de « sensations premières », comme les mouvements du cœur, du diaphragme, de l’estomac, et finalement de l’ensemble des parties du corps par lesquelles des affects et des émotions se trahissent, que s’élabore le langage. Le langage permet de rendre compte de ce qui arrive au corps, mais aussi, de ce qui n’est pas identifiable immédiatement comme certains phénomènes dont la consistance matérielle n’est pas assurée mais qui affectent l’esprit sous la forme de voix sans corps émetteur ou de visions hallucinées, d’images sans support matériel.
Comme le note Clarisse Herrenschmidt, dans son livre Les trois écritures : « Le corps parlant gît dans l’alphabet complet, tel qu’il existe dans l’échange : si un sujet s’observe rarement parler dans un miroir, sans cesse il voit autrui qui parle, dont le visage fait les mouvements nécessaires à l’émission des sons. L’écriture grecque tendit à rendre visible le corps parlant social et chercha à capter la parole [...] en montrant son caractère commun d’une part, personnel et intérieur, de l’autre. Là réside son admirable caractère d’illusion efficace. Illusion qui consiste à écrire et lire de la parole. [...] Illusion, car nul n’écrit comme il parle. [...] Illusion qui fait croire que lecteur et scripteur se parlent et se voient, qui entretiennent l’idée de l’interlocution, par-delà les lieux et les temps. »
L’écriture conduit à penser son existence, non seulement en fonction de ce qui est directement transmis par les organes des sens au sujet de monde extérieur, y compris dans l’échange verbal, mais aussi en fonction de cette entité nouvelle, le signe, sans lequel, comme le note Clarisse Herrenschmidt, l’intériorité n’aurait jamais pu voir le jour.
« Le signe pour une consonne nécessite que scripteur et lecteur manipulent l’organe obscur, disent la machinerie interne et physique nécessaire au langage. Ce faisant ils évoquent le phénomène étrange et généralisé de la parole intérieure — celle que tout sujet se tient à lui-même, qui est à la fois parole et absence de parole, où le sujet est à la fois lui-même et un autre, où raison et déraison coexistent. »
2. Voix de l’excès
À l’autre bout de la chaîne du temps, la puissance de l’écriture se dilue dans le flot des images. Parler, écrire, ne sont plus des moyens permettant d’articuler les mondes de l’intériorité et les logiques qui gouvernent. La réalité se détermine en fonction d’entités d’un genre très ancien sous certains aspects et excessivement nouveau sous d’autres, les images. Le monde intérieur, la possibilité même de la pensée se trouvent déchirés entre les appels de l’expérience des sens et les jeux illusoires des images, illusion qui fait croire que le preneur d’images, photographe, vidéaste, et le spectateur, de ses propres images ou de la télévision, communiquent et se voient à travers l’espace et le temps.
Guy Debord a vécu ce changement comme l’instauration d’une falsification généralisée. Seuls le corps en tant que machine perceptive, la conscience en tant que dispositif et la langue en tant que vecteur de vérité, pouvaient participer à contrer cette entreprise qui par le truchement des images semblait viser à les annihiler. Eux seuls pouvaient permettre d’établir une sorte d’instrument de mesure complexe permettant d’enregistrer avec précision les effets et les enjeux de cette mutation.
Habiter son corps en vivant ses passions, en faire « la mesure de toutes choses » rend possible la distinction entre l’expérience pure du possible et la perception de la limite imposée par le fonctionnement social et permet de développer des perceptions et d’affiner leur précision. De telles perceptions peuvent servir de manière efficace pour mesurer les transformations que la société met en place, les limites par exemple qu’elle impose à la liberté ou les mensonges qu’elle profère pour assurer sa domination sur les corps.
Mais c’est l’excès qui permet de connaître les véritables limites que mettent en œuvre les différentes instances de contrôle qui prétendent gouverner les corps et les esprits.
L’énoncé de la loi qui gouverne de telles expériences, c’est William Blake dans ses proverbes de l’enfer qui l’a le mieux formulée et c’est Malcolm Lowry qui lui a conféré sa puissance d’impact maximale en en faisant le decipit de son roman, Au-dessous du volcan. À la dernière page en effet, alors que tout est achevé, on peut lire ceci : « You never know what is enough unless you know what is more than enough ».
Une telle expérience reconduit la parole à la dimension synchronique du langage la source même des métaphores. Qui se dote d’un pareil corps peut se sentir partout chez lui dans le monde. Cela lui impose aussi d’entretenir avec le langage une relation peu commune. Qui vit son corps comme un esquif plongé dans le Maelström du temps, ne peut pas se contenter de croire que ce qui est présenté comme vrai par les différentes autorités « est » vrai.
D’autre part, l’expérience du déplacement du langage sur un axe synchronique est bien plus que la source d’un doute dont la légitimité a été validée depuis des siècles comme le témoignage de la puissance de la pensée à reconnaître ce qui, en elle-même la trouble dans son effort à dire le vrai. Elle est la saisie du drame intime qui affecte chacun lorsqu’il comprend l’impuissance où se trouve une langue à rendre compte du mouvement même des êtres, des choses et des idées dans le temps.
En effet, les discours qui doivent tenter de dire la vérité de l’histoire dans l’histoire s’articulent sur une double disjonction. La première est celle du constat, violent, de la non-correspondance entre les mots et l’expérience vécue. La seconde est celle qui sépare dans le langage lui-même métaphores et notions abstraites.
Ce que révèle cette opposition entre processus d’invention mis en œuvre par la métaphorisation et processus de reconnaissance qu’impose l’existence de notions abstraites, c’est le double aspect du psychisme ou plus exactement la tension constante qui traverse le dispositif de la conscience entre la nécessité de narratiser et le besoin de reconnaissance.
Cette opposition conduit à des moments d’inversion dans l’ordre de la construction du sens à partir de la perception. L’histoire n’a cessé d’être le théâtre de tels renversements. Chaque époque connaît son lot de crises qui sont autant de moments d’adaptation du dispositif de la conscience à des à-coups entre les diverses aspects qui le composent, crises aux termes desquelles ce qui est inconnu peut finir ou non par être traduit en des métaphores susceptibles de rendre partageable une expérience nouvelle.
Ce renversement de la fonction fondamentale de l’expérience vécue comme moyen constitutif de la validité du langage et de sa puissance de vérité prend un nouveau visage avec le développement massif et rapide des nouvelles règles de comportements induites par la société marchande. Dans cette société se met en place un fonctionnement social qui transforme le fonctionnement du dispositif de la conscience La pensée ne se constituera plus sur la base d’expériences directes médiatisées par la langue, mais sur des expériences, toutes médiatisées par des images, l’expérience réelle se réduisant à celle d’être spectateur.
3. Les racines et les formes d’un conflit
En inventant l’écriture et en ayant ainsi permis le développement ratioïde de leur psychisme, les hommes ont créé une dérivation à la domination des signes et signaux auditifs et visuels avec lesquels jusqu’alors ils appréhendaient le monde et leurs actions.
Par le biais de l’écriture, certaines des forces installées au cœur même du psychisme ont donc trouvé un nouveau mode d’expression qui avait d’une part la puissance d’englober ou d’envelopper ceux qui le précédaient et d’autre part celle de permettre par un système fini de signes de rendre compte d’une infinité de phénomènes y compris des phénomènes non matériels. Sans l’écriture, ce que l’on nomme l’intériorité n’aurait jamais pu voir le jour.
On peut donner le nom d’image à l’ensemble des représentations figurales à travers lesquelles l’homme a traduit et matérialisé l’existence et les formes de l’altérité dont il percevait l’existence. On peut donner celui de texte aux productions de l’écriture, en tant qu’elles ont permis de rendre visible l’invisible porté par la voix. En matérialisant visuellement ce que l’homme savait déjà dire, l’écriture et les textes ont donné naissance à de nouvelles fonctions et à de nouveaux territoires dans le psychisme. Ces nouveaux territoires ont été et sont toujours l’enjeu de conflits incessants entre des forces souvent innommées mais qui trouvent dans la réalité des hérauts souvent puissamment armés pour les représenter.
L’image et le texte participent à la constitution des univers mentaux, culturels et matériels inventés et construits par les hommes. Ce qui caractérise chaque époque s’exprime souvent à travers la domination sur les formes de la connaissance et de la croyance de l’un ou l’autre de ces éléments. L’histoire des pratiques culturelles et politiques ressemble à un jeu de mains chaudes entre l’image et le texte. Si le texte a pris le pas sur l’image après la naissance de l’écriture, recouvrant les éclairs de ressemblance émis par les images de la sourde matité des signes écrits et des mots, l’image n’a jamais abandonné la lutte. Comme si un ressort la libérait parfois de sa posture, elle s’est souvent opposée à la domination de l’écrit, recouvrant de ses fastes colorés, le système d’inscription noir et blanc grâce auquel la raison et l’histoire ont dicté leur loi au monde.
Ce conflit est en quelque sorte sans fin, car il relève de la manière dont, pour le dire brutalement, dans le dispositif de la conscience, les constructions spatiales et synthétiques exprimées par l’image s’opposent aux constructions linéaires et analytiques, qui prennent appui sur le texte. Ce jeu se joue aussi bien dans le champ de la pensée, de l’histoire que de l’invention de mondes imaginaires.
Le XXe siècle a vu cependant leurs relations atteindre un niveau de violence que la culture européenne n’avait pas connu depuis des siècles. Champ de la manifestation et de l’expression des tensions et des conflits qui traversent la société, les pratiques artistiques ont capté avec précision et exprimé avec radicalité les enjeux qui s’y manifestaient, à ce moment-là de l’histoire. L’importance des enjeux a fait la grandeur de ces manifestations diverses qui pour l’essentiel se sont traduites par une exacerbation du conflit permanent qui voit s’opposer l’image et le texte. Il se trouve, cependant, qu’aux formes pour ainsi dire classiques de ce conflit, se sont ajoutées des formes absolument nouvelles. Elles sont dues à un phénomène dépassant de loin leurs jeux habituels, l’invention d’un nouveau genre d’image, que l’on appela photographie.
Que de fixe elle soit devenue mobile, d’unique elle soit devenue multiple et qu’elle puisse aujourd’hui grâce à des appareils toujours plus puissants saisir des moments de la réalité dans leur durée propre, cela a transformé l’image et plongé la société entière dans une mutation profonde. L’image est devenue infinie et plurielle. Elle est devenue fleuve. Le cinéma et la vidéo ont installé ce conflit ancien entre images et textes dans une actualité brûlante.
Les œuvres de Guy Debord convoquent toutes la violence des conflits qui accompagnent ce « new deal » auquel la société spectaculaire nous contraint. En effet, image, texte et parole ont été violemment séparés et déconnectés les uns des autres, et ont été lancés, chacun en fonction de ses qualités propres, à l’assaut de la forteresse du psychisme.
Il pourrait paraître inadéquat de parler de ces conflits, qui pour beaucoup eurent lieu dans le champ élargi de l’art comme d’une guerre. Pourtant, non seulement c’est ce qu’ils furent, mais les mots, les images et la parole sont encore et toujours, qu’on les considère seulement comme éléments culturels ou non, les vecteurs essentiels des processus de lutte, de reconnaissance et de domination qui agitent la planète.
De la querelle des images qui a ravagé l’Occident entre les Ve et VIIIe siècles, on sait qu’elle a éclaté à cause d’un mot, ou plutôt d’un suffixe (?) et ceci à cause de ce que, métaphoriquement, il impliquait comme phantasme autour de cette question cruciale sur les liens entre langue et intériorité, corps et expression, perception et compréhension. La querelle du « filioque » posait la question de savoir si l’on devait attribuer la possibilité de la domination et du contrôle du psychisme au verbe ou à l’image, aux textes ou aux images, au monde linéaire de la connaissance discursive ou au monde synthétique de la représentation plastique.
L’une des lignes majeures qui court à travers l’histoire occidentale est celle que gravent simultanément dans la chair de la pensée le scalpel des images et le stylet des mots. Cette ligne se signe par une déchirure radicale vers la fin du XIXe siècle après que l’invention de la photographie et des moyens de reproduction technique de masse ont envahi les pages des journaux. Chaque page de chaque journal témoigne aujourd’hui encore de l’acuité de ce conflit qui s’est traduit par une prise de pouvoir globale et sans appel des images sur les textes à l’aube du XXIe siècle.
4. Le mot sacrifié
Guy Debord a compris très tôt que les relations entre texte et image forment le nœud gordien de la pensée occidentale.
Dès ses premiers pas avec les Lettristes, il inscrit son combat dans la lignée de celui de Dada, plus encore que du Surréalisme. Il souligne ainsi sa dette envers ceux qui, les premiers révélèrent la forme du conflit qui allait emporter le monde. Ce conflit, cette déchirure, on les voit apparaître dans le journal que tient Hugo Ball entre 1915 et 1921 et en particulier dans les pages qui ont trait à l’époque du Cabaret Voltaire.
C’est sur la question du statut du mot et de l’image que porte la subversion la plus radicale mise en œuvre par le mouvement Dada. Témoignant d’une particulière acuité dans l’analyse de ce que lui et ses amis réalisent au Cabaret Voltaire, Hugo Ball note dans son journal les nouveaux aspects que prend le dispositif de la conscience dans ce siècle qui commence.
L’opération Dada est radicale. La guerre a montré que les mots avaient perdu leur puissance propre qui est d’aider les hommes à s’orienter dans l’existence en permettant d’articuler ce qui est et ce qui est vrai. Les artistes de Dada, eux, perçoivent autre chose. Ils comprennent que les mots eux-mêmes ont été dévitalisés.
À la une de tous les journaux, on rejouait la scène originelle de l’émergence de la duplicité. Sur la scène du Cabaret Voltaire, on répétait une autre scène, plus originelle encore mais qui n’avait jamais été jouée, dans laquelle les mots ne signifiaient plus rien. Seul valait le corps qui les rejette, le souffle qui les porte, le son qui les rend réels. Le phénomène constitutif de la conscience se trouvait éclairé sous un nouveau jour, le dispositif de la conscience se trouvait mis à nu. Il semblait en panne. Rien ne semblait pouvoir permettre de le réparer.
À l’époque de la grande boucherie des tranchées justifiées par tant de mots, Dada montra que tous les mots avaient perdu leur sève. Peau morte sur le fleuve de l’histoire, ils erraient en quête d’un sens et celui qu’on leur attribuait ne leur correspondrait plus jamais. Emportés par la vitesse des rotatives et écrasés sous la puissance des presses modernes, les mots non seulement devinrent aussi instables que les marchandises et les billets de banque, mais comme eux, ils se révélaient vides. Aucun sens ne les habitait plus.
« Le mot a été sacrifié ; il a vécu parmi nous. / Le mot est devenu une marchandise. / Le mot, il fallait le laisser debout. / Le mot a perdu toute dignité », écrivait Hugo Ball, dans son journal, le 16 juillet 1915, bien avant l’ouverture du Cabaret Voltaire.
Ce sacrifice du mot, par les puissances coordonnées du capital, des États occidentaux et des médias qui les servent, est sans aucun doute l’événement le plus important de ce début de siècle, celui qui entraîne tous les autres dans son sillage.
Lorsque le mot et son sens se disjoignent, lorsque la relation de nécessité a été « élevée » à la hauteur d’un amusement bourgeois et de là à celle d’un mensonge en train de se généraliser, lorsque les mots et le sens n’ont plus entre eux aucune relation, ce qui constitue l’essence même de la pensée, se brise. La conjonction de l’être et de l’étant portée par la langue est ruinée. S’ouvre alors dans le corps du pensable, dans la chair même de la langue, dans le dispositif qui les unit, un gouffre qui ressemble en tout à un Maelström.
Dada est le premier mouvement non seulement à l’identifier mais à lui faire face.
Cet événement concerne et atteint tout le monde et pourtant il reste dans l’ombre. Ne pas le voir est aisé, car il consiste en quelque chose qui, concernant la langue, est « sujet » à toutes les « appréciations subjectives », à tous les discours fallacieux, à toutes les dénis. La réduction des mots à un rôle de figurant dans une sorte de mascarade généralisée semble faire partie de la mascarade. Entée sur la reconnaissance du fait que la duplicité est inhérente à la langue, chacun s’autorise à se lancer dans une manipulation généralisée de l’ensemble des éléments porteurs de sens. Cette manipulation s’appuie, pour se mettre en œuvre, sur le statut nouveau des images ou plutôt sur les possibilités réelles qu’elles offrent de reconfigurer le réel comme la vérité.
Un tel événement ne pouvait cependant rester totalement inaperçu. Ce fut le rôle de Dada que d’élever la voix pour le dénoncer et combattre ce que promettait cette nouvelle donne.
Le 16 juin 1916, Hugo Ball écrivit ceci : « On veut transformer la trahison faite à l’homme. [...] Les pamphlets les plus sulfureux ne suffisent plus à noyer dans l’acide et dans le dédain toute cette hypocrisie ambiante ». Ce n’était au fond qu’un constat. Il fallait plonger dans le cœur du gouffre et le gouffre n’était rien d’autre que le mot et le mot était devenu une matière vidée de sa sève, de sa vie, de son sens.
Le 18 juin, Hugo Ball poursuit de la manière suivante : « Nous avons maintenant fait tellement évoluer la plasticité du mot qu’il sera difficile d’aller encore plus loin. Nous avons obtenu ce résultat au prix de l’abandon de la construction logique et rationnelle de la phrase et, par conséquent, nous avons aussi renoncé à une œuvre documentaire (uniquement envisageable par un regroupement de phrases respectant l’organisation logique de la syntaxe, ce qui prend du temps). [...] Nous avons chargé le mot de forces et d’énergies qui nous ont fait redécouvrir le sens évangélique du « verbe » (logique), qui est une image magique complexe. C’est en sacrifiant la phrase par amour du mot que le groupe autour de Marinetti a résolument instauré la « parole in libertà ». Ils ont détaché le mot du cadre de la phrase (la vision du monde), qui lui était attribué sans plus y réfléchir, presque automatiquement. [...] Nous autres nous avons fait un pas de plus. Nous avons essayé de donner au vocable isolé la plénitude d’une conjuration, l’incandescence d’un astre. Et curieux : le vocable, investi de magie, a invoqué et engendré une phrase nouvelle qui n’est plus conditionnée ni liée par aucun sens conventionnel ; suggérant mille idées à la fois, sans les nommer, cette phrase a fait résonner la nature irrationnelle originellement ludique, mais refoulée, de l’auditeur… »
L’enjeu était d’importance. En effet, si Dada appartient à l’histoire de l’art, l’effet Dada, lui appartient à l’histoire des révolutions.
5. Magie du mot, magie de l’image
Hugo Ball identifie, dès le début du siècle, le principe qui gouverne un monde où le mot et la phrase ont perdu leur puissance propre et dans lequel l’image et la magie ont commencé de prendre le pouvoir.
Dès lors que l’on abandonne ou sacrifie la puissance analytique et logique, rendue possible par un certain usage de la langue et de la raison, dès lors que l’on en finit avec cette croyance, on se retrouve dans un monde dont le fonctionnement relève à l’évidence d’une forme de magie. Lorsque l’équilibre entre mots et images dans le fonctionnement général de l’établissement du sens, c’est-à-dire des données partageables et communicables, a été renversé, les formes de la croyance changent. On découvre aussi qu’il est nécessaire de « croire » en la raison et en la vérité pour qu’elles existent. Mais dans un monde où le mot a été dévitalisé, la « puissance magique des images » peut imposer sa « logique » et s’introduire dans les mécanismes de constitution des nouvelles significations.
À l’époque du Cabaret Voltaire, Hugo Ball découvre qu’il existe une sorte d’équivalence entre le mot délivré de son lien ontologique avec le sens et un certain type d’image, relativement à leur puissance magique respective.
Ce que Dada apporte au XXe siècle, et qu’on ne lui pardonnera pas, c’est d’avoir à la fois analysé les liens entre mot et image, montré la dimension magique qui leur est propre, compris que les liens entre mots et images impliquaient une reconnaissance de l’existence du non ratioïde, et surtout compris que l’image était en train de prendre le dessus sur les mots en tant que moyen généralisé de prescription des comportements, en tant que nouveau « dieu » en quelque sorte.
6. Magie et affects
Pour Hugo Ball, le mot en tant que signifiant est un obstacle à l’émergence de ce qui en lui constitue sa puissance propre et qui trouve à s’exprimer à travers sa sonorité seule. Mais ce que Hugo Ball et les autres artistes Dada constatent aussi, c’est l’impuissance de la langue et des mots pour rendre compte de ces expériences liées aux affects qui constituent pourtant une part essentielle de l’expérience humaine et que le jeu réglé de la raison et du mensonge occulte aisément.
Dada est, dans les pratiques picturales de ses membres fondateurs, du côté de l’abstraction, c’est-à-dire du côté d’une remise en cause de la de la prégnance signifiante et symbolique de la représentation du réel comme modalité de la construction et de la transmission du sens. Mais l’enjeu est ailleurs. Il se situe dans le rôle respectif du mot et de l’image, dans la capacité propre à chacun de faire émerger cette forme particulière de puissance que Hugo Ball nomme magie.
D’un côté, il s’agit donc d’établir une distance avec l’ordre mortifère de la société, ordre qu’elle fait régner en utilisant mots et images en tant que vecteurs de signification et d’un autre côté, il s’agit de rendre compte de l’existence de ces forces sans maître qui innervent le vécu et ont été transmises par certains textes et certaines images.
Pour les artistes Dada, ce sont ces forces qu’il s’agit de libérer et de faire monter sur la scène du théâtre du monde.
Le 28 février 1917, il note que « L’ultime conséquence de l’individualisme, c’est la magie » et le 7 avril, que « La création artistique est un processus de conjuration dont l’effet est la magie ».
Hugo Ball nomme magie le phénomène qui apparaît là où se déchire la relation d’interdépendance entre textes et images, contenue dans le jeu infini des diffractions du sens. Au bord de cette déchirure, la soumission n’est plus de mise. La fiction d’un devenir basé sur la logique et l’histoire, s’estompe.
La magie commence donc là où, derrière les jeux idéologiques et artistiques déjà connus, se révèle la puissance de fascination propre aux mots et aux images. D’un côté, la perte de la puissance de la signification véhiculée par les mots ouvre la porte à la reconnaissance d’une puissance propre au son par la voix. Rythme et son deviennent des éléments vivants, et semblent parler la langue propre des affects. Mais ils se révèlent être aussi de réels vecteurs de fascination et cette puissance fonctionne elle aussi en deçà du sens.
La distinction entre les formes de la puissance magique respective du mot et de l’image n’est cependant pas encore tout à fait précise, comme en témoigne ce passage du 7 Mai 1917 : « Chercher l’image des images, l’image archétype. Serait-ce la symétrie pure ? Dieu comme géomètre éternel ? [...] Mais notre art, l’art abstrait, par exemple, procède-t-il ainsi ? Nos images ne sont-elles pas gratuites et vivent-elles d’autre chose que du souvenir d’autres images ? [...] Par le mot donc, pas par l’image. Uniquement ce qui est nommé est, et est doué d’essence. Le mot est l’abstraction de l’image et, par conséquent, l’abstrait serait tout de même absolu. Mais il y a des mots qui sont en même temps aussi des images. Dieu est représenté sous la forme du crucifié. Le mot s’est fait chair, image : et pourtant il est resté Dieu. »
Ce qui apparaît ici, c’est la ligne de fracture qui va traverser tout le XXe siècle et le long de laquelle vont se mener tant de combats.
Elle apparaît là où mots et images luttent désormais séparément pour le pouvoir. Le long de cette faille, deux croyances s’opposent, celle qui voit dans les mots la puissance même qui confère à l’existence sa dimension ontologique, et celle qui considère que ce sont les images qui capturent, retiennent et expriment l’essence des choses.
Et en effet, devenue photographie, l’image permet à un effet de croyance massif de se mettre en place qui s’oppose en tout point à la puissance ratioïde et narrative des mots. L’image photographique est perçue comme une saisie immédiate du réel et sa duplication. Or c’est là un effet de croyance que les artistes de Dada ont aisément repéré et auxquels ils se sont opposés en particulier à travers la pratique du collage. Ils avaient compris qu’une telle croyance se fonde sur cet autre axiome, à savoir que ce qui se montre sur une photographie le fait sur le mode du « reconnaissable ». Ce qui est donné dans l’image, ce qui constitue son contenu, est supposé, puisque partie de la réalité être toujours déjà connu. Mais l’image matérielle, qu’elle soit unique ou apparaisse à la une d’un journal a pour caractéristique d’être à portée de la main. C’est là ce qui, en tant qu’objet matériel, lui confère une part essentielle de sa « magie ».
7. Appréhender l’inconnu
Les Situationnistes ont remis en avant une chose essentielle, en montrant que le dispositif de la conscience n’est pas autre chose ni ne se trouve ailleurs que dans les actes de ceux qui le font exister. La conscience n’est en aucun cas une instance transcendantale orientée vers une fin par une voix extérieure de type divin, mais bien le processus même par lequel chacun s’autorise à aller au-devant de l’inconnu, pour l’appréhender, le connaître, le faire sien.
Cet inconnu n’est pas celui auquel les sciences sont confrontées. Il s’agit plutôt de comprendre quel rôle jouent dans la pensée et dans le dispositif de la conscience les médiations qui assurent l’interaction des hommes entre eux et par lesquelles l’inconnu est appréhendé. La parole, le texte et l’image constituent les formes essentielles de médiation.
La période qui va du début des années cinquante à la fondation de l’Internationale Situationniste a permis à Guy Debord d’expérimenter la puissance respective de ces deux « instances médiatrices » que constituent le texte et l’image. Les relations que texte et image entretiennent dans la pensée et dans le dispositif de la conscience semblent répondre, comme un écho à peine brouillé, à celles qui unissent et opposent les deux hémisphères du cerveau dans une approche bicamérale du psychisme humain. L’époque qui précède la naissance de la conscience et la forme du psychisme qui la caractérise n’ont cessé de hanter le dispositif de la conscience durant plus de trois millénaires. Certains aspects continuent d’exister en lui, en particulier à travers ce conflit, aussi constant que violent, qui oppose texte et image.
8. L’image en question
Dans chacune de ses œuvres, Guy Debord montre en quoi l’image et le texte sont à la fois antagonistes et complémentaires. Il ne les conçoit pas seulement comme des entités distinctes, mais comme des armes différentes. Le combat qu’il mène ne se passe pas seulement avec les mots et les images, ni entre les mots et les images, il passe aussi et surtout à travers eux.
Le Lettrisme est le laboratoire dans lequel le mot et l’image, le texte et le cinéma, ont été passés au crible d’une analyse minutieuse. Dada et le Surréalisme ont déjà mis à jour la double articulation du langage. Dada a déconstruit sa matérialité et a retrouvé sous la lettre la puissance du souffle. Le Surréalisme en a fait le vecteur de l’imaginaire ouvrant ainsi la porte à la métamorphose du réel. C’est précisément à la jonction de ces deux approches que Guy Debord va faire passer le scalpel de sa réflexion et construire son univers, en prenant en compte l’ambiguïté fondamentale du texte et de la parole, la duplicité qu’ils ont introduite dans le psychisme, et la magie propres aux images due à leur puissance de convoquer et de faire exister ce qui n’est pas au même titre que ce qui est.
La déconstruction pour ne pas dire la destruction de la matérialité de la langue et des mots eux-mêmes, conduit à comprendre le fonctionnement de la conscience comme « travail de la métaphore lexicale », selon la formule de Julian Jaynes.
Guy Debord va déplacer, ou plus exactement retourner ce mécanisme sur le fonctionnement même de la parole, des images et du texte pensés comme acteurs majeurs dans le dispositif de la conscience. Il va replier le travail de la métaphore sur ce moment antérieur à celui de l’écriture, celui de la parole vivante et de l’échange, celui de la pensée en train de se faire, de la parole vivante visant à produire des effets sur ceux auxquels elle s’adresse. Dans un second temps, il va faire en sorte que ce soit la puissance de la parole vivante qui agisse dans l’écriture même.
En ce qui concerne les images, il recourt à une autre stratégie. Le processus généralisé de destruction des relations entre les hommes qu’il nommera la société du spectacle, tend à rendre impossible l’existence de la parole vivante. L’élément central au cœur de ce processus de destruction, c’est l’image. Il ne s’agit en rien de dire que ce serait l’image en tant que telle qui serait coupable d’on ne sait quel méfait, mais bien de constater que, réquisitionnée par les propriétaires du monde, elle est devenue l’arme principale au moyen de laquelle ils assurent leur domination.
Hurlements en faveur de Sade est un geste profondément iconoclaste dans la lignée dadaïste révolutionnaire pour laquelle le collage, pratique artistique ayant permis de révéler la fonction des images dans la médiation de masse, fut transformée en arme politique. Détournements, textes découpés, collages, pellicule grattée, distorsion radicale entre son et image, rien ne fut oublié par les Lettristes et les Situationnistes pour combattre toutes les formes d’oppression dont l’image et le texte sont les vecteurs.
Le chapitre X des Commentaires sur la société du spectacle analyse avec précision le statut de l’image. L’image est une force qui s’oppose à la logique, entendons à l’élaboration et à l’expression de la pensée dans et par des discours fondés en raison. Puissance de fascination relayée par des appareils sophistiqués, l’image, fixe ou mobile, est l’élément majeur qui assure l’efficacité du processus de recouvrement du réel par son double faussement transcendantal et profondément matériel et que Guy Debord nomme le spectacle.
L’image, médiation par excellence est un élément qui s’offre à la contemplation. Unité synthétique d’un divers, elle ne l’ordonne pas selon la linéarité et l’ordre qu’impose l’écriture. Elle déploie le réel en fonction d’une « logique » purement spatiale qui impose au regard de saisir les éléments qui la composent en fonction d’un ordre réversible. Le temps propre à l’image est autre que le temps propre l’écriture et du texte, de même que la temporalité de la lecture de l’image est autre que celle qui est l’œuvre dans l’interprétation des textes.
9. Logique de l’image
La logique du texte est celle du dialogue et celle de la contradiction. Elle suppose la reconnaissance de l’autre et implique l’égalité des contradicteurs. La « logique » propre à l’image, comme Guy Debord le fait remarquer, tient en ceci « qu’à l’intérieur d’une même image, on peut juxtaposer sans contradiction n’importe quoi. »
Cette « logique » propre à l’image conditionne de manière directe la mise en place et le fonctionnement de la société spectaculaire.
« En saisissant un élément après l’autre, le regard errant à la surface de l’image instaure entre eux des rapports temporels. Il peut revenir à un élément de l’image qu’il a déjà vu et l’« avant » devient l’« après » : le temps reconstruit par le scanning est celui de l’éternel retour du même. [...] Cet espace-temps propre à l’image n’est autre que le monde de la magie – monde où tout se répète et où toute chose participe à un contexte de signification. » Outre cette dimension temporelle et magique, Vilém Flusser montre aussi que, médiatrices entre l’homme et le monde depuis toujours, les images en devenant techniques ne sont plus seulement des moyens permettant de s’orienter dans l’existence et constituant des sortes de cartes du réel offrant à la pensée des possibilités de se représenter le monde.
En effet, d’images faites de main d’homme, elles se sont muées, par l’invention de la photographie, en images techniques et ont ainsi acquis un nouveau statut. Elles ont acquis une puissance redoutable, en ce qu’elles sont devenues capables de transformer le monde.
Vilém Flusser note que « les images techniques omniprésentes autour de nous sont sur le point de restructurer magiquement notre « réalité » et de la transformer en un scénario planétaire d’images. Ici, il s’agit essentiellement d’un « oubli ». L’homme oublie que c’est lui qui a créé les images, afin de s’orienter grâce à elles dans le monde. Il n’est plus en mesure de les déchiffrer, il vit désormais en fonction de ses propres images : l’imagination s’est changée en hallucination. »
C’est ce moment précis de l’histoire dans lequel a vécu Guy Debord, ce moment où l’imagination s’est muée en hallucination. Cette mutation, il l’analyse avec précision avant même qu’elle ne soit devenue réalité. Il en suit le mouvement et décrit dans ses œuvres à mesure que l’événement se produit comment le spectacle recouvre la totalité du réel de son voile en tulle illusion.
La « disparition » des images dans le film Hurlements en faveur de Sade doit être comprise comme la présentation de cet « oubli », oubli qui est à la fois la pierre angulaire du psychisme et du fonctionnement de la société du spectacle et le « moyen » par lequel l’image, en prenant la place du texte dans le dispositif de la conscience, transforme celui-ci de l’intérieur.
Si, en effet la conscience est historique de part en part et si elle s’est constituée par le combat même que le psychisme humain a mené contre la dimension magique qui existait en lui, reliquat toujours vivant de son fonctionnement antérieur qu’elle tentait d’oublier mais ne pouvait effacer, sous les assauts de la société spectaculaire, elle se mue en une conscience d’un nouveau genre. Elle redevient soumise à des critères de type magique dans sa manière de comprendre le monde. Ceci est rendu possible dans la mesure où le processus de métaphorisation qui est au cœur du principe de déchiffrement du réel par la parole et l’écriture se trouve remplacé par un processus de recouvrement du réel. Le réel tend à coller à son « double » que constituent les images.
10. Image, temps, fascination
Représentation tri ou bidimensionnelle ou figure centrale du discours et vecteur essentiel de la formation de la pensée ratioïde, l’image a à voir avec la fascination et la magie, mais l’image comme représentation n’est pas un double de la métaphore. Si la métaphore, en synthétisant ce qui est encore mal connu dans une figure reconnaissable constitue, dans l’ordre du discours, une image, c’est à la fois d’une image mentale qu’il s’agit et d’un concept qui ne peut être activé que par la parole.
L’image matérielle, dessin, sculpture, peinture ou photographie, représente une chose qui peut être réelle à la manière d’un double ou d’une copie. Elle n’a pas besoin de la parole pour signifier et mettre en branle dans le psychisme un mécanisme plus ancien. Alors, elle était image non tant de quelque chose que l’incarnation d’une puissance, une manifestation divine ou le moyen de la faire advenir.
L’ambiguïté de l’image tient donc à ce double statut, même si sa fonction « divine » a été recouverte depuis longtemps par la fascination engendrée par l’activation de la fonction de reconnaissance dans le psychisme.
Le fait que l’image fascine a donc une triple racine. La première est son lien originaire avec la manière dont les dieux se manifestaient aux hommes. La seconde est qu’elle enferme le fonctionnement psychique autour de l’activité de reconnaissance et rend inutile le recours à l’explication logique et historique, c’est-à-dire au texte, comme vecteur de la compréhension des choses. La troisième est qu’elle assure sa légitimité comme élément permettant d’expliquer le monde grâce aux appareils qui servent aujourd’hui à la produire. Ce savoir-faire qui est celui des appareils et non de ceux qui les utilisent permet de qualifier sa réalisation de magique.
Si la métaphore le déploie et le replie sur lui-même, l’image, elle, creuse le temps. Présence troublante en ce qu’elle représente concrètement un objet absent, elle ouvre dans le temps une faille dans laquelle le réel s’engouffre. L’esprit y plonge s’il s’agissait alors pour lui de remonter vers la source du temps.
La métaphore, en repliant l’inconnu sur le connu, l’inscrit dans la logique du déploiement temporel des figures de la succession et des relations de cause à effets, fondements de toute pensée ratioïde.
« Signifiant par excellence de la synchronie », comme le remarque Giorgio Agamben, l’image, par la photographie, le cinéma et la vidéo, se trouve prise dans un processus de transformation qui ne concerne pas tant son « essence » ou l’« usage » que l’on fait d’elle que les différentes manières dont elle intervient dans les processus temporels.
Devenue photographie, l’image reproductible à l’infini, permet la constitution d’une sorte mémoire sans limites. La photographie ouvre au cœur même du dispositif de la conscience, un abîme sans fond, attracteur puissant dont l’effet est de l’ordre de la fascination.
Devenue mobile grâce au cinéma, l’image s’est trouvée confrontée à l’histoire. Deux nouveaux gestes, couper et coller, s’ajoutent à ceux de la prise de vue et permettent d’ordonner le déroulement des images en fonction d’une histoire et donc aussi de l’histoire. Mais ce n’est plus avec des mots, des idées et des concepts que l’histoire s’écrit dans le cinéma, c’est avec des rubans d’images.
Comme le fait remarquer Vilém Flusser, le film se déroule sur deux niveaux celui des images figées sur leur support et celui de l’image projetée, celui de l’histoire et celui de la contemplation à laquelle elle donne lieu. En marquant le cœur de l’histoire du cinéma d’une succession d’écrans blancs et noirs, Hurlements en faveur de Sade a révélé le double « secret » du cinéma. Dispositif par lequel il devient possible de donner à voir une histoire qui n’est donc pas écrite par des mots mais par des plans, il permet d’agir directement sur l’histoire aux deux sens du terme en instaurant une forme de temporalité qui semble coller à celle du vécu. Cette ressemblance phénoménale permet que l’on tienne pour vrai ce qui est montré puisque c’est, malgré tout une sorte d’expérience « réelle », incluant perception et réflexion.
Guy Debord a montré avec son premier film que ce glissement est constitutif de la part d’oubli qui assure aux images mobiles la puissance même des dieux, autrement dit celle de tenir un discours efficace, d’autant plus efficace qu’il inclut la diachronie dans la dimension synchronique de l’image fixe.
L’image vidéo s’offre à des manipulations d’un nouveau genre. Outre son accessibilité due au performances des appareils qui permettent de les réaliser, les images vidéo offrent à chacun la possibilité de se présenter lui-même et de se voir à travers le médium qui lui tient lieu désormais de miroir inversé de son intimité.
« L’opérateur vidéo manipule la linéarité du temps. Il peut synchroniser la diachronie. Toute bande peut être réutilisée pour synthétiser des époques différentes sur la même surface. [...] L’opérateur synchronise des scènes : il fait des superpositions. [...] L’opérateur opère sur la ligne des événements. [...] La matière première de l’opérateur est l’histoire au sens strict : la ligne des scènes. Il n’agit donc pas dans l’histoire seulement, mais aussi sur l’histoire. Dans ce sens, son geste est post-historique. Son intérêt n’est pas seulement de chanter l’événement (engagement historique) mais aussi de composer différents événements (engagement post-historique). » Ces remarques de Vilém Flusser nous permettent de prendre la mesure de la mutation du statut et de la fonction des images consécutive à la mutation des appareils qui les créent.
Ce moment de mutation et de rupture radicale dans l’histoire des hommes que Vilém Flusser nomme post-histoire est celui que les Situationnistes ont été les premiers à comprendre. Si nombre d’analyses pointent l’existence d’un moment de crise qui devient manifeste avec les événements mondiaux qui agitent le globe entre 1967 et 1969 en particulier, nombreux sont aussi ceux qui ne voient dans cette crise que le signe d’un changement historique. Les Situationnistes sont les seuls à comprendre que ce moment de rupture dans le déploiement de l’histoire suppose et implique une mutation du dispositif même de la conscience car ils sont les seuls à reconnaître que le devenir de l’histoire ne peut pas être séparé du devenir du dispositif de la conscience.
11. Écriture et événement
L’écriture est l’invention qui a permis aux hommes d’échapper à la fascination induite par les différents modes de manifestation de la puissance des dieux. L’écriture a aussi rendu possible la mise en place des dispositifs par lesquels les hommes ont pu accéder aux connaissances dont ils disposent aujourd’hui.
Le problème auquel chaque texte se confronte, c’est celui de la transformation de la parole vivante qui le porte et dont il constituera une forme d’accomplissement. La littérature cherche à rendre présent un « corps » à travers les mots. La métaphore y fonctionne à la fois comme principe et comme moyen d’engendrement du sens.
Ces questions, Guy Debord les aura affrontées dans ses livres et les textes qu’il écrit pour ses films. Chacun de ses textes participe de cette stratégie qui assure à cette immédiateté de la parole vivante la possibilité de son accomplissement dans le texte.
Écrire, pour Guy Debord consiste à prendre acte de la distance qui sépare l’écriture de l’événement et à faire du texte le lieu où le sens de l’événement devient manifeste. Son écriture se déploie à rebours de la plupart des expériences littéraires de son temps.
Ce qu’il cherche à transmettre ne peut pas être l’événement lui-même, par essence fugitif. L’événement s’efface avec l’instant qui le porte et reste intransmissible en tant que tel. Ce n’est pas non plus la dimension subjective associée à l’événement, tout aussi fugitive et en tant que telle insignifiante, mais bien le sens de cet événement pour et dans l’histoire qui peut se mesurer à sont impact pour et dans le dispositif de la conscience. On peut remarquer qu’il existe deux grands types d’écriture chez Guy Debord. La première est une écriture opérationnelle. Elle sert d’arme et permet d’agir sur et dans le cours même de l’histoire. La seconde est une écriture mémorielle. Elle a pour fonction de réaliser selon l’expression de Paul Ricœur « l’Aufhebung de l’événement dans le sens ». Elle permet de constituer des traces fiables, peut-être même infalsifiables, qui assureront à d’autres la lisibilité de l’événement ou des événements qu’elle évoque.
Ces deux écritures, il les a pratiquées selon les enjeux et les nécessités de l’époque. L’écriture opérationnelle a plutôt dominé la première moitié de sa vie. L’écriture mémorielle, elle a plutôt occupé la seconde moitié de sa vie. Toutes les deux, cependant, visent à faire en sorte que le texte reste au plus près de la parole vivante dont elles procèdent, afin qu’ainsi il puisse atteindre la puissance d’une « parole oraculaire ».
La puissance de vérité des textes de Guy Debord vient avant tout du fait que tous participent du combat qu’il mène contre la société spectaculaire. Ce combat porte sur la véracité des traces et il a pour enjeu la vérité de l’histoire. Il vise à démontrer que la société du spectacle est une société totalitaire.
C’est pourquoi Guy Debord, qui aura connu, très jeune, les potentialités imaginales auxquelles pouvaient conduire l’explosion des mots et la destruction des images, écrira une langue dont on peut dire qu’elle n’use pas des métaphores comme on le fait dans la littérature. De la même manière il fera un cinéma qui, en ayant recours pour l’essentiel au montage d’images telles qu’elles se donnent à voir sur les écrans de l’histoire du cinéma et de l’aliénation, dénonce la prolifération des images et leur adjoignant précisément des textes dont la puissance d’évocation n’a d’égal que leur précision clinique.
S’il y a un style de Guy Debord, il est tout entier le résultat de cette stratégie établie en vue de la transmission de l’événement par l’écriture et le cinéma et qui, seule, fait de l’œuvre, livre ou film, un événement.
Deux types de choses font événement pour Guy Debord, ce qui dans l’histoire conduit à des transformations réelles de la société et les actions menées par ceux qui s’opposent à ces transformations.
Le devenir totalitaire de la société du spectacle est l’événement majeur de cette époque. Il se décline sur plusieurs strates.
Les combats de ceux qui cherchent à vivre libres et décident pour cela de s’opposer à ce et ceux qui les oppriment, constituent le second événement.
Ils ne sont pas si nombreux à faire événement. La réalité de leurs actes prime. Guy Debord va s’atteler à la tâche de leur donner une nouvelle dimension par l’écriture. Il n’utilise pas la métaphore pour inventer un événement inexistant mais bien pour révéler la portée d’un événement souvent resté inaperçu. L’usage qu’il fait de la métaphore consiste à retourner les formes du présent sur certains signes du passé. Il renvoie ce qui est manifeste quoique non interprété à ce qui dans le passé annonçait déjà ce qui s’est réellement réalisé. Cette manière de replier le temps sur lui-même permet de conférer à un événement resté inaperçu sa véritable puissance de déflagration. Ainsi, la dimension mémorielle est élevée à la hauteur du sens. La parole vivante a gardé sa puissance dans la mesure où le processus de métaphorisation a visé à l’efficacité par le sens et plutôt qu’à la multiplication d’images insignifiantes. Si l’écriture de Guy Debord est aussi poétique, c’est parce qu’elle se déploie à partir de cette source-là.
La puissance de déflagration de la métaphore se voit augmentée dès lors que l’événement qui se produit dans la réalité est mis en parallèle avec ses effets sur le dispositif de la conscience. En prenant en compte ce dispositif, l’écriture de Guy Debord donne à l’apparente irréalité des mots la force d’une arme.
L’une, l’histoire n’est pas le reflet de l’autre, la conscience. Chacune est à l’autre son envers puis son endroit. C’est la connaissance de cette réversibilité qui a permis à Guy Debord de mener ses combats avec tant de précision. Le dispositif de la conscience ayant été forgé par la langue, la langue constitue la réalité de son existence, et c’est pourquoi la langue trouve dans le dispositif de la conscience la possibilité de devenir une arme, qui plus est efficace, dans un combat sans merci contre la puissance apparemment infinie des images.