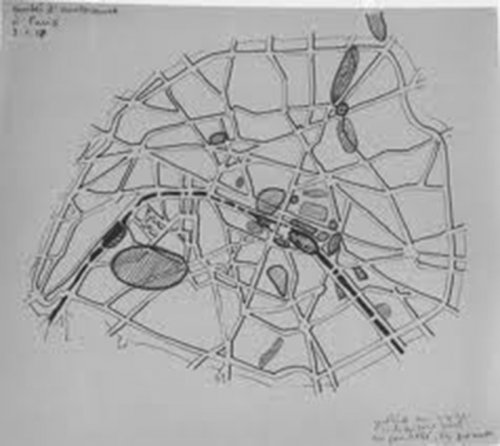Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Debord / Decept — I/V
Debord / Decept — I/V
Images, texte et dispositif de la conscience historique dans l’œuvre de Guy Debord
,
Écrites il y a plus de dix ans, bien avant que ne sonne l’heure vaine d’une commémoration nécessairement indigente, ces pages sont une tentative de mise au point sur la question centrale du statut de la conscience historique. Il apparaissait hier, et aujourd’hui encore, que la figure de Debord, l’auteur et le cinéaste en particulier, en dévoilait des contours rarement vus. C’est à préciser ces contours que s’ingénie ce texte. Il sera publié in extenso, partes extra partes, au cours des prochains mois.
Première partie : Le dispositif de la conscience
1. Lire
Pour qui prend le temps de les lire et de les regarder, les œuvres de Guy Debord constituent un moyen efficace permettant de s’orienter dans le chaos engendré par la crise matérielle et mentale ouverte par la domination planétaire de l’argent, du mépris, des appareils et des gens de toutes sortes et d’un aveuglement généralisé, qu’on nommait autrefois la bêtise.
Il n’y a pas de mystère Debord, bien plutôt un mystère concernant le mouvement général qui conduit l’humanité à se laisser piéger dans les filets d’un mensonge devenu absolu et à tendre ses mains à toutes les polices du monde dans un sublime accès de renoncement à elle-même. De volontaire, la servitude est devenue complice et ce qui ne cesse d’étonner, c’est que cela ne semble plus guère étonner personne. Ceux qui encore questionnent et rechignent, ne semblent guère plus à même que ceux qu’ils n’osent défier, de pouvoir énoncer, dans une langue qui en effet se perd, quelques préceptes permettant de se forger des armes pour un combat qui s’annonce pourtant mortel.
Les lignes de front se sont multipliées, fractales incessantes. Une ligne de faille lisible indique la direction générale du mouvement de la soumission et de la destruction. C’est de sa connaissance que se peuvent tirer les règles pour une direction des combats, autant dire pour une direction de l’esprit.
2. Le centre et la fêlure
Bien plus que de modèle, l’œuvre de Guy Debord peut servir d’exemple et d’incitation. Chacune de ses œuvres, texte, film ou livre, sa vie même, constitue une incise dans le voile de nos renoncements aveugles. Nom profane d’une forme de croyance plus insidieuse, profonde et ruineuse que toutes celles qui existèrent jusqu’ici, la conscience surnage, frêle esquif qu’emporte un courant sans appel vers des gouffres amers.
« Cela peut paraître étrange, mais alors quand nous fûmes dans la gueule même de l’abîme, je me sentis plus de sang-froid que quand nous en approchions. Ayant fait mon deuil de toute espérance, je fus délivré d’une grande partie de cette terreur qui m’avait d’abord écrasé. »
Au cœur du Maelström règne une sorte de calme impensable, dit-on. Approcher du centre, yeux grand ouverts, c’est faire une expérience qui bouleverse le fonctionnement du psychisme. La terreur face à l’inéluctable se mue en fascination ou se transforme en connaissance. Guy Debord en s’avançant jusqu’au centre du temps, cet œil du néant autour duquel tout s’enroule et brille un instant avant de disparaître, a montré que, pour affronter l’impensable, la condition est de penser autrement, ce qui signifie non pas d’avoir de nouvelles idées mais d’inventer une nouvelle manière de penser (Robert Musil).
Au cœur du Maelström, les polarités s’inversent. Une extrême tension affective porte à une extrême tension intellectuelle. Dans les parages du centre du temps, le fonctionnement de l’esprit se révèle, les mécanismes du dispositif de la conscience sont mis à nu, ses blocages, ses potentialités. Il apparaît divisé, traversé par deux forces contradictoires, deux tendances antagonistes.
Au début de La fêlure, nouvelle émise du cœur du cyclone, F.S. Fitzgerald écrit : « Avant de commencer cette histoire je voudrais faire une observation d’ordre général — la marque d’une intelligence de premier plan est qu’elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. »
Voyous, voyelles, lettristes, situationnistes, et tant d’autres, ont appris à tenir la peur pour rien en regardant en face ce qui, ailleurs, terrorise ou fascine. Tension de l’esprit, renversement des polarités, métamorphose des critères de la pensée par la négation des conditions généralement habituelles de l’existence, voilà comment, rompant le cours sans histoire de la vie quotidienne, ils ont mis à jour la fêlure au cœur de ce monde et montré qu’il courrait à sa perte, emportant tout et tous avec lui dans sa débâcle.
Saisis par ce puissant attracteur, ils ont été « marqués au front du signe de l’automne ».
3. La connaissance par les gouffres
Toujours dans Une descente dans le Maelström, Edgar Poe note la chose suivante : « J’ai décrit la curiosité surnaturelle qui s’était substituée à mes primitives terreurs. Il me sembla qu’elle augmentait à mesure que je me rapprochais de mon épouvantable destinée. Je commençai alors à épier avec un étrange intérêt les nombreux objets qui flottaient en notre compagnie. Il fallait que j’eusse le délire, — car je trouvais même une sorte d’amusement à calculer les vitesses relatives de leur descente vers le tourbillon d’écume. [...] Je fis aussi trois observations importantes : la première, que, — règle générale — plus les corps étaient gros, plus leur descente était rapide ; — la seconde, que, deux masses étant données, d’une égale étendue, l’une sphérique et l’autre de n’importe quelle autre forme, la supériorité de vitesse dans la descente était pour la sphère ; — la troisième, — que, de deux masses d’un volume égal, l’une cylindrique et l’autre de n’importe quelle autre forme, le cylindre était absorbé le plus lentement. »
Les connaissances acquises par Guy Debord relativement à la vitesse de disparition des corps pris dans le Maelström du temps, ont été d’une remarquable précision.
Il a vu se désintégrer des individus dans des batailles diverses, il a vu des corps arrimés à leurs passions plonger et parfois ressortir du fleuve et poursuivre, pour un temps encore, leur chemin aventureux. Il a vu disparaître des modes de vie et ce que ne semblaient pas percevoir la plupart de ses contemporains, il a analysé comment une civilisation courait vers l’abîme.
Il a mesuré dans la chair même de l’existence la différence entre la croyance générale en une sorte d’éternité de cette civilisation et les à-coups des refus, les chocs des révoltes collectives ou individuelles, les sursauts contre le renoncement qui la traversaient. Il a analysé avec précision les mécanismes à l’œuvre dans cette situation. Ces mécanismes relèvent tous de l’expérience intime du temps. Mais s’il existe un moment terrible dans la confrontation directe avec le Maelström, ce gouffre qui engloutit tout en un instant, ce moment du face à face avec l’œil du néant se distingue pourtant de la confrontation avec l’effacement de tout par le fleuve de l’histoire et ses vagues successives.
Ceux qui s’y trouvent bien ne peuvent désirer qu’elle disparaisse. Ils ne peuvent donc voir ce qui arrive réellement. Cet aveuglement est lié à une forme d’inconscience. Sa caractéristique principale tient en l’énormité de l’enjeu qui, rendant incroyable l’idée d’une telle disparition, rend impossible le fait même de l’envisager, fut-ce à titre d’hypothèse.
Pourtant, rien, aucun dieu, personne ne viendra sauver cette civilisation devenue planétaire et qui conduit l’humanité à sa perte.
4. Discontinuité du temps
La connaissance par les gouffres permet seule de remettre en question cette évidence partagée par tous, la croyance en la justesse de la métaphore de la flèche du temps.
Peu de choses dans le temps vécu correspondent à cette idée d’une direction univoque du temps associée à un écoulement continu. Que le passage du temps conduise à la mort des individus ou à l’effacement de tout ce qui a pu être, nature, époque de l’histoire, civilisation, cela ne lui confère en rien une direction et un sens unique.
La métaphore parle d’autre chose. La flèche du temps est la ligne imaginaire par laquelle on associe l’idée de la disparition de tout à l’imprévisible et impensable moment de la mort individuelle. Rapporté à la mesure de la vie humaine, il est vrai que la réalité de la disparition d’une civilisation peut ne pas être perceptible. Cette flèche est constituée par un double geste, de négation de la discontinuité effective des moments de la vie, qui induit à une représentation de la vie comme chaos, et de synthèse des moments discontinus en fonction d’une orientation globale, finalité existentielle ou télos général vers lequel s’avancerait, unie, l’humanité.
Guy Debord a porté une attention particulière à la puissance affective mise en branle par la discontinuité des moments du vécu. Il a vu dans chaque moment de suspens entre deux intensités une manifestation directe de la puissance de la négation incarnée par le gouffre du temps. Croire en la nécessité d’orienter ces moments en fonction d’un but ne devant pas les sauver de la disparition, il fit donc un axiome de ce constat : il n’y a rien à sauver puisque tout va disparaître.

5. La flèche et le pli
Par contre, il y avait tout à faire pour réduire l’écart entre chaque suspens, entre chaque interruption, pour passer le plus directement et le plus rapidement possible d’une intensité vécue, c’est-à-dire d’une situation, à une autre.
Répétée inlassablement, cette opération impliquait de faire du bord de chacun des moments vécus le point originaire d’un nouveau moment. L’anticipation de la destruction de tout abolissait la peur. Cette approche du temps à partir du vécu individuel comme vecteur et mesure de la discontinuité originaire du temps a eu un effet en partie imprévisible. Replié sur lui-même, le temps vécu dégageait un angle de vue inédit sur le temps global et rendait possible l’observation d’un phénomène plus important.
En rapprochant les extrémités des moments vécus, ces plis ont permis de concevoir un pli affectant le temps historique et permettant d’établir des correspondances entre figures de la fin et réalité des commencements.
Il ne s’agissait pas là d’une figure de rhétorique, mais bien de la possibilité d’établir un parallélisme entre différents aspects du temps et d’effectuer des mesures et des comparaisons importantes. L’une, en particulier, montre que c’est au moment où une époque commence à sombrer, où ses fondements commencent à s’effacer du champ du pensable et du croyable disponible, qu’il devient possible d’appréhender son histoire selon une nouvelle perspective.
La flèche du temps évoque le fait que tout ce qui est né et vit est appelé à mourir. Elle n’indique en rien le fait que l’histoire se déploie dans une direction. L’histoire et avec elle l’humanité ne sont pas aimantées par un attracteur qui leur serait extérieur.
L’idée d’une direction dans laquelle avancerait l’histoire se révèle être l’énoncé fantasmatique de ceux qui prétendent la conduire, souhaitent faire croire qu’ils savent quel est son but, établissent cela comme une vérité et tentent pas tous les moyens à leur disposition de faire en sorte que l’humanité accepte sans protester de se laisser guider par eux.
Le seul fait de s’opposer à ce diktat prouve que cette flèche n’est rien moins qu’une girouette dont l’orientation dépend des mains qui la tiennent et des bouches qui soufflent le vent sur elle.
Percevoir l’écart qui sépare les énoncés sur le sens unique de l’histoire des soubresauts qui la secouent en tous sens, la perspective du salut de l’état général dans lequel se trouve l’humanité permet aussi de s’interroger sur les moments d’une genèse occultée, de les rendre visibles et de les confronter aux signes annonciateurs d’une disparition programmée.
La flèche du temps n’est pas orientée par et vers un but, elle est constituée par la tension qui existe entre deux métaphores, celle qui dit le temps comme un gouffre et celle qui dit le temps comme un passage semblable à celui d’un fleuve. Ainsi les figures du temps se révèlent être liées à l’oubli ou au recouvrement, à l’effacement ou à la falsification des données de l’expérience intime, individuelle ou collective du temps.
L’idée même d’une continuité du temps dans laquelle seraient inscrits les moments vécus ne résiste pas au fait de les vivre comme intensités variables émergeant d’une discontinuité originaire. Pensée à partir des intensités, cette continuité se révèle être le processus de falsification présidant à sa constitution comme vérité.
Qu’une falsification puisse accéder au rang de vérité suppose que l’instance décisionnelle soit complice. La conscience, pour pouvoir jouir de sa position dominante s’est constituée comme réceptacle du mouvement même de l’histoire. Ne pouvant se présenter comme sa source même, ce qui serait reconnaître la falsification, la conscience se définit néanmoins comme coextensive au temps. Ainsi, rien de ce qui a eu lieu depuis les origines ne saurait avoir eu lieu sans qu’elle y fût mêlée.
6. La conscience, le temps
Comprise comme falsification, l’idée d’une unité des moments vécus comme étant orientée vers un but apparaît alors comme un dispositif mis en œuvre par les hommes eux-mêmes. Ce dispositif porte un nom triple. Pour les individus, il s’appelle conscience. Pour la communauté des hommes, il s’appelle histoire. Aux points d’intersection, là où ils se déterminent réciproquement, il prend le nom de conscience historique.
Penser le dispositif de la conscience historique implique cependant de tirer une autre conséquence de la discontinuité du temps et de son unité fictive : concevoir que la conscience elle-même soit un phénomène historique. Les conséquences réelles qu’un tel énoncé pourrait avoir sur la pensée et plus globalement sur l’idée que l’homme se fait de lui-même ne sont guère envisagées.
Reconnaître l’historicité de la conscience implique que l’on puisse d’une part expliquer ou du moins raconter sa genèse et d’autre part envisager sa disparition ou son remplacement par d’autres types de dispositifs.
Le mouvement par lequel, en Grèce en particulier, on est passé d’une conception religieuse et mythique de l’univers à l’élaboration d’une conception rationnelle et historique des choses et des relations entre les choses, constitue à la fois une preuve de cette historicité et un exemple majeur de la manière dont elle s’est constituée.
Cette élaboration s’est faite au prix d’un abandon progressif, douloureux, jamais intégral, des modes de pensée archaïques. La pensée n’a cessé, revenant sur elle-même pour mieux se comprendre, d’être confrontée à ces forces non contrôlées, qu’elle percevait déjà comme étrangères.
En écrivant que « le mouvement inconscient du temps se manifeste et devient vrai dans la conscience historique », Guy Debord situe sa pensée à l’extrême pointe de cette conception de l’histoire qui en fait le champ d’émergence d’une vérité radicale prise dans des rapports de forces complexes et enfouie dans l’opacité du mensonge. Cette pointe est devenue visible à un moment très particulier de l’histoire. Commençant à se nier elle-même, elle a engendré un nouveau type de fonctionnement psychique et une nouvelle forme de temporalité.
Ce qui rend la pensée de Guy Debord si « insupportable » pour tant de gens, c’est sa précision. Décrivant le comportement de certains individus dans le temps, il saisit en quoi le déploiement de l’histoire échappe au contrôle des hommes.
Son œuvre dit la mutation du déploiement des événements que l’on nomme histoire dans leur relation au dispositif de la conscience historique et leur réorganisation dans un fonctionnement social et un dispositif psychique radicalement nouveaux.
Engagé dans un combat sans merci contre une époque dont il ne cesse d’approfondir les arcanes, Guy Debord se trouve dans une position idéale pour appréhender le système totalitaire et la tyrannie radicale que cette société est en train d’instaurer.
La société du spectacle s’attaque aussi bien à l’espace réel qu’à celui des consciences, et cela de telle manière qu’aucune conciliation n’est plus possible entre ceux qui la dirigent et la soutiennent et ceux qui en subissent les mortels effets. Au cœur du champ de bataille de l’histoire et sous les coups de boutoirs de ce qu’il faut bien appeler un mensonge généralisé, le dispositif de la conscience historique se délite. Ce dispositif, comme tant d’autres choses existant dans cette société, est déchiré par des forces contraires quoique complémentaires. Il est à la fois emporté par le puissant fleuve de l’histoire et jeté dans le Maelström du temps.
Nous vivons à proximité de cette faille, unique et multipliée qui voit le dispositif de la conscience être déchiré, anéanti. Les paramètres constituant l’histoire sont devenus caduques. Ils sont en train, eux aussi d’être effacés de la mémoire des hommes.
7. Conscience sans histoire
La conscience est cette fonction du psychisme au moyen de laquelle il s’approprie un monde qu’il invente en l’éprouvant et en vérifie la teneur. Il le rapporte alors à lui-même comme à la mesure de sa vérité, sans cesser pour autant de le confronter à ce qui a été acquis par ceux qui l’ont précédé. Au cœur de ce processus complexe qui ne cesse de s’engendrer lui-même indéfiniment, le langage, ou plus exactement la traduction généralisée des expériences et des décisions en mots et des mots en décisions et en expériences. Sans cette traduction généralisée l’expérience même de vivre et de penser serait inconcevable. Cette traduction est le résultat d’un mécanisme complexe engendré dans le psychisme par un principe général de comparaison dont la métaphore est l’application la plus efficace.
Souvent associée à ce qui, dans l’homme, échapperait à l’espace, au temps, à l’histoire, la conscience le relierait au divin. Supplément essentiel formé par le retour sur elle-même de la pensée conçue comme un réseau de miroirs diffractants et un jeu infini de reflets, la conscience serait le porte-parole et le représentant de l’éternité dans le psychisme humain.
Cette dimension transcendantale lui permet, rétroactivement, de prétendre pouvoir retrouver des traces de sa présence dans toutes les étapes de l’évolution.
Source de la raison, la conscience l’assure dans son fonctionnement en la rassurant sur sa capacité à dire ce qui est, ce qui est vrai, ce qui doit être.
Doublet transcendantal d’un ego cogito, cette forme de la conscience met entre parenthèses les conditions réelles tant de sa genèse que de son fonctionnement. À rebours, la raison permet à son tour à la conscience de devenir le mécanisme permettant au psychisme de s’assurer de la continuité de ses fonctions principales à travers le temps.
Le fonctionnement du psychisme se base sur des phénomènes neuronaux qui ne relèvent pas de la conscience ainsi conçue. Fruit d’un processus complexe rendu possible par l’apparition du langage, la conscience a été inventée par le psychisme à travers la confrontation entre ce qui était perçu et les nouvelles possibilités que le fait de pouvoir formuler ce qui était perçu oralement d’abord, puis par écrit, pouvaient faire éclore. Elle ne préexiste donc pas de toute éternité en l’homme, mais a été engendrée en lui et par lui au cours de son évolution.
8. La conscience comme dispositif
La conscience est un dispositif complexe inventé par le psychisme humain pour permettre à l’homme de s’orienter dans l’existence au moyen de ces deux fonctions essentielles que sont la décision et l’action.
Ni jeu de reflets enfoui dans les profondeurs d’un moi, ni fonction mécanique de régulation des passions, ni mode de contrôle du vécu au moyen de la raison, la conscience est un dispositif complexe du psychisme humain susceptible de transformations à cause de sa plasticité et engendré historiquement.
Dans son livre, La naissance de la conscience dans l’effondrement de l’esprit, Julian Jaynes note que la conscience « est bien un organe de perception et pas seulement un moyen de communication ». Il en fait une instance complexe née de la mutation du psychisme humain au moment où la langue fait retour sur le psychisme à travers l’invention de l’écriture.
Julian Jaynes ouvre ainsi la porte à un déplacement radical des questions concernant les structures de la pensée et la compréhension de l’histoire.
L’existence de la conscience dépend de la structure du langage. Celui-ci « se déplace selon un axe synchronique, c’est-à-dire sans rapport avec le temps, vers l’espace du monde pour le décrire et le percevoir avec de plus en plus de précision. Mais le langage se déplace d’une autre façon, plus importante selon un axe diachronique, c’est-à-dire à travers le temps et derrière nos expériences en se fondant sur la structure haptique de notre système nerveux pour créer des concepts abstraits dont le référent n’est pas observable, sinon dans un sens métaphorique. »
En faisant de la conscience « le travail de la métaphore lexicale » et en montrant qu’elle « continue à s’engendrer elle-même », Julian Jaynes fait de la conscience un dispositif complexe qui « opère une sélection constante sur ces inconnues que sont nos actions futures, nos décisions, nos souvenirs partiels du passé, sur ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas encore. »
Pour Julian Jaynes, la conscience a six caractéristiques :
- La spatialisation, phénomène sans lequel les choses sans qualités spatiales dans la réalité ne pourraient avoir de réalité dans la conscience.
- L’extraction, qui, distincte de la mémoire, est le choix fait par le psychisme dans l’ensemble des attitudes possibles, car nous ne faisons jamais attention à tous les éléments d’une situation.
- Le « Je » analogue, métaphore que nous avons de nous-mêmes et qui « peut se déplacer » par délégation dans notre « imagination », « faire » des choses que nous ne faisons pas « réellement ».
- Le « moi » métaphorique qui correspond pour le « Je » analogue à cette instance réflexive qui fait que nous nous apercevons en train de faire quelque chose et que nous confondons le plus souvent avec la conscience générale.
- La narratisation, qui est à la fois la recherche des causes, la manière dont nous nous racontons les choses et les raisons pour lesquelles nous avons pu les commettre, mais aussi dont nous nous racontons toutes les autres choses qui se trouvent dans la conscience.
- La conciliation, processus essentiel par lequel « on assemble les choses sous la forme d’objets reconnaissables en se fondant sur les schémas acquis précédemment » et « construction cohérente ou vraisemblable qui se fait dans le respect des règles élaborées dans l’expérience ».
Ces six caractéristiques indiquent que la conscience n’est pas une donnée transcendantale et qu’elle a été engendrée au cours de l’évolution de l’homme par la mutation complexe de son psychisme due à l’invention du langage puis de l’écriture. Elles permettent surtout de la définir comme un dispositif, au sens que donne Giorgio Agamben à ce terme, à savoir « tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Simplement ce dispositif ne se situe pas à l’extérieur des êtres vivants, mais bien en ce qui concerne celui de la conscience « dans » le psychisme de l’homme en tant précisément qu’il assure le lien entre les labyrinthes du dedans et les formes du dehors.
Concevoir à l’instar de Julian Jaynes la conscience comme « modèle du monde créé par la métaphore » ou comme « invention du monde analogue sur la base du langage » implique donc que l’on accepte de penser qu’un jour elle puisse être amenée à « disparaître ». Ce jour arrivera précisément dès lors que le rapport complexe que l’homme entretient avec le langage se trouvera profondément modifié. Et c’est précisément ce que la société du spectacle est en train de réussir, transformer le psychisme humain en détruisant le dispositif par lequel il est régulé depuis quelques millénaires et qu’on appelle la conscience.
9. Avant la conscience
Richard Broxton Oninans, E.R. Dodds, Jean-Pierre Vernant ou encore Marcel Détienne ont fourni les éléments essentiels permettant une analyse de la genèse de la conscience à partir des preuves concrètes de son historicité. Mais c’est Julian Jaynes qui a su expliciter le fonctionnement probable du psychisme humain avant l’invention de la conscience et montrer le douloureux chemin qui a conduit à l’instauration de la conscience comme dispositif dominant du psychisme.
À l’époque de l’Iliade, les mots ne signifient encore que des choses concrètes. C’est bien après qu’ils finissent par désigner des aspects du fonctionnement mental des hommes. « Le mot psyché qui, plus tard, signifie l’âme ou l’esprit conscient, représente, dans la plupart des cas, des substances vitales comme le sang ou le souffle. »
Dans le monde de l’Iliade, le corps n’est jamais présenté comme un tout. Soma signifie simplement le contraire de psyché, c’est-à-dire le cadavre au sens des membres morts. Un corps n’est alors qu’une pluralité de membres et de fonctions diverses. La question est donc de savoir ce qui commande l’action de ces corps vivants puisque ce n’est en aucun cas une volonté. La réponse que propose Julian Jaynes, c’est de dire que ce sont les dieux.
« En fait, ces dieux tiennent lieu de conscience. L’origine des actions ne se trouve pas dans des projets conscients, des raisons ou des mobiles, mais dans les actions et les discours des dieux. Aux yeux d’un autre, un homme semble être la cause de sa propre action ; mais pas aux yeux de l’homme lui-même. [...] Les dieux étaient des organisations du système nerveux central, et peuvent être considérés comme des personae dans le sens où ils présentaient une grande cohérence à travers le temps, où il étaient des amalgames d’images parentales admonitoires. Le dieu est une partie de l’homme. [...] Il se contente de guider, de conseiller et de commander. Il ne demande pas l’humilité ni même l’amour, et exige peu de reconnaissance. [...] Les dieux sont ce qu’on appelle maintenant des hallucinations. »
Ce condensé des thèses de Julian Jaynes permet de mesurer l’écart qui sépare ce qu’il nomme le monde bicaméral du monde gouverné par la raison, c’est-à-dire par la croyance en la toute puissance du dispositif de la conscience qui seul permet aux hommes de régler leur conduite en s’appuyant pour cela essentiellement sur des éléments ratioïdes.
L’absence d’intériorité, d’ego et de corps comme unité d’un divers de sensations, s’accompagne d’une régulation de l’existence par des directives permettant de faire face aux situations nouvelles ou difficiles. Si ces directives proviennent de voix admonitoires, ces voix peuvent aussi bien donner l’impression de venir de l’intérieur du crâne que de l’extérieur, d’un nuage ou d’une apparition par exemple.
Il n’est pas question de se demander si l’on peut ou non obéir à ces voix. En effet, les injonctions qui sont formulées, les ordres qui sont donnés, « sauvent », c’est-à-dire permettent de trouver une solution et de sortir de la crise engendrée par la situation nouvelle. Il n’y a pas non plus de véritable décision prise suite à l’audition des voix, car les actions ont lieu immédiatement. L’individu effectue les gestes nécessaires à sa survie sans que quelque chose qui ressemble à la conscience participe à leur accomplissement.
« La fonction des dieux consistait essentiellement à diriger et à organiser l’action dans des situations nouvelles. Les dieux évaluent les problèmes et organisent l’action en fonction de la structure ou du but du moment. » Au-delà de cette fonction qui est donc de permettre à une « décision » motivée par l’obéissance à une voix indiquant ce qu’il faut faire pour sortir d’une situation de crise, d’être suivie par l’action nécessaire, cette approche de Julian Jaynes conduit à une nouvelle conception générale du fonctionnement du cerveau, à l’idée de l’existence d’un cerveau dédoublé.
Deux choses importent ici, le fait que « l’organisation de l’expérience admonitoire était assurée par l’hémisphère gauche » et que « c’étaient les impulsions venant de l’hémisphère droit qui faisaient entendre la voix des dieux ». Des traces, voire même des restes de ce fonctionnement bicaméral du cerveau, persistent aujourd’hui encore dans le dispositif de la conscience en ceci que « l’hémisphère droit est plus impliqué dans des tâches de synthèse et de construction de l’espace tandis que l’hémisphère gauche est plus verbal et analytique. »
Modifier notre conception du fonctionnement de la conscience nous permettra, lorsque nous cherchons à interpréter des manifestations radicales d’affectivité par exemple, de mieux les comprendre. Il suffit pour cela que nous nous autorisions à les analyser en fonction de paramètres qui prennent en compte leur dimension irréductible.
Cette autre histoire de la conscience, c’est donc Julian Jaynes qui l’écrit. Elle permet de rendre compte de phénomènes qui généralement sont occultés ou rangés et enfermés dans le placard des comportements déviants.
De tels comportements sont porteurs, aussi bien de forces décisives que d’interrogations, en particulier sur la fonction réelle du langage dans le fonctionnement psychique. Ils ouvrent une perspective générale sur ces aspects de nous-mêmes qui nous restent scellés tant il est vrai, comme le remarque Julian Jaynes, que « l’expression de l’affectivité n’est pas l’affaire du cortex » et que nous affectons de croire que c’est au moyen du cortex que nous dirigeons nos vies.
10. L’Iliade des enfants perdus
Il y a dans les textes de Guy Debord une présence discrète mais évidente de l’Iliade. Des citations ou des allusions évoquent le caractère si particulier des héros.
Aucun lecteur de l’Iliade ne peut ignorer que les personnages dont on raconte les exploits ne vivent ni ne pensent comme nous le faisons aujourd’hui. Par contre, ce qui peut aisément apparaître, c’est une certaine parenté entre les comportements des « enfants perdus » et ceux des héros de ces temps disparus, au moins sous deux aspects essentiels. Le premier tient au fait de vivre dans une temporalité discontinue, une succession de moments apparemment sans liens entre eux, chacun semblant concentrer en lui une forme de temps absolu. Le second concerne les comportements. Ils semblent tous déterminés par des affects violents et ne dépendre en rien d’une quelconque forme de conscience ou de raison.
Ce qui compte pour les voyous et les « voyelles » du Paris des années cinquante, ce qui motive leurs actes n’obéit pas non plus directement à des critères rationnels et encore moins à des critères moraux, mais bien à des critères affectifs et ludiques. Si les héros de l’Iliade vivaient en deçà du bien et du mal, les enfants perdus vivent, eux, par-delà le bien et le mal.
Pour les héros de l’Iliade, quelque chose comme un monde rationnel n’existe pas et la structure de leur psychisme ne ressemble en rien à celle la conscience.
Pour les enfants perdus, ce monde, censé être gouverné par la raison n’étant en fait soumis qu’à la raison du plus fort, ils ne voient donc aucune raison de se soumettre à ses lois.
Cela implique de ne pas recourir à la conscience pour s’assurer de la justesse de ses actes et de ses décisions et donc que d’autres motifs les gouvernent. Ces motifs, ce sont leurs désirs et leurs passions qui les dessinent. Ils n’écoutent que les injonctions qu’ils font naître en eux et peu leur importe que cela implique de s’opposer à tout ce qui est, de renverser tous les obstacles pour les satisfaire, de refuser de prendre en compte les conséquences éventuelles de leurs actes.
Les héros de l’Iliade non plus ne calculent pas ce que pourraient être les conséquences de leurs actes. Ils en sont littéralement incapables. Si les enfants perdus, eux, s’y refusent, c’est parce qu’ils ne voient plus aucune raison d’obéir à la raison, aucune raison d’obéir aux injonctions lancées par la voix de la conscience.
Ce qui importe aux héros, c’est d’abord de combattre et si leurs actes sont tendus vers un but, c’est uniquement la victoire. La victoire se suffit à elle-même. Elle n’a pas d’autre fonction que de conférer à l’instant un éclat sans pareil. Le héros n’est pas soucieux de sa mémoire. L’éclat de la victoire et l’admiration des siens lui suffit. Il n’ambitionne pas de laisser de traces en ce monde, ni en un autre. Faire de cet éclat un élément mémorable, ils laissent cette tâche à d’autres. C’est le poète qui s’en chargera.
Sujet à des accès de fureur proprement non ratioïdes qui lui sont dictés par la voix d’un dieu ou d’une déesse, les héros n’obéissent pas à la raison. La raison une fois maîtresse du psychisme humain ne gardera de ses origines furieuses qu’une sorte d’impérieux désir d’oubli.
C’est vers cet oubli que la rage nihiliste remonte, vers cette source non tarie de la puissance non ratioïde des affects qui reste pourtant absolument déterminante lorsqu’il s’agit de passer à l’acte, de partir au combat, d’aller vers la victoire, de risquer la défaite.
11. L’appel au combat
Nul mieux que Richard Broxton Onians, dans son livre Les origines de la pensée européenne, n’a montré comment se sont inscrits dans la langue grecque et dans celle de l’Iliade en particulier, ces affects puissants qui, sous le nom de dieux, ont poussé des hommes à des actions d’éclat, ces hommes pour lesquels, comme le dit l’Iliade, « faire la guerre devient plus doux que revenir chez soi ».
Les enfants perdus non plus n’aimaient pas retourner chez eux. Ils ont participé à des combats moins homériques mais pas nécessairement moins dangereux, en tout cas pour leur psychisme. Ils ont lutté contre les limites d’un monde qui les étouffait, les refusait, les niait. Eux aussi connurent « la joie qui naît du libre jeu des énergies du guerrier lorsque, tel le cheval de bataille, il « hume la bataille au loin ».
Ce qui détermine un héros à l’action, et plus globalement son destin, ce sont les dieux. Le héros ne dispose pas de lui-même. Les dieux l’aident à prendre une décision, à agir, à partir au combat. Non conscient de ses actes, il obéit à un appel, à une admonestation, à un ordre. La voix vient du dehors et résonne en même temps en lui-même, voix étrangère et intérieure.
Ce n’est pas seulement dans les actions qu’interviennent les dieux. Comme le remarque encore Richard Broxton Onians, « dans la grande majorité des passages d’Homère dont nous nous sommes occupés, c’est la mauvaise fortune que les dieux attachent sur les hommes. [...] Les poèmes homériques sont d’une tonalité essentiellement tragique, puisqu’ils ont pour sujet les périls et les épreuves de la navigation et du champ de bataille et qu’ils sont aussi tristes dans leur déroulement que dans leur dénouement. »
Cette tonalité, il est impossible de ne pas en entendre l’écho dans les passages des livres ou des films que Guy Debord consacre à cette période de sa vie, et surtout dans la tonalité de cette « voix » avec laquelle il dit les textes qui composent ses films.
« Des siècles après Homère, remarque en effet Richard Boxton Onians, alors que la pensée grecque avait atteint sa pleine stature, il était encore nécessaire pour Aristote, discutant de la liberté de la volonté, d’insister sur le fait que, si les mauvaises actions doivent être imputées à une cause extérieure, alors les bonnes aussi. »
Les héros ignoraient la distinction entre le bien et le mal. Ils n’avaient pas de moi et ne disaient pas Je. Ce sont pourtant les récits de leurs faits et gestes qui vont rendre leur gloire immortelle et leur conférer une sorte d’intériorité.
Si l’histoire de la pensée occidentale est un lent mouvement qui conduit de l’éclat d’un geste héroïque accomplit dans l’instant à la constitution d’une forme d’intériorité qu’on nommera la conscience, ce mouvement est à la fois traversé et porté par un conflit qui ne cessera jamais.
Un psychisme doté d’une intériorité est une « invention » récente et fragile. En effet, le dispositif de la conscience n’a jamais pu éradiquer ou se passer de l’existence de manifestations physiques et psychiques venant la troubler.
De fait la conscience ne cessera jamais d’entendre des voix, de lutter contre elles, de tenter de les oublier, d’espérer les amadouer. Dans une de ses tentatives pour mieux les contrôler, le dispositif de la conscience inventera même une sorte de stratagème. Il fera de la conscience une voix. La philosophie ne cessera de travailler à cette assimilation. La conscience sera constituée comme une voix permettant de s’orienter dans la vie. Martin Heidegger dans Être et temps, pensera la conscience sur le mode de l’appel, d’un appel qui s’appelle lui-même, car « dans la conscience, le Dasein s’appelle lui-même. »
Cette question de savoir d’où provient la « voix » qui détermine les choix d’une conscience est d’une importance capitale. En effet, la philosophie a tranché ou plus exactement, elle s’est constituée comme cet exercice de l’esprit par lequel est mis en œuvre le processus infini et le combat éternel de la conscience contre ses contrefaçons, c’est-à-dire contre tous les discours qui pouvaient et pourraient laisser penser qu’elle n’est pas immuable et éternelle.
Cet aveu violent de Martin Heidegger en témoigne : « La conscience, en tant que phénomène du Dasein, n’est point un fait qui surviendrait et serait parfois sous-la-main. [...] L’exigence d’une « preuve empirique inductive » de la « factualité » de la conscience et de la véracité de sa « voix » procède d’une perversion ontologique du phénomène, perversion à laquelle participe, du reste, toute critique supérieure qui prétendrait que la conscience ne survient que de temps à autre, et lui dénierait ainsi le statut de « fait universellement constaté et constatable ». À de semblables preuves et contre-preuves, il n’est pas question de soumettre le fait de la conscience. »
C’est durant cette période décisive de sa vie auprès des Lettristes et avec les enfants perdus, que Guy Debord fera voler en éclats le dispositif de la conscience afin de permettre aux éléments non ratioïdes mis en sommeil dans le dispositif d’être réactivés et confrontés aux éléments ratioïdes qui le gouvernent. Ce geste radical a révélé l’existence d’une faille au cœur du