
Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Accélération de la spirale — I/II
Accélération de la spirale — I/II
Essai sur l’œuvre de Werner Lambersy - Première partie
,
La disparition de Werner Lambersy, qui nous confia tant de textes inédits, nous affecte profondément. Un ami disparaît et nous lui rendons hommage en publiant ici en deux parties un texte qui met en perspective son parcours et son oeuvre. Ce texte fut publié, en son temps, aux éditions des Vanneaux.
« Plus je travaille avec la télé, plus je pense au néolithique. » Nam June Paik
Le sourire du diable
La poésie est une affaire d’affects purs. Or les affects purs n’existent pas. Il faut les construire. Tel est l’agir du poète : rassembler les débris de l’improbable, faire coexister le vif et le mort en pariant contre la mort, dépecer les évidences, faire éclater le discontinu jusqu’à ce qu’il accouche d’une ligne aux courbures de sirène ou d’un château de cartes, équarrir le néant et en recracher la pulpe jusqu’à usure des dents. Bref, il s’agit de les extraire de nulle part, ces affects purs, pour les lancer vers l’inconnu.
Ce qu’est un affect pur ? La brisure dans la régularité de l’offense, la douleur dans le sourire du diable, en tout cas quelque chose qui dans ce que nous appelons un homme vient d’ailleurs, le traverse, le cloue, l’épuise et parfois le transperce si bellement qu’il se trouve emporté au-devant de lui-même, en devenant la flèche de quelque chose qui avant cela n’avait pas de nom et pourtant existait. Le poète est celui qui, à cette « chose-là », donne son nom.
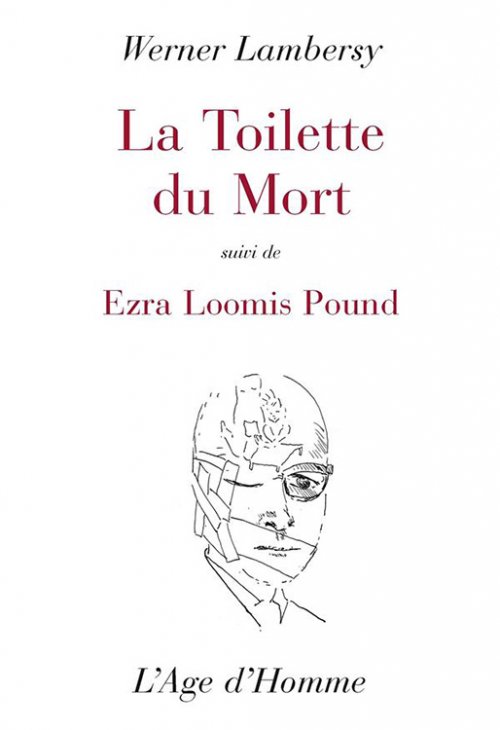
La déchirure et la voix
Dit autrement, cela devient : le poète est un homme, le poème, lui , est non humain. Pas inhumain au sens graveleux du terme, simplement, c’est un chercheur d’un genre particulier. Il fouille, il sonde, il arpente le néant, les profondeurs, la peau et en ramène parfois rien, parfois des os, ou des souvenirs que l’on ne voulait pas rencontrer, parfois aussi quelques brûlures comme en laissent les étoiles sur l’œil clos des amants.
Le non-humain a un nom : découverte. On peut l’appeler aussi invention. Parfois, il croise dans les parages du destin et s’appelle l’inconnu. Mais son nom de toujours, c’est la voix.
Il y a ce que je sais comme individu et ce que je sais comme humanité, ce que je sais comme singularité fervente et ce que je sais comme universalité volage. Et il y a ce que je peux. Et souvent, c’est moins que ce que je sais. Ou plutôt ce n’est pas en phase avec ce que je sais.
C’est en cela que consiste, différente en chacun et unique entre tous, la déchirure. C’est d’elle que semble venir la voix. Du plus lointain dehors. Des plus grandes profondeurs du monde intérieur. Le poète est celui qui, n’ayant en quelque sorte peur de rien, prête à cette voix les accents de la sienne. Il y risque beaucoup et ceci surtout, de devenir elle à la mesure où elle devient lui.
Dans un texte déjà ancien, l’un des grands artistes de l’art vidéo, art contemporain s’il en est, s’est révélé non seulement fort attentif aux images, mais aussi à la voix. « Les anciens Grecs entendaient des voix. Les épopées homériques sont pleines d’exemples de gens guidés dans leurs pensées et actions par des voix intérieures auxquelles ils répondent automatiquement. [...] De nos jours, nous sommes méfiants envers les personnes qui présentent ce type de comportement ; nous oublions que le terme entendre se réfère à une sorte d’obédience (les racines latines du mot sont ob et audire, c’est-à-dire entendre quelqu’un à qui l’on fait face). L’autonomie de l’esprit est un concept si profondément enraciné en nous que nous répartissons ceux qui entendent des voix en diverses catégories : a) ceux qui sont légèrement amusant, b) ceux qui sont des poètes, c) ceux qu’il faudrait enfermer dans un institut psychiatrique. Une quatrième catégorie pourrait être ceux qui regardent la télévision ; [...] S’il y a un espace réel ou virtuel de la pensée, alors il doit y avoir aussi du son à l’intérieur, car tout son cherche à s’exprimer comme vibration dans un milieu spatial. » (Bill viola « Le son d’une ligne de balayage ». Chimère 11, printemps 1991.)
Par la simplicité de son questionnement et par sa radicalité même, cette remarque de Bill Viola, montre qu’à l’évidence, la vidéo et au-delà d’elle, toute pratique artistique contemporaine se trouve à la croisée des questions posées tant par la situation de crise qui est la nôtre aujourd’hui que par l’art depuis deux ou trois millénaires.

Crise
« Quand je regarde la Lune par une nuit dégagée, je ne vois pas un satellite de la N.A.S.A. même si je sais que ce que je vois est un satellite appartenant à la N.A.S.A. Je continue à voir un satellite naturel de la terre ; ma vision du monde n’intègre pas ma connaissance. Cette absence d’intégration de la connaissance à la vision est caractéristique de situations déterminées que nous appelons « crises ». Il est probable que les Grecs de l’Antiquité savaient que la Lune est une sphère, mais ils continuaient à voir en elle une déesse. Il est probable que les mélanésiens savent que la lune est un satellite de la N.A.S.A., mais ils continuent de voir en elle un symbole de la fertilité. Dans une situation de crise, la vision du monde ne parvient pas à intégrer la connaissance » (Vilèm Flusser, Essais sur la nature et la culture, p. 62, Ed. Circé 2005).
Si une crise se caractérise par une absence de lien ou du moins de cohérence entre une vision du monde et les connaissances disponibles sur le monde à ce même moment, et donc par le fait que ces deux plans ne fonctionnent plus de manière parallèle ou complémentaire, alors, ce que nous vivons aujourd’hui constitue bien une situation de crise.
Entre ces deux plans se déploie, s’invente, se crée une sorte « d’image commune » dont le contenu constitue l’ensemble des croyances légitimes à un moment de l’histoire. Il ne faut pas oublier que cette « image commune » est autant le résultat de nos oublis et de nos aveuglements que de nos connaissances, de nos refus ou de nos peurs que de ce que nous sommes capables de reconnaître et d’accepter.
Lorsque les forces qui traversent notre vision du monde et les champs de nos connaissances s’exercent dans des directions contradictoires, une déchirure, inévitable, vient affecter de manière parfois irrémédiable l’ensemble de nos croyances légitimes.
Une telle déchirure entre vision du monde et connaissance traverse aussi bien la société dans son ensemble que les pratiques artistiques et que les individus.
Le partage qui nous affecte aujourd’hui, relève à la fois d’une situation nouvelle dans le champ des sciences, d’une faille constitutive de l’histoire de la pensée occidentale et d’un conflit plus ancien encore entre image et écriture d’une part, image et voix de l’autre.
L’œuvre de Werner Lambersy est un parcours incessant et renouvelé le long de cette déchirure et une tentative de tisser avec les mots de toujours de nouveaux liens entre nos connaissances et notre vision du monde, de forger de nouvelles images. C’est pourquoi elle est irréductiblement contemporaine.
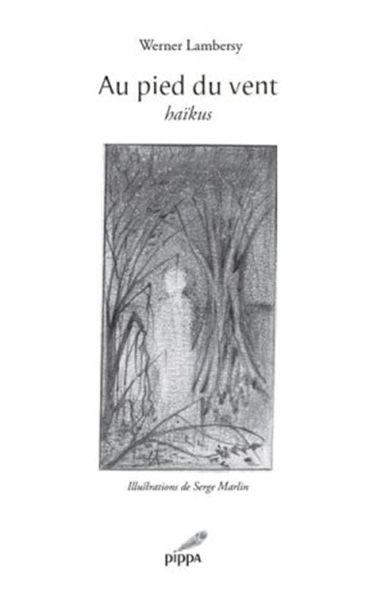
La spirale et le vide
Le temps n’avance pas en ligne droite, comme une assimilation réductrice de son déploiement avec la seule succession des secondes nous le laisse croire le plus souvent. Dans ce schéma, la seconde serait un point qui en se déplaçant tracerait une ligne infinie étirant sa langueur entre un commencement inaccessible et une fin promise quoique tout aussi inaccessible pour le corps comme pour la conscience. Cette figure n’a pas d’autre validité que celle que lui confèrent les marchands de sommeil et les croque-morts.
Chacun le sait qui écoute en lui le murmure incessant des choses et des êtres, des vies brisées et des chemins qui bifurquent, le temps ne se déploie pas en ligne droite. Il forme plutôt une sorte de spirale voire une double hélice comme l’escalier de Chambord dessiné par Léonard de Vinci. À ceci près que parfois, un passage peut s’opérer entre les hélices.
L’aspect le plus important de la spirale tient surtout en ceci que des points éloignés dans le temps peuvent se trouver proches dans l’espace ou du moins dans le même axe à un moment donné. Il faudrait ajouter que ces spirales temporelles forment elles-mêmes d’autres spirales sur la longue durée. Ce sont alors des époques fort éloignées dans l’histoire qui peuvent entrer en correspondance avec le présent.
C’est ce qui arrive aujourd’hui. Nombreux sont ceux qui remarquent des échos, des parentés même parfois, entre ces temps hyper technologiques et des temps plus anciens, des temps préhistoriques, des temps où la conscience était autre et les voix plus audibles, où la peur servait à déclencher les gestes qui sauvent et la vie était un trait de bronze traversant l’espace-temps.
La vie des héros en tout cas ressemblait à cela. La vie des poètes est liée de manière intime et profonde, indéracinable, à ces temps d’avant l’histoire, à ces temps d’avant le temps, à ces temps d’avant la fin annoncée de tout.
Le poète est celui qui, porté par les soubresauts du chaos dans la mémoire des atomes, parcourt ces spirales comme d’autres s’élancent sur les montagnes russes du désespoir en vue d’y voir le paysage sous un nouveau jour. Et ce qu’il découvre est un paysage inhumain, comme sont inhumains les affects qui alors le traversent. Le poète est celui qui, par ses va-et-vient incessants, entre les courbures et les entrelacs des spirales du destin, fait apparaître une figure cohérente. Il est cette figure et cette ligne en même temps qu’elles le traversent.
S’il est la flèche et le corps, il est aussi le temps et son contraire le plus absolu, le vide, ce vide qui n’est à confondre ni avec le néant ni avec le calcul général des profits qui confinent les formes abâtardies de la vie à tourner en rond dans le cercle fini du zéro.
Le vide, la physique contemporaine le conçoit comme une entité plus riche en potentialités que les mille et une nuits en rebondissements. Michel Cassé en dit ceci : « Nous venons de définir le vide négativement, par privation, comme espace sans particule réelle. On peut aussi en donner une définition positive, dont l’intérêt est de nous faire comprendre, précisément ce que nous qualifierons d’énergie du vide : c’est, comme nous n’avons cessé de le marteler, un océan de particules virtuelles. Celles-ci, bien qu’éphémères, interagissent très légèrement entre elles et avec la matière, et confèrent au vide une certaine énergie potentielle. Il est de ce fait, l’une des manières d’être de l’énergie, laquelle n’est pas touchée par le changement des formes et des états que la suite des causes et des effets, ou bien des aléas, fait survenir ou disparaître, et qui seules sont soumises à la « naissance » et à la « mort ». [... Paré de sa définition, le vide dispose des deux vertus relationnelle et ontologique (quantique et cosmologique). La première en fait l’administrateur admirable du microcosme et la seconde, l’élargisseur de l’espace, père de la matière. » (Michel Cassé, Du vide et de la création, Ed Odile Jacob, p. 169)
L’acte poétique par excellence consiste à faire surgir du vide des combinaisons improbables.
Poète est celui pour qui les mots sont non seulement des entités qui désignent des choses, des êtres ou des états, mais bien plus encore et avant cela, des entités sonores et scripturales qui fonctionnent dans notre esprit comme fonctionnent les particules virtuelles dans le vide quantique.
Ainsi l’histoire et le temps ne sont pas les seuls à former des spirales dans la conscience des hommes. Les atomes et les mots remuent et tournent sur eux-mêmes dans le silence de l’oubli, celui qui précède toute mémoire et que rien ne remplace. L’évocation de cet oubli, pourtant, continue d’éveiller des craintes étranges. Ce sont elles que le poète renvoie dans les limbes lorsqu’il laisse se lever les mots, ces particules qui dansent, dansent, dansent, comme des images sur la rétine du désir, comme des pixels sur l’écran neigeux des catastrophes.

Métaphores
Cela passe pour une telle évidence qu’il serait inutile d’en parler, et pourtant il le faut. La métaphore est le moyen unique dont dispose le poète. La métaphore est aussi le moyen unique dont dispose l’homme sinon pour penser du moins pour assimiler ce qu’il pense, s’en nourrir et croître avec lui.
On doit à Julian Jaynes dans son livre La naissance de la conscience dans l’effondrement de l’esprit, d’avoir donné à la métaphore sa dimension la plus complète. Il remarque en effet deux choses essentielles, d’une part que la conscience est le travail de la métaphore lexicale et d’autre part que la conscience ne cesse de s’engendrer elle-même en inventant toujours de nouvelles métaphores, c’est-à-dire à la fois de nouveaux liens entre les choses et de nouvelles images permettant de rendre compte de l’état du monde et de celui de la « pensée » humaine. C’est qu’il pense la langue comme un organe de perception, ce que le poète, inévitablement, lui aussi sait.
Ainsi, il n’y a pas de différence entre corps et pensée, entre le paquet de chair et de nerfs qui sent et crie et celui qui parle et chante, calcule et pleure, entre l’homme et le poète.
Les seules différences tiennent en quelques effets de feed back de certaines habitudes ou de certaines croyances sur cette viande articulée au souffle qui nous sert de véhicule. Elles sont parfois incommensurables et parfois elles s’annulent. Le poète est celui qui parcourt ce double écart, celui de la faille entre les cultures et celui de la faille entre le corps. Pour cela, il doit aimer et voyager.
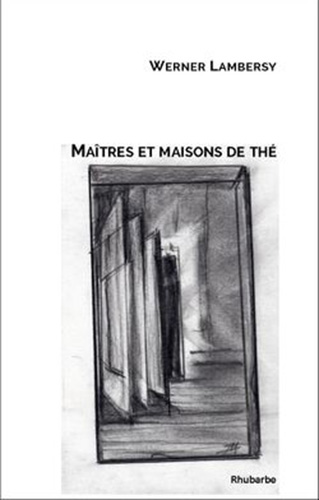
Panoramique
Werner Lambersy est un citoyen du monde. À ceci près qu’il a choisi ses mondes et parfois aussi été choisi par eux. Il a voyagé par les livres et pour les livres, comme homme et comme poète. Mais il ne voyage pas pour le plaisir de voyager ! On se souvient de la formule lapidaire de Beckett. Non, il voyage pour rencontrer, il rencontre pour voyager. En fait, il n’y a pas là calcul mais bien réalité matérielle et plaisir réel de la découverte, d’un texte, d’un poète, d’une voix. Car un pays ou une région du monde pour lui, ce sont d’abord les poètes qui le disent, les écrivains qui le narrent, les voix qui le chantent.
Mais cela ne peut se faire n’importe comment. Il est facile de voyager au XXe siècle et d’avoir des amis partout. Il est facile d’avoir accès aux littératures du monde. Ça l’était moins, il y a quelques décennies et c’est redevenu difficile aujourd’hui, pour d’autres raisons. Il fallait sans doute avoir un peu de chance, rencontrer un ou deux bons passeurs, mais il faut surtout aujourd’hui comme toujours, avoir la force, le courage de faire face et de faire corps avec ce que l’on entend découvrir, avec ce qui se découvre à nous.
Le renard et le petit prince ont tout dit au sujet de cette nécessité absolue qui est au cœur de chaque rencontre comme son secret de polichinelle et sans lequel pourtant elle ne serait rien : l’apprivoisement de soi par l’apprivoisement de l’autre.
Ainsi en va-t-il pour Werner Lambersy qui va passer de la découverte de la poésie allemande à celle des USA des années cinquante à soixante-dix, de celle de l’Europe du nord, la finlandaise en particulier, à celle d’Afrique, celle de l’Afrique émergente d’après la décolonisation, puis à celle de l’Inde grâce à l’amitié pour Lokenath Bhattacharya et enfin à celle du Québec qu’il découvre à partir des années soixante dix.
Bien sûr, il n’y a pas que des poètes parmi ses amis. Il y a aussi de grands romanciers qui accaparent son attention et forcent son respect.
Et puis il y aura les non-rencontres, celles d’auteurs qui le traduiront ou qu’il traduira et qu’il ne connaîtra pas, celles de pays où il n’ira pas, celle des contacts qui feront défaut et vivront en lui par ce défaut même.
Sa géographie est donc triple, textuelle, réelle et rêvée. Elle est donc purement poétique. Mais elle est aussi profondément politique au sens où ces amitiés ne font pas la part belle aux personnages reconnus. Bien plutôt s’agit-il toujours d’affects puissants, face auxquels les reflets des paillettes, même littéraires, sont sans valeur.
Car ces rencontres sont nourritures terrestres essentielles. Ici, c’est bien sûr la part sombre de l’âme qui se met à nu ou le drame des temps barbares qui se chiffre. Et le nom de Paul Celan résonne à travers la mort. Là, ce sont les voix aiguës des ancêtres que nous n’avons pas eu et les voix de l’Afrique remontent à travers nos pieds. Ici, ce sont les mythologies de la modernité qui explosent, à travers Ginsberg qu’il a bien connu plus encore qu’à travers Burroughs ou Kerouac. À Québec c’est la rencontre entre une voix et un peuple, entre poésie et réalité politique et sociale qui s’arriment, à travers les textes de Gaston Miron et de tous ceux qui occuperont le rang d’amis, en particulier Antonine Maillet ou Hélène Dorion.
Et puis il y a, parmi les rencontres décisives, la rencontre décisive unique. C’est celle de Lokenath Bhattacharya, le poète bengali vu et revu entre 1972 et 1989 qui permettra que soit publié dans un quotidien bengali tiré à un million d’exemplaires « Maîtres et maisons de thé ».
Et puis il y a encore et toujours, lancinante, la question des origines réelles. Acceptées ou refusées, niées ou magnifiées, elles ne sont pas sans importance. Et en effet, Werner Lambersy ne vient pas de nulle part. On le sait, il est belge d’origine flamande et il écrit en français. Et outre la biographie qui oscille inévitablement entre famille et amours, le pays de naissance peut donner lieu à des amitiés réelles et littéraires. Ce sont ainsi Jean-claude Bologne, Henry Bauchau Pierre Dhainaut ou Marie-Claude Bancquart dont il faut ici faire sonner le nom parmi beaucoup d’autres.
Et puis il y a les géographies imaginaires, celles qui se déploient au gré des lectures. Il y a tant de lectures, que cela pourrait ne pas compter. Mais il s’agit ici des lectures qui vous changent la vie ou qui vous accompagnent pendant des années, des décennies, plus parfois. Et là les noms sont légion. Ou plutôt ils forment une légion, l’une des meilleures, l’une des plus actives sur le front de la transformation des conditions générales de l’existence.
Werner Lambersy n’est pas le seul à aimer Pessoa et Michaux, Melville et Heaney, Pound et Cummings, Césaire et Laabi, Borchert et Lagerkvist Tranströmer et Schulz, Montaigne et Kazantzakis. Il se trouve que, pour un poète, la lecture prend souvent une dimension simplement plus directe, plus violente, plus explicite. Il s’agit de goûter, mais aussi de grandir, il s’agit de croître mais aussi de se mesurer aux mots des autres. Pas pour être vainqueur, il n’y a pas de vainqueur ici, sinon celui qui se vainc lui-même.
C’est là que tout conduit, non pas à soi, mais à l’élaboration en soi par les autres de ce qui constitue ses propres affects, à l’élaboration d’affects purs qui sont les flèches par lesquelles on a été traversé et dont on aura pu se saisir pour les renvoyer plus loin, vers d’autres. Puissance des mots. Magie des mots. Douleur des mots.
Tel est le destin du poète de produire des armes fatales d’un genre particulier puisqu’elles doivent pouvoir réveiller les morts et en tout cas éveiller les errants de la chair que nous sommes. Car il faut élaborer un programme lorsque l’on devient poète, un programme de vie, qui prenne en charge croyances et politique, la politique des corps comme la politique du mensonge, pour en dégager la poétique, cette équation à « n » inconnues qui ne se résout jamais mais qui admet, parfois, de beaux résultats transitoires.
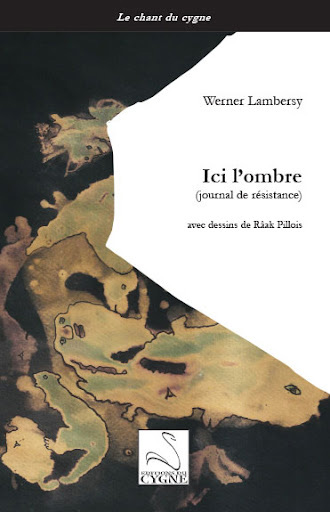
Questions
Est-ce que tous les poètes disent la même chose ? Il se pourrait bien que oui. Et si cela était, ce ne serait que raison, car cette puissance du semblable dans l’infinité des variations est la même qui fait l’infinité de la musique sur le clavier des passions en noir et blanc ou celle des combinaisons verbales sur le clavier des alphabets.
Et pourtant il s’agit à chaque fois d’autre chose. De la même chose autrement et du même autrement de la chose. Non seulement parce que le monde est en chaque être chaque fois recommencé, mais parce que chacun est une combinaison, on le sait, particulière, unique dit-on. C’est ce que l’on veut croire. C’est ce que le poète confirme et infirme en chacun de ces vers : l’unique est un composé d’atomes sentants et ces atomes sentants sont tous semblables.
Voyager et aimer cela ne suffit pas pour devenir poète. Rien n’existe sans la conscience de l’amour et du voyage. Reste à chaque époque à faire vivre cet amour, à accomplir ces voyages. Le poète n’a pas d’autre tâche que des les accomplir, on dirait presque dire pour les autres, dans la mesure où il le fait avec les mots de chacun.
Est-ce que tous les poètes parlent de la même manière ? C’est là que les chemins divergent qui mènent au centre incernable, là où se trouve l’émetteur d’où sourdent, ultimes et vivantes, vaines et irascibles, les voix qui sont la voix.

Contemporain
La spirale, il faut en dire la courbure. Plusieurs étages de la grande spirale de l’histoire et des temps qui la précèdent sont alignés et comme mis en relation depuis le passage du régime des outils et des machines à celui des appareils. Le prix à payer pour être contemporain, - et qu’est-ce d’autre être créateur sinon prendre cette question à bras le corps ? Pourtant, il n’y a apparemment rien de plus éloigné de la poésie de Werner Lambersy que les aspects technologiques de la révolution mondiale en cours depuis plus d’un demi-siècle. On pourrait même dire que tout l’oppose à cela. C’est précisément dans la manière qu’il a de prendre part à ce combat de titans qu’il assume l’héritage dont chacun se passerait peut-être bien mais qui est le seul auquel il ne faut pas se dérober, celui d’une époque devenue folle.
Ainsi ne lit-on aucune plainte dans l’œuvre de Werner Lambersy, plutôt la mise en place progressive des enjeux du combat. : la possibilité pour l’homme de vivre et celle de créer des affects purs. La ligne de partage est étroite entre les devenirs inhumains des formes déclarées ou larvées de dictature et les nostalgies vaines. Entre les deux, les mots. Rien que les mots ? Non, les images et les sons aussi. La poésie est cela, un canevas de mots, d’images et de sonorités mêlés. Le dessin dans ce tapis des prières écartelées et des vœux exaucés est celui des devenirs non humains de l’homme. On y voit des figures impensables. Elles naissent de la voix et constituent la ligne de la création, tous arts confondus.
Mais quels mots ? Quelles images ? Quelles sonorités ?
Résumé : l’enjeu de toute création et de prendre en charge le contemporain en lui faisant face, en s’opposant à lui, en le célébrant. Le contemporain n’est ni ce qui existe à la force des ordres venus d’ailleurs, ni ce qui aurait pu exister si les choses avaient été autres. C’est la chance contenue dans le présent et qu’il ne voit pas, aveuglé qu’il est par ses propres reflets. Le poète est celui qui conjugue la chance du présent pour qu’il s’accomplisse comme destin.
Werner Lambersy a publié de nombreux poèmes dans la revue. Ils sont disponibles aux liens suivants : Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus pour le premier et Départs de feux — I/IV pour le dernier.
Il est possible de passer d’un poème à l’autre en cliquant sur les icones en bas de chacun.

