
Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Robert Musil : du lyrisme dans le roman
Robert Musil : du lyrisme dans le roman
Première partie
,
Je ne traiterai pas de la fameuse ironie de R. Musil...
Formellement :
Je ne traiterai pas de la fameuse ironie de R. Musil qui a déjà été souvent analysée et que l’on peut voir s’annoncer dès le début du livre par la référence à la météorologie énoncée de manière scientifique mais disqualifiée aussitôt par des personnifications et par un récapitulatif amusant « autrement dit, si l’on ne craint pas de recourir à une formule démodée mais parfaitement judicieuse : c’était une belle journée d’août 1913. » Ce début bien connu en reprend de similaires ; chez Scarron par exemple : « le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course et son char, ayant attrapé le penchant du monde, roulait plus vite qu’il ne voulait. Si ses chevaux eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restait du jour en moins d’un quart d’heure… Pour parler plus humainement et plus intelligemment, il était entre cinq et six quand une charrette entra dans les halles du Mans. » ou chez Sénèque (d’après Paul Veynes) : « Déjà le dieu du soleil avait raccourci son trajet, déjà le sommeil voyait augmenter son horaire et la Lune… En d’autres termes c’était déjà octobre… ». J’avancerai néanmoins par ces exemples que, chez R. Musil, ce procédé est moins ironique qu’il n’y paraît, c’est à dire qu’il est moins essentiellement critique. Car, s’il semble être d’abord un moyen d’amuser et de s’amuser par une distanciation, il est peut-être aussi l’expression d’une joie à découvrir dans la formule surannée une justesse tout aussi grande que dans la description météorologique qui précède. Il s’agirait alors, davantage qu’une ironie, du plaisir de voir s’accomplir par la langue et la pensée une sorte d’unité. On pourra remarquer ainsi qu’il sert la description de la ville qui suit, laquelle ne présente aucune distanciation mais au contraire amplifie la présence émotionnelle de la ville par l’emploi de nombreux adjectifs impertinents, de métaphores et d’un phrasé mélodieux caractéristique du lyrisme. C’est ainsi que derrière distanciation et humour, ce roman affirme un lyrisme qui trouvera son exaltation thématique dans l’amour fraternel et l’Autre État.
Pour soutenir ceci, je voudrais montrer que le lyrisme sous-tend l’ensemble du récit par l’intermédiaire des procédés qui lui sont propres ; et que ces derniers lui donnent une partie de son rythme et de sa consistance, ce par quoi ils s’affirment comme des procédés narratifs. Je ne ferai état ici que de quelques-uns qui m’apparaissent intéressants pour ce que je veux suggérer ; il va sans dire que les moyens traditionnels du narratif : composition et personnages, mise en intrigue et succession des actions, … dont il faudrait noter la brusquerie, ne seront pas traités dans la mesure où ils ne constituent pas une singularité narrative, pour le juger rapidement. D’autre part, comme nous avons à faire à un roman qui pour partie est aussi un roman d’idées, la narration se trouve soutenue par le développement des idées qu’articulent nécessairement des liaisons logiques, elles permettent de suivre le raisonnement et entraînent donc la lecture. Il est à remarquer cependant que si l’on trouve manifestement des liens logiques, c’est surtout dans le propos du narrateur et beaucoup moins dans l’exposition des idées du personnage principal Ulrich. Ce phénomène pourrait empêcher le clair développement des idées qui, souvent, s’écrit en style indirect libre où les pensées sont tantôt rapportées indirectement « Ulrich avait pensé simplement que l’eau… », tantôt directement « ne baptise-t-on pas toujours avec de l’eau ? » en un discours que le changement de point de vue allège certes mais ne suffit pas à rendre réellement fluide, ni explicite. Par ailleurs, les idées se poursuivent par de simples juxtapositions dont la logique n’est pas déterminée clairement et reste donc davantage intuitive. Si ceci atteste de la qualité singulière du personnage, cela peut aussi produire un détachement de l’ensemble du récit qui pourrait bien vite être lassant malgré la profondeur du contenu ; on serait alors tenté, afin de poursuivre, de sauter de tels passages si le narrateur n’en re-dynamisait le cours par des comparaisons ou des inversions curieuses qui surprennent et unissent l’ensemble.
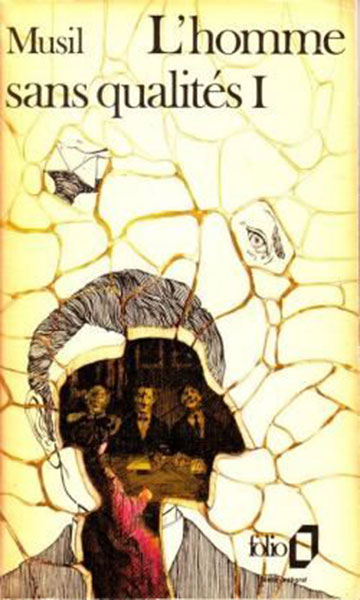
En premier lieu, c’est la place et la curiosité de certaines comparaisons qui remplace efficacement la venue d’une action ou l’intrusion du monde extérieur qui traditionnellement permettent d’éviter le désagrément d’une trop longue rupture du récit. Elles ne sont évidemment pas le seul moyen dont dispose le roman d’idées, l’intrusion du narrateur qui remet de l’ordre, pose les problèmes, les résume, etc. en est un autre dont l’auteur use habilement. Cependant ce n’est pas tant l’idée que cherche plus généralement à développer Musil mais l’homme en train de penser et « il n’est malheureusement rien de plus difficile à rendre, dans toutes les belles lettres, qu’un homme qui pense. » (chap. 28). C’est donc dans cette optique proprement romanesque que l’emploi de tels glissements analogiques m’apparaît éclairant.
Voici l’extrait que je propose donc, c’est au chapitre 28 intitulé : « un chapitre que peut sauter quiconque n’a pas d’opinion personnelle sur le maniement des pensées ». Afin que la dynamique ressorte clairement, j’ai dû citer longuement :
« …il avait pensé simplement que l’eau était un élément trois fois plus vaste que la terre, même à ne considérer strictement ce que tout un chacun reconnaît sous ce nom, c’est à dire les fleuves, les mers, les lacs et les sources. On a pensé longtemps qu’elle était apparentée à l’air. Le grand Newton l’a cru et néanmoins, la plupart de ses autres idées sont restées actuelles. Pour les Grecs le monde et la vie étaient nés de l’eau. C’était un dieu, Okéanos. Plus tard on inventa les nixes, les elfes, les ondines, les nymphes. On a fondé des temples, des oracles sur ses bords. Mais les cathédrales d’Hildesheim, de Paderborn, de Brême qui on été bâties sur des sources, ne sont-elle pas encore debout ? ne baptise-ton pas toujours avec de l’eau ? N’y a-t-il pas des Amis de l’eau, des apôtres du naturisme dont l’âme témoigne d’une sépulcrale santé ? Ainsi il y avait dans le monde un lieu pareil à un point effacé, à de l’herbe foulée (Da war also in der Welt ein Stelle wie ein vervischter Punkt oder niedergetretenes Gras). »
Voici donc cette figure analogique, on voit aussitôt qu’introduite par ainsi, elle doit donner en quelque sorte un résumé de ce qui préoccupe Ulrich : l’élément eau en tant qu’il constitue un lieu peu saisissable . Cependant l’éclairage, la compréhension ne vient pas du rapprochement analogique, il n’y a guère de ressemblance, ou le chemin est trop long pour y parvenir immédiatement à la lecture, mais du décalage, du pas de côté qui consiste à prendre l’eau fluide pour un lieu, un point, c’est à dire quelque chose de fixe ; et à en surmonter la contradiction apparente par une sensation, herbe foulée. Qui ne ressent alors l’herbe mouillée, l’herbe fraîche où l’on se couche, où l’on marche ? Ce qui permet d’avancer qu’en fait, cette comparaison ne fonctionne pas comme une image éidétique mais davantage comme le glissement d’une idée vers une sensation qui l’incarne de manière énigmatique… Car elle fait en quelque sorte contraste comme si l’on trouvait un couteau caché dans l’herbe. Le couteau, c’est à dire la découverte, fait partie de l’inventivité de Musil et l’on pourrait noter combien ces analogies sont originales et justes. Il suffit d’en citer quelques unes au hasard : Agathe : « j’aimerais tant être couché dans un pré, rendue modestement à la nature comme un soulier qu’on a jeté ». « Le bruit ruisselait dans l’air raréfié par la chaleur comme un fleuve qui eut atteint la hauteur des toits ». « Le plaisir sans exutoire retombait dans leur corps et l’emplissait d’une tendresse aussi incertaine qu’un jour d’automne tardif ou une précoce journée de printemps ». Ulrich : « peut-être est-ce simplement comme quand on sent la fatigue : on a besoin d’un panorama qui vous rafraîchisse, ou d’un coup dans les jambes… » Toutes elles possèdent cette qualité de sensualité remarquablement détachée du personnage qui nous fait éprouver par nous-mêmes la sensation ; cette construction de l’image est opposée à l’exemple suivant tiré de Proust : « une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix » (p. 882 La Pléiade tome III) qui fait appel pour comparer à quelque chose de connu, ce qui détache ainsi le propos comme une vérité générale et fait davantage appel à l’esprit commun qu’aux sensations physiques éprouvées par chacun. Chez R.Musil, l’analogie sensible permet de plonger le lecteur dans ce qui se raconte en le lui faisant palper et sentir, et donc en quelque sorte vivre, si bien que concerné parce que touché, il peut mieux lire les raisonnements et s’intéresser moins froidement à leur progression logique. Il est ainsi rendu sensible à la beauté des enchaînements et de leurs circonvolutions. Car si les faits et les idées aboutissent à cette comparaison, c’est qu’il faut leur accorder une dimension sensible, voire poétique et cela peut-être avant tout.
Cependant ce n’est pas la seule efficacité de ce procédé, il crée aussi une dynamique de lecture car en déconnectant le récit de la logique d’exposition, il engendre la curiosité du lecteur et donc l’attente de ce qui suit… Ce qui suit se propose ainsi : « Et bien sûr, l’Homme sans qualité hébergeait aussi, dans un coin de sa conscience, qu’il y pensât précisément ou non, les données de la science moderne. » Suit un résumé rapide de ce qu’on tient pour vrai de l’eau en tant qu’élément jusqu’à la constatation qu’il n’y a guère dans le monde qu’une douzaine de personnes à penser la même chose d’un élément aussi simple que l’eau. Musil expose ainsi deux niveaux de la pensée rationnelle : d’une part l’évocation de l’eau en tant que phénomène animiste (première partie) et de l’autre en tant que phénomène chimique ; ils sont maintenus séparés par cette comparaison énigmatique qui laisse à chacun sa pertinence car elle ne propose aucune progression de l’un à l’autre. Mais la figure analogique a réussi à tenir en éveil et provoquer de l’intérêt cependant que, le couteau restant caché, on attend toujours la suite, c’est à dire sa découverte et son utilisation, on attend donc l’action. Cela se poursuit ainsi : « A ce moment, Ulrich se souvint qu’il avait effectivement raconté tout cela à Clarisse ; elle était inculte comme un petit animal mais malgré les superstition dont elle était pétrie, on ressentait avec elle une espèce d’entente imprécise. Cela le piqua comme une aiguille brûlante. »
A la fin donc, l’auteur rompt le flot des idées par le rappel du temps du récit « à ce moment, Ulrich… » ce rappel du temps puis d’un personnage extérieur n’est rien que de très couramment utilisé par tous les auteurs mais le décalage : « elle était inculte comme un petit animal » outre qu’il interrompt le récit en mettant l’accent sur un point externe au développement attendu, produit par une sorte d’antithèse une surprise, surprise seconde donc après notre petite formule, énigme aussi qui réactive la première encore lointainement présente. On pourrait avancer qu’on y entend dans l’herbe foulée le petit animal, ainsi est-ce l’instinct qui se relie à l’eau pour finir, comme en chacun il est un point effacé qui pique « comme une aiguille brûlante » pique donc la raison, excite le désir ?
Ce qui est dit, a été dit mais de curieuse manière, on le voit, dans une affirmation subtile qui n’est pas assertive, qui évite même toute possibilité d’affirmer une vérité générale mais fait sentir en quelque sorte ce que serait une telle pensée à travers une sensation incarnée par le retour de Clarisse en tant que petit animal. On passe ainsi pour l’eau de l’impression d’une vie enfuie à la présence vivante de quelque chose qui remue. Si l’on voulait faire le résumé du raisonnement on aurait à peu près ceci : certes l’eau est et a toujours été un élément important, la science cependant en fait l’analyse chimique mais n’en donne pas une idée claire tandis que nous la sentons comme une évidence, instinctivement en quelque sorte comme je sens Clarisse.
Que l’on compare à ce passage chez Proust dont les pensées se structurent par l’abondance de subordinations et de relations logiques par exemple (p. 904-905, T3 La Pléiade) : Mais en un autre point de vue l’œuvre est signe de bonheur parce qu’elle nous apprend que dans tout amour le général gît à côté du particulier… En effet, comme je devais l’expérimenter par la suite… si la vocation s’est enfin réalisée… on sent si bien l’œuvre qu’on aime à se dissoudre dans une réalité plus vaste qu’on arrive à l’oublier par instant et qu’on souffre plus de son amour, en travaillant que comme de quelque mal purement physique où l’être aimé n’est pour rien, comme d’une sorte de maladie de cœur. Il est vrai que c’est une question d’instant et que l’effet semble être le contraire, si le travail vient un peu plus tard. Car les êtres… » et cela se poursuit avec beaucoup de mais, certes, dans ce cas, si, car : « tout de même il faut se dépêcher de profiter d’eux, car ils ne durent pas très longtemps : c’est qu’on se console, ou bien, quand ils sont trop fort, si le cœur n’est plus très solide, on meurt. Car le bonheur seul est salutaire pour le corps mais c’est le chagrin qui développe les forces de l’esprit. »
Je pense qu’ainsi on voit bien la différence entre l’aspect peu assertif des idées chez R.Musil et, au contraire l’affirmation insistante de l’exemple ci-dessus dont les circonvolutions, en partie ornementales, visent davantage l’éclaircissement de l’idée que la sensation concrète qu’elle procure. Si R. Musil d’une part narre, il doit donc entraîner mais comme d’autre part, il cherche davantage à faire sentir l’eau comme idée singulière chez Ulrich qu’à établir un raisonnement sur l’eau, il doit rendre sensible ce qu’elle provoque comme sensation chez lui ; il est donc contraint à une transposition qui opérant une rupture dans la progression logique, surprend le lecteur et le fait basculer dans un domaine émotionnel, car « songe que toute comparaison, si elle est équivoque pour la raison, n’a jamais pour le sentiment qu’un seul sens », lequel sera repris par l’évocation de Clarisse-animal afin d’en donner la pulsion instinctive.

Il reste que la comparaison par son aspect poétique entre en jeu dans la narration et se place comme articulation entre deux passages. Elle évite ainsi de manière efficace les procédés habituels de liaison qui font peut-être une trop grande part soit à la raison, soit, rapportés à un personnage, à la psychologie. D’autre part, elle ne se place pas seulement entre les passages mais se poursuit en dessous de ceux-ci comme une curiosité parce que décalée ; si bien qu’elle résonne à la lecture et, de ce fait, se relie à d’autres décalages analogues pour construire un discours de deuxième plan qui revient sur le devant lorsqu’une figure analogue apparaît. On aurait là quelque chose d’une rythmique dont toute narration a besoin, soit qu’elle le fasse par des paragraphes, des bouclages de propos, des sommes ou péroraisons, soit par bien d’autres procédés : retour de personnage ou d’intrigues, thèmes récurrents, et motifs, et variations... On trouve chez Flaubert dans « Un cœur simple » par exemple des passages à la ligne qui s’apparentent à une versification et remplissent ainsi une fonction rythmique analogue… Le rythme scande le récit dans l’avancement de la composition générale, il est proche d’une respiration et se détache quelque peu de la tension permanente du développement des actions, idées ou intrigues ; pour tout dire, il semble qu’il repose le lecteur, et l’écrivain probablement, de la lourdeur de l’intellection tout en les réassurant dans le fil général. Cependant chez R. Musil, ces retours s’ils font résonner la langue, font ainsi état d’un ailleurs dont ne parle pas toujours le récit (surtout dans sa première partie) ce que déjà implique le passage à l’analogie, aux comparaisons ou aux métaphores. Cet ailleurs est de l’ordre sensible, c’est ce qui motive le récit dans le sens où celui-ci est une mise en ordre d’un état particulier : penser autrement. Si H. Broch dans la Mort de Virgile avait de même essayé de montrer l’homme en train de penser, il avait usé d’une rythmique toute différente avec beaucoup d’amplification de la phrase ainsi que des thèmes jouant abondamment des répétitions et reprises tel qu’ici sur le reflet d’une bague, p. 408 Imaginaire Gallimard : « elle était maintenant comme un scintillement…, elle était un souffle exalté comme un souvenir… parcouru d’un flot de largeur, de hauteur et de profondeur, parcouru d’un flot de temps, parcouru d’un flot de douleur, d’un flot douloureux de brûlure et de gel ; parcouru lui-même d’un flot de souvenir, ce sourire stellaire… doucement apporté comme l’écho, comme l’écho plaintif d’une réceptivité bénie. » Le lyrisme ici, on le voit, est de l’ordre du ressassement car c’est l’amplification d’une intériorité qui est en jeu. R. Musil au contraire évite toute amplification pour rester dans le concret de la sensation fugitive et émouvante de l’eau et de Clarisse qui constitue le fond primitif à partir duquel se motivent les pensées du personnage qui sans cela relèveraient davantage de l’abstraction argumentative ou du flot de pensées intérieures. Il ne garde du lyrisme que la comparaison et le rythme et on pourrait avancer qu’il n’utilise que très peu l’analogie de type romanesque qui vise à éclaircir en créant une égalité entre le comparant supposé connu du lecteur et le comparé du récit nécessairement inconnu, pour se porter sur l’analogie poétique qui, parce qu’obscure, fait en quelque sorte image et ouvre ainsi la voie au sensible.
En fait, pour conclure sur cette partie, ces comparaisons isolées suscitent tout d’abord la surprise, et donc dynamisent le récit en permettant des changements rapides de point de vue, elles créent ensuite une attente qui maintient en tension les différents propos et, enfin construisent un plan second qui affecte le texte des images concrètes qui le motivent.
Notations et pages tirées de la version en quatre volumes, traduction Philippe Jaccottet, publiée chez Folio.

