
Accueil > Les rubriques > Cerveau > Profession de foi
Profession de foi
Cinq extraits du dernier livre de Jacques Cauda
,
Cinq extraits du livre Profession de foi de Jacques Cauda qui vient d’être publié par les éditions Tinbad.
Premier extrait
Moi cauda du latin cauda « la queue » car malsain de corps et d’esprit et malsain de queue dit cauda dit aussi le vénéneux moi qui ne crois qu’au mal car malsain de queue au bout d’un corps qui ne croit en rien ni au nom du père ni au sain d’esprit moi au nom du fiste je dis ici en toute innocence que je suis comme la flèche du Parthe décochée à cheval sur la queue du cheval c’est-à-dire en cauda forcément venenum
Une fois il était une fois deux fois qui sait la guerre et c’est pourquoi le Parthe est monté à cheval sur le dos du cheval qui va vers l’avant loin devant mais poursuivi par un autre un non-Parthe qui poursuit cauda qui galope sur son cheval qui galope car c’est la guerre se dit-il avant de se retourner d’un bond gracile vers l’arrière afin de décocher sa flèche là dans le cœur de l’autre qu’il regarde tomber mourir en tombant cadaver dit-on en latin cadaver & cadaverina autrement dit charogne
Si seulement si c’est dire la condition humaine ou non du nom car il s’agit aussi d’un cheval et d’une queue deux peut-être qui sait celle de cauda et celle du cheval que monte le venenum l’autre est mort la guerre serait finie si seulement si ce n’était plus la guerre mais il y a d’autres autres qui galopent vers moi qui suis malsain de corps monté sur mon cheval car c’est comme ça comme infinie la guerre
C
L
E
C’est la clé de l’histoire qui a commencé comme suit cauda est poursuivi par un cheval monté par un autre ce cheval est aussi malsain qu’il l’est car il est aussi capable de se retourner en galopant vers l’avant afin que l’autre soit tué d’une flèche une seule décochée par lui cauda qui croit se retourner alors que c’est son cheval qui est aussi le mien

Deuxième extrait
Ce matin en fouillant dans les traces laissées par mon passé, j’ai retrouvé quelques éclats d’un film que j’avais tourné en 1975. En 16mm, noir et blanc, un court métrage d’environ 15 minutes dont j’ignore ce qu’il est devenu. Il ne m’en reste qu’une feuille de papier qui dit à la fois peu et beaucoup. Une feuille où se lit le commencement de mon film oublié…
Décor : une scène de théâtre filtrée dans son entier par un voile de crêpe noir agité par le vent.
1. Plan d’ensemble plongé de la scène.
Au fond, dans la pénombre, une femme se tient de dos et monologue. Ses paroles couvertes par le vent et les frémissements du voile sont difficilement audibles :
vide… déplacé… loi… caché… ton regard… premier mensonge…
2. Panoramique vertical de haut en bas, puis travelling avant très lent jusqu’à un plan moyen (large) sur la femme.
Chute du voile pendant la fermeture au noir.
3. Plan serré sur la femme qui est nue couchée sur la scène.
On entend une voix dire : « Je me tiens devant Dieu et j’ai été envoyé pour vous parler … »
4. Gros plan sur le sexe de la femme.
Cadrages et déplacements sont subtilement accordés à la mécanique du désir, à son excitation comme à sa rétention.
5. Travelling arrière très lent…
La voix (tout doucement) :« Vous voyez comme tout est simple. »
6. Fermeture au noir.
La femme, dont j’étais amoureux et avec qui je vivais dans un studio du XIIIe arrondissement, jouait le rôle de la femme. Je faisais la voix.
Au-delà de la tendre naïveté qui enveloppait chacune de ces images et les troublait précisément de par leur innocence, la beauté de mon amoureuse nue se masturbant sur la scène fut le pourquoi de mon film. J’avais souhaité qu’elle se caressât sur l’air qu’il y a dans la Passion selon saint Matthieu de Bach : Blute nur, du liebes Herz. Mélodie que j’avais choisie parce qu’elle préfigure la forme préférée de la musique post-classique, c’est-à-dire la phrase de huit mesures, dans laquelle une figure est répétée, puis suivent deux variations de cette figure et, de nouveau, elle est répétée. Répétitions qui annoncent la musique dodécaphonique qu’on peut résumer par cette phrase de Kierkegaard qui m’est chère : « La répétition, voilà la réalité et le sérieux de la vie. »
Mon désir, à la relecture de ces quelques plans, les imagine autour du cou d’Olympia attachés en un petit ruban de lumière noire. Et de regarder Cézanne (Une moderne Olympia) regarder Manet…
Le cinéma, c’est une chose très simple : c’est quand la caméra tourne, a dit Jean Eustache, comme le rappelle Jean Durançon dans son article sur L’ombre des femmes de Philippe Garrel.
Oui, vous voyez comme tout est simple.

Troisième extrait
Nous partîmes quelques jours. Près de Chartes où je voulais la filmer. Inoubliable, chérie et redoutée, Chartres dans les jupes du ciel retroussé. Demeure de La Vierge sur Terre. Grandes lèvres de pierre, vagin de lumière. Toison dorée. Par le portail central au tympan duquel Elle trône en majesté. Chartres, c’est Sa maison, quand on y entre tous les verbes se mettent au présent, présent de l’indicatif et présent de soi : je me donne. Je ne m’appartiens plus. Je suis au cœur du gai savoir du vide. Léger. Le charbon de mon être passe à l’or, du noir à l’urine : je m’inonde ! Je ne m’aime plus, j’aime. Je dis quelques mots secrets à moi-même et en moi-même. Je m’arrête à la petite chapelle Notre-Dame-de-Sous-Terre, je prie. Longuement. Puis, je sors au septentrion et je regarde encore une fois Ses perfections, sur les voussures du portail nord, le triomphe des sages sur les folles, et les douze figures de femmes qui ornent Son âme.
Moteur : « Marie passe la main dans ses cheveux qu’elle a blonds jusqu’au milieu du dos. Splendeur. Maison d’âme. Délectation. Bouche bée sans limite, j’élargis mon être. Perle, rouge à lèvres, bustier, mini-jupe, bas noirs et talons aiguille. Je la regarde comme le feu mange la paille Ça va commencer. Quelques pas dans l’allée du jardin et la voiture démarre. Destination ? La ville… Du monde… La clameur et marcher… Elle devant, moi derrière à une vingtaine de pas. Je marche en fascination, elle en sorcellerie. Je marche avec des paroles agissantes, je dis : “Je brûle le mal en mon sein”. Je dis aussi plus sereinement : “Rien n’est plus spirituel qu’une femme en corset”. Elle trottine. Les passants se retournent. La sifflent. Ce sont des servants. Elle secoue ses cheveux. Ses seins dénudés jusqu’aux pointes, ils y pensent : 95 bonnet C ! La route de l’idole est en eux. Moi, derrière, je garde le sentier de ma rectitude, je suis un buffle attaché à la ceinture de ses hanches, je suis son cul qui crie au fou qui désire !
Elle s’assied à la terrasse d’un café. Il fait beau, l’air est clair, elle commande un café, elle dit : “Un café allongé”, en croisant les jambes si haut qu’on voit au-delà de la lisière de ses bas. Moi, accoudé au bar, je joue l’indifférent, je voile ma face par mes mots, je ne dis pas : “Je l’ai amenée ici afin que tout soit montré !” Je commande sans donner la main à mon exaltation, je dis au garçon qui regardait ses seins, ses bas, ses cuisses, sa bouche comme une cour intérieure qui fait transpirer : “Toi qui comptes mon errance, je te paie les mercis”. Je module. Pendant qu’elle continue la pose en terrasse parmi les assaillants, les crocodiles, les oppressés et qu’elle putasse avec persistance, je fais de mon mieux, accoudé au chorège, avec musique, chant et poème, je dis : “C’est ma blessure, elle me bouleverse et je m’épanche !”
Elle se lève (ses chérissants semblent annulés, ils raconteront plus tard à leurs fils, leurs pères, leurs semblables, que sais-je encore, je ne m’en soucie plus), je marche derrière elle jusqu’au dénouement. Jusqu’à la forme a priori du bonheur le plus parfait. Elle y acquittera mes vœux, mon désir tendu sur elle comme le cordeau sur la pierre.
On y est. Je me cache un peu derrière un buisson parmi tous les rameaux, les arbres, l’herbe posée sur la terre, et je demande une branche, pour qu’on ne me voie plus. Elle s’est assise sur le banc.
C’est un matin d’été, les promeneurs sont encore peu nombreux, certains traversent le parc, pressés sans faire racine, ils passent ; d’autres musent, badent en rêvant derrière leur chien. Il y a aussi quelques couples qui ne s’attardent pas sur la belle qui attend l’élu pour jouer l’égarée. Je dis : “Montre-toi, je te la donne à voir mais ne t’illusionne pas, elle est la ligne, tu n’es que le poisson”. Le voici. Il vient. Il approche. Il a la soixantaine, un brin dégarni, un pantalon de toile claire sous une chemisette à carreaux. Est-ce un signe ? Oui. Je vois déjà sur lui le souffle de mon propre chérissement. Il sera consacré, et sa vie déposée, là, ici, devant elle (éparpillée, humide, splendide, butin grand ouvert). Il reste sans bouche comme quelqu’un qui mangerait sans nourriture. Et moi pareillement comme un veau pâturant sous la grêle…
Au retour, c’est moi qui conduis. Vite. Les dents serrées, sans un mot. Au dernier feu (la ville s’efface derrière nous) j’ouvre la boîte à gants. Je les passe et j’accélère, avec l’impression de racheter mon tort. Ils sont en cuir noir, et sans rémission. C’est pourquoi je dis : “Alors, tu as encore tout montré au vieux, tout, ta débauche, ton sillon, ton œillet du doigt enfoncé jusqu’où ? Dis ? Dis tout ! Dis-le comment tu as dégagé pour lui ton bouton et tout écarté pour l’amour de toi !” À cette vitesse (je dis en même que je lis : 135) c’est vite la campagne, les champs de chaque côté d’une petite route à lacets, puis la forêt. “La forêt ! Tu entends !” Les pneus crissent. Je prends brutalement à droite un chemin de terre qui s’enfonce sous les arbres. J’y roule toujours avec vitalité, certes, mais dans la caresse et la splendeur des feuilles ; et tandis que dans ma poitrine remonte ma rumination, je dis d’une voix qui rabat tout d’un seul coup : “Descends !” Elle est là debout impassible comme une borne, campant son opprobre sans frémir (elle s’innocente) quand j’arrache ses vêtements. Ne restent d’elle que sa chair, ses bas, ses perles et ses talons aiguille : elle est nue, elle triomphe. Je lui dis d’avancer là où il n’y a ni sentier ni rien, là où on touche la foison qui rampe sur la terre, là où le vert n’est qu’une ronce sans gazon. “Va !” Elle vacille, toujours la tête haute (ses cheveux crochent aux branches et ses jambes à l’épine). Elle vacille. Son cul d’or à la folie me rend âne et milicien, la cravache à la main gantée, je frappe, j’ajoute à sa tourmente, je frappe, vingt, trente fois, à chaque pas, chaque mètre, où elle menace à chaque coup de tomber. Je frappe en ordre de jouir ! (Elle est toute ma guerre). Je frappe jusqu’à L’arbre, le nôtre, le chêne du rendez-vous, l’arbre faiseur de bien : il a cent yeux de hauteur ! Je l’attache, les mains hautes (à la première branche qui surplombe sa tête), ses cheveux d’or qui coulent sur ses reins. Son ventre et ses seins collés à même le tronc, et j’entre en elle comme en plein midi. »
Mon ambition était de la laisser telle quelle, ligotée au tronc, moisir en solitude dans le noir si noir de la forêt. Et de rouler vers Paris l’âme pétillante. L’ai-je réalisée ? Qui sait ? Aujourd’hui, il y a le film, un court métrage 16mm couleurs de 16 minutes et 33 secondes, intitulé Le trou de la Vierge. En hommage à Philippe Sollers.

Quatrième extrait
Madame Avon. Les premières s’inscrivent au cœur du verger tel un arbre plein, telle une poutre tenant la mémoire par la main où tracer un trait sur le néant. La première que j’ai aimée physiquement était bien plus âgée que moi. J’avais treize ans et prêt à donner ma bouche à la nouveauté, ma puissance naissait et mon souffle cherchait sa première messagère. Ce fut une vieille femme de trente-cinq ans qui vendait des cosmétiques. Son commerce (le porte à porte) la désignait par le sort. Qui ne l’avait rêvée, chérie en imagination et baisée pour de bon ? Tous avaient crié son nom, servi son cul et gardé son cœur appuyé sur le leur. Effrontée, elle ne cachait rien de ses convoitises et de son désir de copulation. Elle postait son être à l’endroit des hommes qui bandaient. Tout lui était connu, elle appartenait au foutre.
Nous habitions le même immeuble, signe prodigieux pour ma vigueur déjà visible et résolue et déjà prisonnière du bruit cadencé de ses talons montant l’escalier. De son cul, de ses seins qui sautaient, immenses, et de sa bouche toute-puissante, exacte, et conforme à la logique de ce qui se passait en moi quand je la croisais. Mais j’étais enfant et mélancolique. Je n’osais pas. Je n’osais pas connaître l’entière exactitude du lien qui m’agitait, laminait mes nuits d’images, de formes à demi vives, faites de cet argile infaçonné qui est propre au puceau. Celui qui pense à tout contre tout espoir d’y parvenir, qui dit pour (ne pas) faire… mais quand ? Quand passer ses doigts sous sa jupe jusqu’à la fente, rouler les yeux de l’extase en se léchant la bouche et la renverser d’un coup ! À l’évidence, qui chuchote ainsi en sous-sol se voit souvent exaucé. Il y a enfin un jour, une heure, un endroit, où nantir sa dette envers la parole d’où il vient et donner forme d’homme à son chuchotement.
Son appartement lui ressemblait. Il la réalisait, justifiait son âge et frappait le visiteur comme une botte de chicotins rend amer. Mais j’en dis déjà trop ! Ordonne-toi et reprends tes dires : elle était belle, songe parmi mon rêve qui l’approchait, assise dans un grand fauteuil usé mais arrogant, où elle multipliait ses jambes, ses cuisses, poussant sa culotte du crépuscule vers le jour, une culotte de dentelles noires, oisives, alanguies, en quête de mains buissonnières. Le cœur contemple ce qu’il souhaite ! Et rien de ce qu’il avait souhaité ne lui manquait, à rêve fidèle, réalité d’exception, elle ouvrit grand les cuisses. Je m’y jetais comme le pauvre sur l’or, la faim sur le pain, j’y portais mes lèvres, mon souffle, mon sirocco, ma langue… et mon dégoût ! Son vagin sentait le hareng, le yaourt vieux d’un siècle et l’espérance trompée. La fosse. Et l’ordure. Du lieu où je la gobais, la bouche plaquée, le museau pris dans ses mains fiévreuses et ses sifflements : « Sssalaud ssssssalaud petit ssssalaud », j’en vins, relevant la tête, au cercle supérieur, principat du terme : voir, cette essence du savoir. Je vis ! Je vis cette femme. Ensuite je la vis se déshabiller, découvrir sa terre d’ombremort. Montrer ses seins défortifiés, nus, désolés, mous, flasques, décrépits, paraboles de tout ce qui coule, rampe et dégueule. Ils inspiraient le vomir jusqu’à la calomnie. Ses cuisses vergetées et ses pieds déchaux, puis son cul déballé, elle dit : « Finis-moi, comme ça ! » À quatre pattes, les reins tendus, suppliants. Tristes sales flaques de la couleur d’un bouge de la couleur du gris très gris.

Cinquième extrait
La langue grecque puis latine traita le problème de l’écriture vraie du Livre comme graphe d’un recouvrement fondé sur l’homonymie du visible et de l’invisible, de l’ancien et du nouveau.
Marie-José Mondzain, Le commerce des regards.
Par le truchement du rêve, le sommeil m’apparut cette nuit-là comme l’un des meilleurs moments à vivre à deux (Juliette était rentrée), dans cette douceur des corps devenus cinématographiques et qu’on entend marcher pieds nus dans sa tête. Les corps au cinéma sont des images de la langue que nous devenons dans nos rêves. Et des images qui, pour muettes qu’elles sont, s’entendent marcher pieds nus, et sans autre effet que celui du langage. Exemple : « la nudité a créé le mot “femme” à son image ». Ses fesses étaient contre moi qui rêvais qui l’embrassais dans le cou. Plus loin, les yeux de plus en plus enfoncés dans mon rêve, je l’entendais poser ses cheveux sur mon ventre, en même temps que sa bouche m’apparaissait comme posée sur une table recouverte d’une nappe blanche derrière laquelle des couches épaisses de couleur appliquées les unes sur les autres, et dont l’effet transpirait de dessous en dessus, m’emportaient au fil du rêve dans un souffle nouveau devenu nuage où je me réfléchissais à la manière d’une couleur sur un miroir.
Au réveil, ce matin-là, aucun de nous ne petit-déjeuna sauf un café noir électrique pour moi qui restais couché pour admirer Juliette aller et venir toute nue trottinant sur ses talons aiguille. J’avalai mon café vite fait et tendis la tasse à Juliette qui la reprit en m’embrassant. Sa langue (docile servante de mon esprit : avale et tu verras) cherchant et recherchant à travers moi toutes sortes d’aventures, dont celle de déposer respectueusement une hostie consacrée sur son cul. Un peu plus tard, dans la matinée, je me souviendrai de cette image : pourquoi et comment étais-je passé de la table de mon rêve recouverte d’une nappe blanche à la table eucharistique ?
Notre appartement était en L. Sur la barre horizontale, orientée à l’est, il y avait notre chambre. Sur la verticale, reliées par un long couloir, la salle à manger et la chambre d’amis qui s’ouvraient sur une grande terrasse où Juliette se dorait dès les premiers rayons. Maintenant, il serait assez malin que vous dessiniez mentalement ce L en partant du bas avec la sensation de monter avec lui. Vous y êtes ? Passez la porte d’entrée et le vestibule où deux fougères se faisaient face. Savez-vous ce que c’est que de faire la fougère ? Passez la chambre d’amis et regardez la salle à manger ouverte sur la terrasse. Les fleurs. Des œillets. Des blancs, des rouges et des roses, dont certains étaient déjà ouverts en cette fin du mois d’avril. Savez-vous comment on dit aussi « œillet » en anglais ? Eyelet-hole ! Il y avait aussi du jaune : coréopsis, œnothère, hélianthème et achillée. Le jaune est la couleur de l’éternel retour, des narcisses de printemps aux feuilles de l’automne (du bois jaunissant). Du citron, du soleil, des pigments biliaires et du petit pan de mur. Chez l’animal, le jaune s’oppose merveilleusement au noir : souvenez-vous de notre guêpe ! C’est aussi la couleur du gai savoir, « sur l’arène unie des cieux, j’ai vu le soleil qui t’emporte ». Pour le bleu, il y avait la scabieuse (encore en bouton), herbe des sables et des rocailles aux capitules bleu mauve utilisée autrefois contre la gale… irruption scabieuse…lésion scabieuse… du latin scabies « gale » « scabreux », etc. Le vert était donné par une vigne, un lierre, un buis et du thym. Le vert est le fond de la nature parce que le vert se marie facilement à toutes les autres couleurs du spectre solaire dont la combinaison est le blanc. Question : le corps porterait-il le blanc de la fiction qui le divise ? Maintenant, revenez dans la salle à manger et remarquez le compotier sur la table empli d’écorces d’artichauts blancs de Jérusalem que Juliette conserve soigneusement chaque été. Ensuite, prenez le couloir et rentrez dans la chambre où j’étais encore couché, rêvassant comme si j’entendais en moi-même une foison de lettres vivantes gazonner dans ma tête. Pourquoi ? Parce que vous y aurez vu Juliette tenir ses mains fermées et les ouvrir pour montrer qu’elles ne contenaient que l’air envolé du matin.
Et le pourquoi de son voyage.
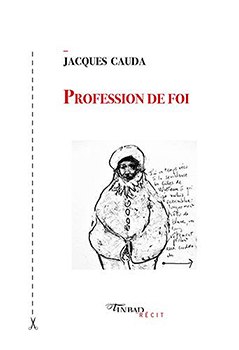
Profession de foi Jacques Cauda
Prix : 18,00 €
ISBN : 979-10-96415-23-6
Broché
Dimensions : 14,0 cm × 20,5 cm × 1,3 cm
Éditions Tinbad
127, boulevard Raspail - 75006 Paris
contact : editions.tinbad@gmail.com
https://www.editionstinbad.com
Illustrations : © Jacques Cauda
