
Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Naufrage
Naufrage
,
« I want people who don’t understand art to understand what I am doing. Hmm… Hmm… » Ai Weiwei
Régulièrement, les artistes se mirent dans l’actualité du moment et dans un vertige, tentent de transvaser son éclat, aussi sombre soit-il, dans leur pratique. Animés d’un sentiment éthique qu’ils estiment sincère, ils se consacrent à l’étude de l’horreur disponible sous leurs yeux. De plus en plus bref, ce signal à destination de tous, se fige dans la dureté cristalline des réseaux sociaux. Et puis retour à l’ombre, au secret des images inexposées. Il n’est plus nécessaire d’exposer une œuvre dans une galerie ou un centre d’art. Le fracas en ligne suffit. Un court instant, cette vague fracassante emporte tout avec elle. Cette forme d’apparition balance entre le tweet (surtout ne pas se laisser surprendre, humer le vent, scruter le flux ininterrompu des sujets et des motifs comme autant de manœuvres maritimes) et cette vieille chose nommée « inspiration ». Les zélotes de la modernité se sont suffisamment gaussés : « Créer dans le feu du moment ! Se lancer sans une once de réflexion préalable ! » Aujourd’hui, l’attitude obligée se moque de pareilles précautions. Visible dans l’espace médiatique, elle revêt décomplexée des frusques un peu poussiéreuses, un peu torchées : une perduration en somme, un avatar de sentiments très anciens. L’inspiration ? Un éternel Halloween, une célébration païenne de défis numériques. Pas de petit bras, en avant.
Je me penche sur les derniers travaux d’Ai Weiwei largement repérés sur la toile. D’une part, la photographie où il simule (ici, le mot résonne terriblement) la noyade de cet enfant, Aylan Kurdi, sur les rives de Lesbos et d’autre part, l’installation au Konzerthaus de Berlin aux colonnes doublées de 11000 gilets de sauvetage.
L’emballage des six colonnes classiques par une épaisseur, une doublure de poches ocre rouges s’appuie évidemment sur la technique de l’accumulation inaugurée en 1960 par Arman. Elle est devenue au fil des décennies une convention sculpturale et dernièrement les installations de Thomas Hirschhorn, Fabrice Hyber, Jason Rhoades en ont largement usé. Selon des intensités différentes, Ai Weiwei a de nombreuses fois succombé à cette organisation spectaculaire, conscient comme l’écrivait Sigmund Freud que l’accumulation met fin à la sensation de hasard. En effet, si dans la réflexion humaniste d’Ai Weiwei, un objet nu, isolé témoigne pour l’ensemble, cet objet est organiquement lié aux autres, tous différents, tous semblables, et l’ensemble joue de concert une suite processionnaire inouïe. En 2009, Rememoration était composé de cartables multicolores recouvrant la façade d’un bâtiment, produisant un monument éphémère consacré à la mémoire d’enfants écrasés par l’effondrement d’une école. Un an plus tard, un nombre incalculable de Sunflower Seeds recouvraient le sol de la Turbine Hall à la Tate Modern.
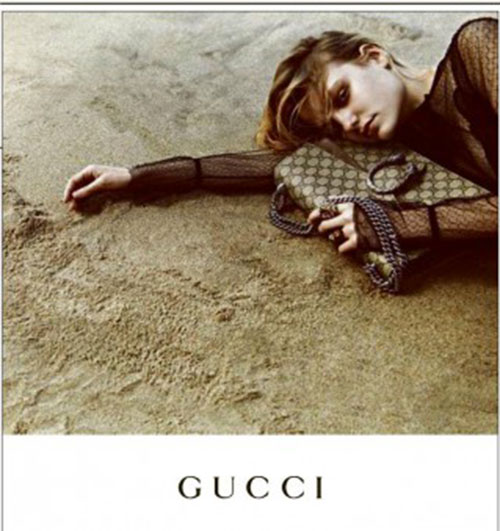
Grâce à sa verticalité exaspérante, ses qualités chromatiques, Rememoration faisait tableau, quant à Sunflower Seeds, elle invitait à l’immersion, selon une approche bien connue de certains commissaires d’exposition. Dans une ambiance à la fois triviale et sacrée (le bruit discret sous les pas, le silence, la douceur de chacune des graines réalisées en céramique, technique récurrente chez l’artiste en tant qu’hommage à l’artisanat populaire et à la civilisation Ming), un espace se dessinait autour et avec les spectateurs. Doucement, elle les enrobait convoquant des expériences collectives (on joue, on parie avec ces graines à défaut de pièces de monnaie) et des pratiques individuelles (le renfermement sur soi, la rêverie opérée par l’exercice de la manducation). La boucle était bouclée. Citation baroque et sévérité formelle faisaient corps, relâchement contemplatif et organisation marchande.
Aussi tragiques que furent les événements à l’origine de telles installations, nous réagissons face à elles, blasés que nous sommes, avec calme et objectivité. Nous décryptons patiemment leur organisation formelle. Nous avons derrière nous une longue tradition d’œuvres engagées, de Manet à Richter, et les témoignages contemporains peuvent difficilement rivaliser en horreur avec les gravures de Goya. Le projet Politics/Poetics de Catherine David (Documenta X, Kassel) a fait date. Depuis lors, cette organisation duelle s’est bien souvent échafaudée au détriment du poétique. L’Histoire est à méditer dans son ensemble, odyssée nocturne à travers les époques, et cela comme le signale Georges Didi-Huberman dans son dernier ouvrage [1], grâce à un enfant « fût-il déjà mort ». Si l’esprit qui anime l’action d’Ai Weiwei simulant la noyade d’un enfant rejeté par la mer est à rapprocher de la sombre intuition de Didi-Huberman, la photographie usitée par l’artiste chinois pour restituer ce drame est irrecevable. D’ailleurs, la publication de la photographie d’origine fut elle-même sujette à polémiques et la rédaction du quotidien Le Monde, dans sa décision finale de la porter à la connaissance de tous, fortement critiquée. Certains observateurs allèrent jusqu’à noter que la publicité Gucci représentant une Top Model et son sac à 3000 euros échoués sur un carré de sable, imprimée quelques pages plus loin, était le signe d’une irresponsabilité consacrée, un lapsus révélateur.
Comme si toutes les photographies diffusées dans un tel contexte, n’étaient pas impardonnables. Le Monde s’applique-t-il à analyser l’actualité (les heurts bancaires, les crises financières) ou à promouvoir un LifeStyle ? Comme si toutes les images publicitaires n’avaient pas retenu depuis les années 1980 la leçon de Toscani : la représentation d’une certaine forme de dépression est nécessaire pour diviser le spectaculaire marchand, le dialectiser, et le maintenir in petto au plus haut de sa forme, image acheiropoïete, magique et dans ce cas cyniquement régénérante. Et enfin, comme si revenant à la photographie d’Ai Weiwei, l’innommable pouvait revêtir, via l’activité artistique, une valeur iconique en mesure de troubler l’imaginaire collectif, n’était-ce qu’un court instant.
De plus, si cette image est insupportable, c’est qu’elle entre en résonance avec un interdit ayant opéré à plusieurs moments de la culture méditerranéenne : « L’eau est un élément séparé de ce monde-ci, mais ouvert sur l’au-delà et saturé de sacré, de dieux et de démons, dans toute la méditerranée antique [2]. » Un inconscient de la vue, pour reprendre l’expression de Walter Benjamin, a-t-elle traversé les époques pour nous hanter toujours et nous interdire la représentation du corps du noyé ? Pour le citoyen romain, celui-ci n’avait plus d’identité, soit parce que le séjour dans l’eau l’avait rendu méconnaissable (double malédiction pour ceux qui gardaient l’empreinte du visage de leurs ancêtres de devoir recueillir une dépouille défigurée), soit parce qu’ayant été rejeté loin de chez lui, nul n’était en mesure de le reconnaître. Hors du champ politique immédiat et de l’horreur vécue par ces milliers d’êtres fuyants, un élément anachronique s’est donc insinué. La noyade, le corps rejeté loin des siens revêt alors une angoisse supplémentaire. Au XIXe siècle, le pourrissement avancé des corps repêchés était un argument majeur pour clore le plus rapidement possible les enquêtes de police. Le noyé ne bénéficiait pas des mêmes droits que les autres personnes signalées disparues.
Si Ai Weiwei se met en scène de manière photographique, brisant un vase précieux, brandissant un doigt vengeur devant les monuments officiels chinois, s’il se donne à voir sous les traits hyperréalistes d’un mannequin censé le figurer lors des différentes stations de son internement politique, il ne peut décemment pas apparaître comme un enfant rejeté par la mer, sur le rivage de Lesbos. D’une part, ce n’est pas anecdotique, Lesbos a suffisamment recueilli en son sein d’épopées funestes. Dionysos en plein délire extatique y appelait à la dévoration de ses congénères : « À Chios, à Lesbos, à Thénédos, Dionysos est affamé de chair humaine… [3] » D’autre part, dans le contexte actuel, rares sont les œuvres en mesure de ralentir le fil de l’Histoire, de dérouter les médiatiques, et surtout pas une image ! Naïveté de penser que l’action artistique est suffisante, qu’il suffit de s’engager dans l’érection allégorique [4]. Si les images se répandent (virales, exponentielles), elles le font sur le mode de la réaction dont la sinistre grammaire est, de toutes les façons, dictée par l’appareil idéologique du moment. Signifiants flottants, elles revêtent rarement des qualités divinatoires, des agencements en mesure d’excéder l’événement. Au contraire, elles stationnent mollement à côté de lui et par conséquent, elles ne lui sont d’aucun secours.
Post-Scriptum : Durant l’écriture de ce texte, l’exposition de Martin Le Chevalier à la Galerie du Dourven m’est revenue à l’esprit. En 2015, son titre Le jour où ils sont arrivés avait valeur programmatique. Malheureusement, la galerie du Dourven après plus de vingt années va cesser ses activités. Après le décès du regretté Didier Lamandé avec qui j’eus la chance de mener un projet en 2005, vérifiant son attention, sa sensibilité, les expositions à raison de quatre fois l’an ne se poursuivront plus.
Dans un contexte politique où les notions d’investissement et de recherche sont largement mises en avant par les élus, il est curieux de noter que ces derniers semblent ne pas avoir clairement cerné les enjeux de l’art comme phénomène collectif et de la création comme espace démocratique. Imaginons une région sans université, sans séminaire, sans laboratoire… Poursuivons. Fermeture des établissements, renoncement des étudiants et des jeunes artistes, exil générationnel. Des analystes compétents en font déjà cas.
Si les politiques locaux désirent que la culture se joue uniquement entre les capitales, s’il désire que Paris communique avant tout avec Londres et Dubaï (selon une géostratégie bien souvent fantasmée), non plus avec Rennes ou Bordeaux, qu’ils poursuivent ainsi. S’ils désirent se consacrer uniquement à une politique patrimoniale (par ailleurs, assez peu offensive), leur action mènera tranquillement mais sûrement à la conclusion du roman La Carte et le Territoire [5] : une province folklorique, un pittoresque troué de poches béantes, de no man’s land humains.
Notes
[1] Georges Didi-Huberman, Sortir du noir aux Éditions de Minuit, est une lettre adressée à Laszlo Nemes, réalisateur de Le Fils de Saul, grand prix du Festival de Cannes en 2015.
[2] Pierre Cordier, De la noyade en Grèce et à Rome, in Corps Submergés, corps engloutis, Éditions Creaphis, Paris, 2007.
[3] Marcel Detienne, Dionysos mis à mort, Éditions Gallimard, Paris, 1996.
[4] « Pour ma part, je reste à l’intérieur de ma grotte et je reçois des images du monde extérieur, que je dessine ensuite. » Adel Abdessemed cité par Hans Belting in Adel Abdessemed, Éditions Manuella, Paris, 2016.
[5] Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, Éditions Flammarion, Paris, 2010.




