
Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Debord / Decept — IV/V
Debord / Decept — IV/V
Images, textes et dispositif de la conscience historique dans l’œuvre de Guy Debord
,
Dans une note, intitulée Sur In Girum, datant de décembre 1977 et qui servit de base à l’Apologie qu’avait commencée d’écrire Guy Debord dans les derniers temps de sa vie, il écrit : « Mais l’eau du temps demeure qui emporte le feu, et l’éteint. »
Quatrième partie : Les formes de la croyance
1. Fleuve et feu
Dans une note, intitulée Sur In Girum, datant de décembre 1977 et qui servit de base à l’Apologie qu’avait commencée d’écrire Guy Debord dans les derniers temps de sa vie, il écrit : « Mais l’eau du temps demeure qui emporte le feu, et l’éteint. »
Ce double registre métaphorique lui permet de dire les formes de la disparition en opposant l’eau, signe de l’écoulement et du temps, au feu signe de l’éclat et de l’instant.
Pour en mesurer la puissance effective, il est nécessaire de retourner ces métaphores sur les formes de vérité qu’ils désignent. Leur articulation correspond en effet bien sûr à l’univers de Guy Debord, mais surtout à son époque.
Un nouveau partage s’inscrit dans la chair de la société et de la pensée. Il s’opérait sur la base d’une opposition entre être, avoir et paraître. C’est précisément cette opposition qui est en train de sombrer, recouverte ou effacée par les assauts constants de la réalité.
Si depuis les premiers temps de la Grèce antique, la pensée s’est constituée en vue de faire face à la tromperie et à l’ambiguïté, l’instabilité chronique des formes de vérité comme celle des mécanismes régulateurs du dispositif de la conscience ont accompagné la mutation de la société engendrée en particulier par l’usage de l’écriture.
D’un autre côté, le mouvement de fond qui gouverne la société spectaculaire consiste en ceci qu’elle tend à s’approprier la totalité de ce qui existe, soumettant à ses lois l’ensemble des êtres et des choses, en jouant, encore et toujours sur l’ambiguïté qui existe au cœur même du langage.
Pourtant l’introduction de la logique propre à la marchandise dans les aspects les plus « intimes » de l’existence, dans chaque existence individuelle donc, a abouti à une mutation si profonde qu’elle n’affecte pas seulement les formes de l’existence mais le fonctionnement du psychisme. Ce saut qualitatif et quantitatif, puisque cette mutation est devenue planétaire, constitue le centre de l’expérience faite par Guy Debord et les Situationnistes en particulier, mais aussi celui de chacun de ceux qui vivent dans cette société, sur la planète terre. L’accélération de ce processus et son irréversibilité confèrent à ce moment de l’histoire son extrême singularité.
L’importance accordée par Guy Debord à la question du temps, ou plutôt le choix de faire de sa vie une immersion dans le fleuve de l’histoire en avançant « sous le canon du temps », est ce qui lui permet d’en percevoir les différents aspects, le courant principal et les courants secondaires qui le forment, la vitesse et la manière dont il avance.
La manière dont cette société avance constitue le problème principal, et pouvoir la décrire, l’analyser, c’est comprendre comment elle exerce réellement son pouvoir et étend son empire sur les choses et les êtres. La principale nouveauté apparue entre 1967, date de l’écriture de La société du spectacle et 1988, date de celle des Commentaires sur la société du spectacle, c’est que l’emprise de la société spectaculaire sur tous les aspects de l’existence est devenu total.
Elle a réussi à affaiblir ses contradicteurs les plus radicaux, au point de pouvoir faire croire qu’elle n’en aurait plus et elle continue à renforcer la puissance de la foi avec laquelle les autres obéissent à ses ordres. Le mouvement qui porte cette société transforme un mensonge relatif, inhérent aux formes et à l’exercice du pouvoir dans la mesure même où il est inhérent à la conscience, en un mensonge généralisé qui recouvre tous les aspects de l’existence collective et individuelle. L’occultation de tout ce qui n’est pas elle constitue la manière la plus propre qu’a la société spectaculaire de gouverner. Son combat est incessant sur le front des faits comme sur celui de l’information. Par ce biais, elle agit directement sur le psychisme de chacun.
L’absence de logique apparente alliée à une guerre ouverte contre les formes de la pensée logique constitue la manière la plus propre qu’a la société spectaculaire de faire fonctionner à son service le principe d’aveuglement inhérent au dispositif de la conscience. Elle le fait désormais fonctionner en fonction d’une stratégie qui fait de l’ambiguïté inhérente à la parole et à l’échange le vecteur d’un mensonge généralisé et le moyen de son accomplissement. En quelques décennies, le mensonge colossal est devenu un mensonge « absolu ».
2. L’éclair et la raison
On sait la puissance révélatrice de l’éclair qui rend visible tout en s’opposant à la puissance de fascination de l’image. Cette puissance de révélation pour Guy Debord, surpasse la puissance de révélation négative des propositions artistiques les plus radicales du XXe siècle, comme en témoigne ce passage de Panégyrique : « Une seule fois, la nuit, j’ai vu tomber la foudre près de moi, dehors : on ne peut même pas voir où elle a frappé ; tout le paysage est également illuminé pour un instant surprenant. Rien dans l’art ne m’a paru donner cette impression de l’éclat sans retour, excepté la prose que Lautréamont a employée dans l’exposé programmatique qu’il a appelé Poésies. Mais rien d’autre : ni la page blanche de Mallarmé, ni le carré blanc sur fond blanc de Malevitch, et même pas les derniers tableaux de Goya, où le noir envahit tout, comme Saturne gronde ses enfants. »
L’éclair révèle et consume. Il est à la fois le commencement et la fin, mais il rend surtout manifeste cet éclat qui, dans le fonctionnement psychique, vient recouvrir le moment de l’interruption, ce moment insaisissable de l’arrêt que l’on oublie en en faisant celui de la potentielle saisie de tout.
Ces deux métaphores, du fleuve et du feu, qui disent l’écoulement et l’arrêt, le passage et l’éclat, semblent porter en elles la trace d’un problème qui n’a cessé de tarauder la pensée et qui trouve son origine dans le fonctionnement psychique même. En effet, entre hallucination et action, entre réception des ordres émis par les voix et accomplissement des gestes, il n’y a pas de continuité. Il n’y avait donc pas de possibilité d’établir mentalement et intellectuellement de lien entre les moments vécus. Ils étaient reliés les uns aux autres par le seul « continuum » qui existait, celui de la répétition des moments semblables formant une sorte de masse de vécu compact, un éternel présent composé de pointillés.
La parole, le logos, la raison sont les éléments mis en place par le dispositif de la conscience lorsqu’elle s’est trouvée, grâce à la puissance mnémonique de l’écriture, en mesure de saisir qu’il pouvait y avoir non seulement une relation mais une continuité entre deux moments et en particulier entre ce moment qui devenait celui de la décision et celui de l’accomplissement qui devenait celui de l’acte.
La raison est cette faculté, développée par le psychisme, au moyen de laquelle il établit, invente, construit et prouve l’existence d’une continuité entre les phénomènes, ceux qui sont directement perceptibles par les sens comme ceux qui échappent à toute perception directe.
Il n’en reste pas moins que la raison doit, pour atteindre ses fins, s’opposer à tout ce qui, dans le psychisme, est porteur d’une puissance disruptive et viendrait inscrire ou révéler l’existence d’une forme quelconque, réelle ou fantasmée, de discontinuité.
3. Sources du nihilisme et dualité dans la pensée
L’expérience du temps se fait inévitablement à partir du temps trivial. Elle seule peut conduire à la découverte de son double visage, d’eau et de feu.
Le temps apparaît donc comme une sorte de Maelström, orienté si l’on veut vers un but qui n’est autre que de tout conduire vers le gouffre qui constitue son cœur ou son centre. Il est constitué d’une force d’attraction-répulsion, qui attire tout vers son centre et plus rarement rejette ce et ceux qui se sont approchés de lui de trop près.
Il faut chercher la source du nihilisme pratiqué et vécu par ceux dont Guy Debord chante la louange et qui furent ses amis, dans cette compréhension intime du temps. Elle se manifeste par un mépris sans borne pour les valeurs reconnues par la société. Chacun découvrait en vivant en marge des règles sociales, que le temps n’a pas d’autre fin que la disparition de tout. La vie individuelle comme le cosmos, tout s’enroule et se déroule à partir de ce centre vide fonctionnant comme un puissant attracteur et finit par être détruit. Ce qui dans ce même mouvement perdait sa puissance d’attraction, c’était la croyance dans la promesse indéfiniment répétée que faisait à ses membres la société marchande et avec elle toutes les autres formes de croyance.
Mais une telle expérience intime du temps comme puissance de néantisation n’est pas partageable, sinon avec ceux qui eux aussi la vivent et elle n’est communicable que de manière médiate puisque son « objet » n’est pas fixable. La langue, ici, se trouve confrontée à ses limites et le dispositif de la conscience se révèle lié aux limites qu’impose le langage à la pensée. Elle est en ce sens du même type que certaines expériences mystiques, ou d’autres, liées à la folie, à l’alcool ou à la passion amoureuse.
Il s’agit d’une expérience de type éthique, ou pour reprendre les termes de Robert Musil, à la fois une expérience non ratioïde et une expérience du non ratioïde.
« Ce que j’ai appelé naguère provisoirement les comportements ratioïdes et non ratioïdes représentent les deux modes de comportements fondamentaux donnés avec l’histoire humaine : l’univocité et l’analogie. L’univocité est même le principe fondamental de la logique. [...] Le second principe fondamental est l’analogie. Ce que l’on déduit logiquement du rêve, du sentiment religieux, vision, pressentiment, de l’autre état, de la morale, de la poésie. »
Savoir que l’univocité est du côté de la logique n’empêche pas de penser le monde du rêve ou de la poésie avec logique et rigueur. Inventorier le monde du non ratioïde ne se peut qu’avec l’appui d’une intelligence acérée. Ce à quoi fait accéder l’expérience du non ratioïde, c’est donc à la découverte de la dimension fondamentalement duale de la pensée.
Tout corpus affirmant avoir pour socle une unité posée comme originelle recouvre et masque l’existence d’un dispositif ayant permis l’instauration de cette unité comme dogme. Le hiatus qui agite le cœur de la pensée européenne tient à ce mouvement d’effacement des conditions de naissance d’un système socio-historique par le fonctionnement et l’évolution propres de ce système. Cet effacement prend la forme du recouvrement de cette histoire par un système conceptuel acceptable, en ce qu’il est communicable et partageable, c’est-à-dire crédible par tous ceux auxquels il s’adresse. Le réseau médiatique planétaire est un semblable système conceptuel. Un tel recouvrement n’a jusqu’ici jamais pu être total, mais il tend aujourd’hui à le devenir.
Par exemple, les textes fondateurs des religions monothéistes ne peuvent pas complètement masquer leurs origines, c’est-à-dire l’état de la société et les conflits internes qui la traversaient au moment de leur rédaction.
Par la suite, la lutte constante et parfois violente des églises qui se sont constituées à partir d’eux, n’ont pu empêcher l’apparition de formes radicales de pensées et de comportements de type mystique par exemple. Elles se sont tout d’abord développées à leur marge, puis finalement, au prix de certaines transformations, elles ont trouvé place en leur sein.
Une telle opération de recouvrement et d’effacement des conditions originelles d’une pensée par de nouveaux textes et de nouveaux préceptes allant jusqu’à nier certains des états antérieurs de cette pensée, Guy Debord, dans la société qui est la sienne, y est confronté de trois manières.
Trouvant sa source dans la prise en compte d’une situation initiale conflictuelle, donnée par l’expérience intime du temps comme processus de néantisation, il saisit de manière non médiate l’existence même de cette dualité au cœur de la pensée.
Tendue vers la réalisation du reversement perçu et compris comme possible, il appréhende le processus même de la formation des concepts, n’ignorant pas qu’un concept est « un résidu de métaphore » et que « le grand édifice des concepts montre la rigide régularité d’un columbarium romain ». En d’autres termes un concept est la réification d’un processus vivant basé sur une expérience directe. De non médiate, elle se trouve figée dans les médiations qui la représentent. Il dispose enfin d’un critère à la fois radical et « infaillible » pour détecter le mensonge, c’est-à-dire l’ensemble des processus qui, dans la pensée individuelle et collective, visent à reproduire le schéma de déni des conditions originelles et « sous de spécieux prétextes de cafard », le processus de leur recouvrement.
La radicalité de cette position, ne jamais renoncer à établir sa pensée à partir des conditions originelles données par l’expérience non médiate et intime du temps, a, à l’évidence, une dimension idiosyncrasique. Mais ce qui importe c’est de la transformer en une exigence de la pensée, en une force qui, à elle seule, indique où se situe la faille qui permet de distinguer au cœur même de toute affirmation la part de croyance sur laquelle elle se fonde.
Cette position révèle aussi l’existence d’un mécanisme implacable du psychisme. En effet, il perçoit comme un danger, toute force disruptive et se retrouve prêt à croire tout les discours qui tendront à lui indiquer comment se comporter pour qu’une telle interruption ne se produise pas. À rebours, l’élan qu’imprime de telles forces à la vie et à la pensée de ceux qui l’acceptent, peut leur permettre de ne plus tenir compte des voix auxquelles ils avaient l’habitude de se soumettre.
On connaît aujourd’hui le prix que chacun est prêt à payer pour que ne soit pas interrompue la connexion de principe de ses appareils qui le relient avec les siens, les autres et ce qui, pour lui, constitue le monde.
4. Croyance et séparation
En notant que « le spectacle est la reconstruction matérielle de l’illusion religieuse », Guy Debord situe son œuvre dans la perspective d’une critique à la fois logique et généalogique de la question de la croyance. Il ne s’agit pas alors de telle ou telle croyance particulière mais du fait même de croire. Croire signifie tenir pour vrai, mais on peut tenir pour vrai non seulement ce qui est et ce qui est vrai, mais aussi ce qui n’est pas ou ce qui n’est pas vrai, non seulement le fruit de l’analyse mais aussi le résultat de narratisations et de conciliations qui assurent à quelques objets chimériques puissance et efficacité sur les esprits.
Une telle affirmation synthétique sur la question de l’illusion religieuse impliquait d’interroger outre le fonctionnement réel des consciences individuelles et collectives auxquelles il était confronté, toutes les formes de croyance se déployant autour de lui, c’est-à-dire toutes les manifestations d’acceptation passive d’une illusion ou de soumission active à des discours ou des formes de réalité pour le moins trompeurs. La plus puissante des tromperies est celle que met en œuvre la société spectaculaire lorsqu’elle invente, au moyen de la marchandise, une forme toute particulière de conciliation fondée sur la reconnaissance de la synthèse du perçu comme forme à priori du bien. Cette synthèse n’est autre que le processus par lequel le psychisme reconnaît comme bon ce qui lui a été présenté comme tel. Dans le même mouvement, il se trouve empêché de reconnaître autre chose comme pouvant être bon. Le psychisme se satisfait de ce qu’il croit savoir si ce qu’il sait est légitimé avec suffisamment de continuité.
La société spectaculaire marchande a capté à son propre profit le processus de reconnaissance qui, dans le dispositif de la conscience, désigne la modalité de son fonctionnement par laquelle il se saisit dans sa complétude.
Suivre la genèse de cette société, c’est suivre en parallèle celle de cette mutation du dispositif de la conscience. Partir en guerre contre cette mutation, c’est révéler la manière même dont se met en place le déclin de cette société lors même qu’elle tente par tous les moyens de s’imposer aux yeux de tous comme le modèle même de toute conscience, de toute réussite et de tout achèvement.
Proche en cela de certains énoncés des Évangiles, une pensée radicale n’est pas là pour apporter la conciliation, ce remède que l’on pose sur des blessures fantasmées ou déjà guéries, mais tel un scalpel, pour fendre les pansements recouvrant des blessures réelles dont on veut à la fois ignorer qu’elles existent et ce qui les cause.
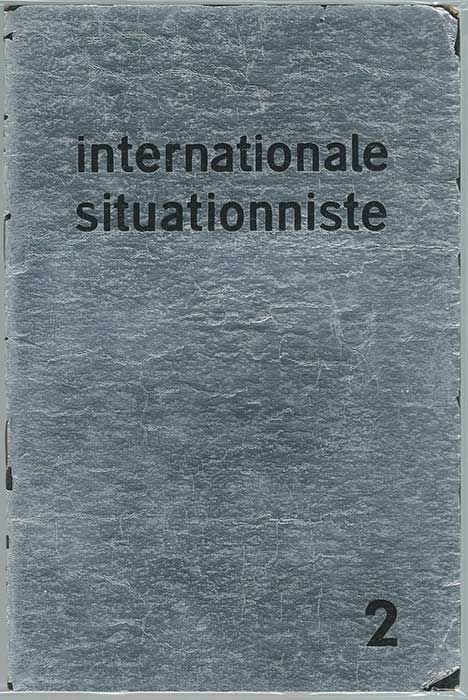
5. Croire et faire croire
Reléguée dans les oubliettes d’un état du psychisme considéré comme archaïque par un rationalisme bien pensant, la croyance, le fait même de croire, est un phénomène qui relève de la structure même du psychisme.
D’un autre côté, les analyses sur les croyances semblent tenir pour une donnée commune à chacun, le fait de croire, mais elles ne considèrent pas comme digne d’intérêt le fait de penser la croyance en fonction de la distinction et de l’articulation entre pensée ratioïde et pensée non ratioïde.
Quant à la question de la possibilité, dans l’évolution même de l’humanité, de la voir accéder à un état dans lequel elle pourrait ne plus avoir besoin de croire, elle semble ne pas devoir se poser. Ces points aveugles constituent sans aucun doute sinon la trace d’un « refoulement », du moins la preuve qu’un mécanisme complexe et interne d’occultation affecte le psychisme humain.
Mais croire est sans doute moins la manifestation d’un besoin psychique que la manifestation d’un conflit entre la survivance d’un état antérieur du psychisme et les contraintes que font peser sur ce même psychisme les exigences de la rationalité.
Si croire, c’est tenir pour vrai, croire implique que l’on sache que ce que l’on tient pour vrai peut ne pas être vrai ou du moins pourrait ne pas l’être. Ce lien intime entre croyance et vérité a été mis en place dans le processus de constitution de la conscience tel que nous l’avons appréhendé. Ce processus révèle que le « tenir pour » précède l’établissement d’une quelconque vérité, et que la formation même de la notion de vérité montre qu’elle est dépendante d’une forme d’efficacité qui lui préexiste et la dépasse en puissance.
Dire le vrai est non seulement de l’ordre du constat mais aussi de l’ordre de la prédiction. C’est en tout cas instaurer une continuité entre les moments discrets qui composent la perception de l’existence, et c’est assurer un lien entre des connaissances dispersées dans le temps et l’espace. La puissance d’une « vérité » se prouve par la vérification de ce qu’elle prédisait. Or, dans le psychisme humain, les mécanismes de la prédiction ne sont pas du même ordre que ceux de l’analyse ou de l’induction.
Le refus de prendre en compte une telle distinction, c’est-à-dire de considérer que la forme originaire de cette séparation au cœur du psychisme est comme son « sol originaire », conduit à l’occultation du phénomène qui constitue la croyance. Cette occultation prend la forme de la confusion entre ces deux dimensions psycho-physiques que sont les affects et la mise en relation de ce qui est vécu ou perçu avec ce qui arrive. Cette confusion ne cessera de se dupliquer à chacun des étages qui constituent l’infini gratte-ciel des pratiques humaines, religieuses et culturelles en particulier.
En remarquant que « le spectacle est la conservation de l’inconscience dans le changement pratique des conditions d’existence », Guy Debord indique qu’il est nécessaire de prendre en charge ces points aveugles ou ces zones d’ombre dans un projet de transformation du fonctionnement même de la conscience par la transformation des conditions qui président à son existence.
6. Programme
Guy Debord dit avoir su très vite quel était son programme, la réalisation de la poésie, de l’art et de la philosophie dans la vie même.
Dans une lettre de 1989 il révèle et la date de sa formulation, au début de septembre 1961, et son énoncé, trouvé lors de l’élaboration des thèses dites de Hambourg, restées non écrites. « Il a été convenu alors, que le plus simple résumé de ces conclusions, riches et complexes, pouvait se ramener à une seule phrase : « L’I.S. doit, maintenant, réaliser la philosophie. » Cette phrase même ne fut pas écrite. Ainsi, la conclusion a été si bien cachée qu’elle est restée jusqu’à présent secrète. » (C.,T.7, p. 140).
Ce programme trouve son origine à la croisée de l’affirmation d’une position existentielle singulière et radicale, ne pas désirer d’autres amis que ceux qu’auraient pu avoir ou accepter un Lautréamont ou un Arthur Cravan et d’une conjoncture historique, le développement de la société dite de consommation à l’époque de la révélation de sa mutation fondamentale en société spectaculaire marchande.
Il s’étendra du refus radical des médiations constituant la culture à une critique de toutes les formes d’obstacles interdisant l’accès à la possibilité de vivre librement les moments de l’existence pour ce qu’ils sont, et donc à une critique des structures économiques, politiques et policières édictant ces interdits.
Le maintien de l’articulation entre ces deux plans, celui de l’individu et de ce qu’il peut accomplir concrètement et celui de la marche de l’histoire constituera, pour l’I.S. le véritable enjeu.
L’énoncé de ce programme dans sa simplicité même est le signe même d’une parole « oraculaire » en ce sens qu’elle dit en une formule « tout » ce qui est à accomplir et que son accomplissement ne peut pas se faire à moins. Elle appelle un geste, un seul, mais qui mérite qu’on y consacre toute sa vie. Par ce geste, c’est l’ensemble du dispositif de la conscience, individuelle et historique, qui se trouve pris en compte. Le refus de distinguer entre ces deux plans conduit à faire de leur articulation le levier même de ce programme.
Les conséquences de sa mise en œuvre sont aussi importantes que le sont les présupposés qui le rendent possible. Les premiers supposent une perspective unifiée sur l’histoire occidentale, les secondes impliquent que cette histoire soit en quelque sorte renvoyée à elle-même à la fois dans un jeu de miroir et dans un processus d’accomplissement. En effet, l’histoire occidentale, européenne en tout cas, est portée par une promesse dont l’accomplissement a dû être repoussé pour que la promesse puisse être maintenue comme telle.
Le programme de Hambourg ne dit pas autre chose que la nécessité de passer à l’acte maintenant. La continuité de l’histoire est fondée sur la négation de la discontinuité de la perception et sur l’occultation du fait que cette continuité est une construction, un mélange d’extraction, de narratisation et de conciliation. Le programme de Hambourg éclaire cette continuité à partir de ce qu’elle n’a pas su être en mettant en œuvre sans délai ce qu’elle a dit devoir être.
Ce geste est double : il plie l’histoire sur elle-même et rend la promesse immédiatement insignifiante ou immédiatement nécessaire. Il brise le tabou du délai et débloque dans le dispositif de la conscience le mécanisme qui le contraignait à repousser l’accomplissement de ce qu’il portait en lui au nom d’une vérité qu’il savait mensongère puisqu’il en était l’auteur et le bénéficiaire.
C’est pourquoi, l’I.S. constitue dans cette vague de l’histoire qui se soulève, portée par son mensonge intérieur, sa pointe ou son sommet, le moment où, tel l’éclair, est rendu manifeste et la vérité qu’elle portait et le mensonge qui va l’ensevelir et la tuer.

7. La place du dieu unique dans le dispositif de la conscience
Le nihilisme pratiqué par Guy Debord est la manifestation synthétique de la critique générale de la société. Ce refus de tout ce qui fonde les valeurs de la société n’est ni une posture infantile, ni le fruit d’un aveuglement. Ce refus est le résultat d’une analyse de ce qui fonde la société spectaculaire marchande au-delà même de ce qui a été articulé à partir d’une pensée marxiste et de la prise en compte du fétichisme de la marchandise.
Si l’on peut dire que ce qui la fonde historiquement, c’est néanmoins une analyse de sa dimension économique, il faut rapporter le mot économie à son sens le plus marquant de plan général du salut, celui qu’ont développé Paul de Tarse et les Pères de l’église primitive en particulier avant qu’il ne devienne le nom du projet central du christianisme en général et du protestantisme en particulier.
Ainsi, la question du devenir fétiche de la marchandise, c’est-à-dire de son devenir image, est-elle enchâssée dans cette autre question concernant le salut de ceux qui, âme et corps inextricablement mêlés, habitent la terre.
Le moment chrétien originel se constitue, lui aussi, comme une tentative violente d’opérer un pli du temps sur lui-même. À l’époque du Christ, l’attente ne devait être que de quelques très humaines années entre l’annonce de la parousie et sa réalisation concrète. La plupart de ceux qui entendaient l’annonce de cette nouvelle espéraient et croyaient réellement qu’elle adviendrait de leur vivant.
Nous savons que la promesse n’a pas été tenue.
D’autres l’ont constaté à leur grand dam dès la fin du premier siècle après la mort du Christ. Ils ont donc mis en place au sein même de la pensée chrétienne un dispositif susceptible de sauver l’essentiel de la doctrine, c’est-à-dire de faire évoluer le dispositif de la conscience sans risquer pour autant son explosion. Le but était de maintenir cette croyance en la parousie en lui donnant pourtant un visage radicalement différent.
Ce grand retournement a consisté en une définition rétroactive de l’écart entre l’annonce du salut et le moment de sa réalisation comme constituant l’espace même de cette parousie. Chaque moment de l’existence matérielle se trouvant inscrit dans le mouvement du salut, l’économie générale des âmes pouvait se faire plus prégnante.
Il est surtout possible de décrire ce moment comme celui d’une transformation du dispositif de la conscience. Ce retournement a inscrit un nouveau pli dans le dispositif, pli par lequel le divin, ici le Christ, de personnage extérieur, à la fois historique et absolu, trouve à se loger de manière légitime à l’intérieur même du dispositif psychique individuel.
L’accueil fait à l’altérité radicale, en d’autres termes la modalités de la « présence » du divin au sein du psychisme individuel, a connu de nombreuses modalités.
Avec la figure du Christ, le dispositif de la conscience se trouve désormais lié à la figure d’un dieu unique. Dieu et homme à la fois, le Christ permet de faire en sorte que la place de l’autre s’intègre de manière définitive dans le dispositif de la conscience. En effet, c’est parce qu’il est une sorte de reflet de tout homme, que chaque homme peut l’accueillir « en » lui-même comme son double protecteur et son juge, en tout cas comme l’élément central permettant à la fiction du sujet de se mettre en place.

8. Négation du plan général du salut
L’économie générale du salut n’a pas cessé d’évoluer et de se transformer. La croyance qui était tendue par une exigence des corps vers la venue d’une expérience radicale et magique de leur propre métamorphose a été transformée en une mécanique qui a, d’une part, institué la figure du moi comme pilier du dispositif de la conscience et qui a, d’autre part, entretenu la forme de croyance qui convenait à sa pérennisation.
En orientant la flèche du temps non plus sur un lendemain proche, sur un objectif relevant du vécu immédiat, mais sur un temps qui n’adviendrait dans sa plénitude qu’après la mort, le dispositif de la conscience s’est accru d’une dimension supplémentaire. Le temps était toujours orienté vers une fin, mais vers une fin accessible seulement par l’imagination.
Cette science de la dilution de l’espérance dans l’étirement de l’attente vécue cependant comme prodrome à son accomplissement comme temps infini de la plénitude constitue le fondement de notre conception générale du temps.
Elle se met en place par l’invention d’un temps continu, mais cette continuité, il lui faut inventer comment l’enchâsser dans un suspens du temps, dans un moment de discontinuité. En effet, dans cette longue préparation à l’avènement de la parousie et puisqu’il y participe déjà, chaque moment de la vie doit désormais compter. D’un autre côté, on assiste à la substitution de l’attente comme tension du psychisme vers une satisfaction immédiate, en une attente se projetant bien au-delà la vie entière de chaque homme.
Cette vie, cette attente donc, est désormais tendue vers une satisfaction inaccessible en soi quoique présentée comme potentiellement accessible, mais sous la forme d’un jeu complexe et infini de significations variables. L’accès à ce sens n’est quant à lui possible qu’à travers des éléments transfigurés.
L’ensemble des médiations inventées par l’homme sert donc à combler ce temps de l’attente en le transformant en un temps infini. Si la théologie s’est imposée comme la science du temps dilué, l’art, lui, s’est imposé comme champ d’expérimentation des médiations acceptables et considérées comme efficaces pour palier à la déception, inévitable, engendrée par l’inaccessibilité effective de la parousie.
Le saut peut paraître brutal, mais le geste accompli par les Situationnistes, et avant eux ou avec eux par tous ceux qui avaient perçu dans ces médiations le masque même du mensonge concernant le temps, et dans la religion et l’état, les machines à broyer les corps dans le temps dilué d’une attente devenue sans objet, leur geste a consisté à se le replier sur lui-même.
Le pli fait se rejoindre ce moment, certes imaginaire mais inscrit dans la vie de chacun, où le temps vécu comme succession de moments discontinus se trouve paradoxalement suspendu et le moment où il se passe vers le commencement d’un temps nouveau devant être perçu comme une continuité de moments reliés entre eux par la nécessité ou la divinité.
La radicalité de ce geste a consisté en ceci que chacun suspendait ou effaçait dans sa vie la croyance en la légitimité d’un quelconque délai. Dans chaque moment de la vie, il devenait possible que se répondent les tremblements des commencements et les gestes sans appel de la réalisation, les énoncés du « Je veux » et les réalisations de « l’acte ».
Une seule chose ne pouvait être accueillie dans ce programme, celle qui constituait le cœur vivant de l’espérance chrétienne, la croyance dans le salut, celui des âmes comme celui des corps.
On pourrait dire que le nihilisme dont a fait état Guy Debord a constitué l’opération la plus puissante qu’il ait menée dans la mesure où ce nihilisme a été déployé non comme négation de la vérité mais comme l’affirmation d’une seule vérité, une vérité existentielle qui rendait de facto caduque toute forme de croyance en la légitimité d’un quelconque délai comme moyen d’atteindre à la réalisation de la promesse. Cette vérité se présentait comme une injonction, celle de ne jamais croire à aucune autre chose qu’à ceci, qu’il n’y a pas d’autre temps que le temps vivant, inchoatif, composé de moments discrets soulevés par les passions, mais que la pensée, la raison, l’histoire, peuvent se relier entre eux grâce au dispositif de la conscience. Vivre ce temps vivant dans lequel seul peuvent se réaliser les projets de la vie avait pour conséquence ou pour implication la levée le blocage qui affectait la conscience.
Faire choir l’absolu dans l’histoire, c’était donc barrer la perspective d’un salut éternellement dilué et ouvrir le champ des possibles aux forces disponibles pouvant permettre de les réaliser.
9. Existence et Dasein
Pour comprendre la mutation du dispositif de la conscience qui se met en place au cours du XXe siècle, il est nécessaire de confronter le programme du renversement radical de la philosophie par sa réalisation, à celui de la philosophie du XXe siècle, et en particulier celui que met en place Martin Heidegger pour penser le Dasein.
On peut en effet comprendre l’instauration du Dasein comme la mise en relation des quatre aspects essentiels qui le constituent, le souci, l’intentionnalité, le néant et un « moi » sans propriétaire. La structure du Dasein est tout entière tendue par l’idée de salut. Ce salut est inspiré par une approche luthérienne et paulinienne de la foi comme ce qui permet de vivre la loi. La perspective du salut est ce qui permettra au Dasein de se présenter comme garant de l’être. Il ne pourra occuper cette place que par la réalisation de son être propre comme authenticité.
Cette impossibilité de se passer du salut comme pôle de tension permettant au Dasein de se déployer, ne saurait masquer le nihilisme qui hante cette philosophie comme son ombre. En effet, pour le Dasein, déployer son être revient à lutter contre la mort en tentant de se racheter. Il se constitue entre ces deux pôles que forment un néant originaire et un néant promis. Plus globalement, il a à assumer la dette originaire de la séparation entre être et étant.
Le Dasein de l’homme, ou si l’on préfère la manière qu’a l’homme d’assumer le programme du Dasein, le fait se confronter à cet aspect des choses qui est comme le remarque Günther Anders, « la consternation devant le « fait » qu’il y a « ceci ou cela » ». Le souci est moins motivé par la réalité des relations avec autrui que par la tentative d’échapper à cette consternation.
Le Dasein, inventé par Martin Heidegger pour remplacer la conscience, c’est-à-dire pour modifier le dispositif de la conscience historique et en instaurer un nouveau, ne peut cependant pas échapper à une forme d’intentionnalité particulière qui le conduit à ignorer la présence des choses pour libérer une place pour son projet. Ce déni, qui permet au Dasein de s’installer dans le temps et de durer, est la forme de la négativité de son rapport au monde.
Ni conscience, ni « moi », le Dasein se pose donc comme un ensemble vide. C’est là le seul moyen de faire face à la néantisation qui l’occupe, celle qui, doit-on supposer, règne au cœur des choses et qui gouverne les si banales et si vaines préoccupations des hommes.
Un pôle est nécessaire qui fasse contrepoids à cette vallée hantée par le néant, un pôle qui pour n’être pas lui-même néant, ne peut qu’être vide. Cette vacuité va servir de chambre d’écho à la consternation. C’est à partir d’elle que le Dasein va faire de l’être ce qui dans la pensée existe en vue de le sauver et d’être dans le même mouvement sauvé par lui. À condition qu’il le cherche. Face à l’ampleur de cette tâche, le Dasein ne peut pas ignorer qu’il est sinon un pur néant, — Martin Heidegger ne cesse de combattre ce danger que pourraient faire naître de mauvaises interprétations —, du moins un ensemble vide qui se projette en vue d’accueillir l’être et rien d’autre.
L’organisation des aspects du Dasein met en place une sorte de théologie générale tendue vers le vide qu’il abrite en son sein comme son secret. Le risque que ce vide soit interprété comme vacuité du sens contraint le Dasein à n’avoir pour seul but que celui de se sauver en se lançant dans le travail de la quête infinie de l’être.
Pour le Dasein, il n’y a rien à sauver de ce qui hante le monde, sauf l’être en tant que le monde d’ailleurs se déploie comme activité ayant pour effet, sinon pour condition, son oubli. La dimension théologique n’est ni cachée, ni abolie elle est simplement présente mais comme niée. Le Dasein apparaît comme cette instance ou ce dispositif qui inscrit la figure du déni au cœur de la pensée européenne.
La perspective du salut est donc l’axe majeur autour duquel se joue la question de ce renversement et conditionne l’ensemble. Mais le salut lui-même change de sens car le temps a changé de fonction.
En renvoyant l’intentionnalité propre au Dasein à une visée calquée sur la saisie du divin comme ce vers quoi l’homme regarde à cause d’une similitude d’image, comme en témoigne déjà le cours de 1925, Martin Heidegger va plomber la structure du Dasein en inscrivant en son sein le mouvement de néantisation qui affecte le monde.
Ce geste par lequel il déplace ce qui est visé par la conscience dans le Dasein du On vers la mort, plie le temps de telle manière qu’il est perçu comme processus de néantisation. Mais rapporté au Dasein, ce pli « sauve » ce qui a lieu dans le monde dans la mesure où, constitutif du Dasein même, il renvoie l’histoire à cette temporalité autre qui la constitue.
L’historique ne peut déterminer l’historial, mais l’historial qui constitue le plan de projection des possibilités pures de la conscience, le fait comme dispositif de saisie de ce qui échapperait à toute forme de duplicité, conçue comme élément central de l’inauthentique. L’établissement de la structure du Dasein constitue le plus gros effort théorique pour rendre inauthentique tout ce qui relève de la réalité.
Le geste par lequel Guy Debord et les Situationnistes pensent le temps implique au contraire que la duplicité soit prise en compte comme dimension originaire de la conscience et que la réalité et l’histoire soient saisies comme des entités sur lesquelles il est possible d’agir. Ils plient donc le temps selon un geste qui inclut aussi la néantisation comme événement essentiel ou comme figure du destin, mais cette néantisation est présentée comme le processus même par lequel tout ce qui est se voit dépossédé de son être concret et privé de la perspective d’un salut.
Il n’est plus possible, dans ce pli du temps, de poser une différence autre que de vitesse entre les modes d’anéantissement réel mis en place par une société devenue folle et la saisie par la pensée de cette fin fantasmée en train de devenir réelle.

10. Le corps et le concept
Si ce parti pris pour l’existence constitue le geste le plus radical dans l’élaboration du renversement des valeurs de la philosophie occidentale par les Situationnistes, c’est qu’il renvoie les concepts, sinon à leur incernable origine, du moins à leur source.
Les concepts sont des objets mentaux. Ils se forment dans le psychisme et la pensée, au-delà des sensations et des images mémorielles auxquelles elles donnent lieu, par ce processus qui permet la formation d’images abstraites. Agglomérats de traces mnésiques et de constructions autonomes, les concepts qui constituent la base de la pensée, rétroagissent sur le psychisme. Dans cette opération d’accomplissement de la philosophie, où les concepts sont renvoyés aux corps qui les portent, leur validité est mesurée à l’aune de l’action et non à l’aune du seul plan autonome qu’ils constituent.
Deux options se présentent donc dans ce nouvel usage des concepts. La première consiste à jouer avec eux, à la fois pour tester leur résistance aux faits et aux projets concrets et pour les faire fonctionner dans des combinaisons nouvelles. La seconde consiste simplement à les abandonner sans autre procès sur les berges du fleuve du temps, coques trouées n’évoquant plus aucun voyage que celui des cadavres qu’ils sont. Cette plongée des concepts dans le fleuve du temps constitue une véritable épreuve de vérité aussi radicale qu’implacable.
« Qui sera imprégné de cette froideur croira difficilement que le concept, en os et octogonal comme un dé et, comme celui-ci, amovible, n’est autre que le résidu d’une métaphore, et que l’illusion de la transposition artistique d’une excitation nerveuse en images, si elle n’est pas la mère, est pourtant la grand-mère de tout concept. Dans ce jeu de dé des concepts, on appelle « vérité » le fait d’utiliser chaque dé selon sa désignation, le fait de compter avec précision ses points, le fait de former des rubriques correctes et de ne jamais pécher contre l’ordre des castes et la série des classes. »
C’est précisément en ne respectant pas les règles du jeu qui visent à l’établissement et au respect de vérités officielles, et en inventant de nouvelles règles qui ne tiennent en rien compte des anciennes, en inventant une nouvelle manière de vivre que les Situationnistes ont réellement accompli la critique formulée par Friedrich Nietzsche.
Reconduire les concepts à la source même de leur formation, au moment non seulement ou la métaphore se transforme en concept, mais à celui de la constitution des métaphores, constitue le seul moyen de réintroduire le corps dans la pensée.
Le corps est traversé par le courant discontinu des informations que le cerveau émet et reçoit et se trouve être à la fois ce par quoi la langue est émise et ce qui constitue le premier ensemble de données dont elle dispose pour s’inventer.
Sans retracer ici le long chemin qui a conduit des états du corps à leur traduction dans la langue, de cette traduction à l’établissement des concepts et de l’impact en retour des concepts sur le corps, il reste nécessaire de décrire les mouvements dont le corps, devenu élément essentiel du dispositif de la conscience, se trouve aujourd’hui le vecteur voire l’otage. Rendre compte de cela est le seul moyen de rendre au corps sa prééminence dans le fonctionnement de la pensée, et ce n’est pas la moindre des opérations effectuées par les Situationnistes.
Il s’est agi d’une part, de faire s’écraser sur le sol des évidences partagées les termes devenus mensongers qui décrivaient une situation qui n’existait plus, un rapport des corps à la réalité qui les entoure basé sur la confiance en la puissance de vérité des concepts.
D’autre part, l’enjeu était de rendre aux corps leur liberté, celle d’inventer dans le libre jeu de leurs facultés et celle de rendre inopérant le facteur essentiel de la mise en place du délai dans la vie individuelle et collective, cet écart posé comme « sacré » devant séparer décision et acte.
De telles pratiques, se fondant sur les plaisirs, l’ivresse, la réflexion critique et le refus de toute forme de transcendance comme ce qui permettrait de s’orienter dans l’existence, peuvent être rapprochées de celles d’autres groupes ayant existé à d’autres moments de l’histoire. Ainsi, par exemple, certains groupes gnostiques qui vécurent à proximité de la mer morte à l’époque de Pilate ne tenaient aucun compte de ce qui passait pour avoir une quelconque valeur morale ou sociale et prenant le temps pour ce qu’il est, ignoraient sans remords la perspective d’une fin autre que celle de chaque jour.
Mesurer l’histoire à cette aune en change le visage. Vivre dans une telle insouciance change la forme du temps.
11. La voix, le corps
Lire les livres de Guy Debord, voir ses films, c’est écouter et entendre une voix. À travers elle, se révèle l’action de la langue sur la conscience qui en use. La voix est sinon la manifestation du moins l’accès à ces zones occultées de la conscience. Elle est aussi ce qui rend possible la mise en œuvre du devenir concret des énoncés.
On peut lire sa correspondance comme le long déroulement de cette obstination, à travers chaque occasion de la vie, de faire émerger, pour lui comme pour les autres, la possibilité d’accéder aux lois mêmes qui gouvernent le fonctionnement de la conscience, ainsi que de mettre en œuvre pour soi-même la capacité à accoupler décision et acte, en d’autres termes d’abolir la puissance psychique du délai.
C’est bien la même voix qui se fait entendre dans ses films, une voix qui vient déséquilibrer la perception des images, renforcer l’impact du trouble et donner à entendre la basse continue de la vie, temps qui passe, temps perdu, temps à nouveau ouvert après chaque geste qu’il soit ou non décisif.
Cette voix ne donne pas d’ordre, elle décrit le chemin parcouru, indique la direction du passage, engage à le franchir. Plus elle ne peut pas, moins elle ne le voudrait pas. Elle est la part de la vie vécue dans le mouvement général des médiations qui sont textes et films, la trace de l’authenticité, sa manifestation même. Cette manière d’user de la voix s’oppose en tout à la présence frelatée des voix dans les organes médiatiques officiels.
La voix, organe de la rencontre avec l’autre, Guy Debord s’en sert pour la transformation du vécu, car c’est elle qui permet de réintroduire dans le fonctionnement même de la conscience et de la langue, la part occultée de ce fonctionnement, la décision et l’acte, leur lien profond.
Il s’agit donc de se saisir du processus mis en œuvre dans la langue par la conscience en tant qu’elle est « travail de la métaphore lexicale » et de le rapporter à la conscience à travers l’usage de la langue. Si, en effet, parler c’est tenter de nommer l’inconnu ou le moins connu pour le rendre acceptable et reconnaissable à travers des expressions mieux connues, c’est alors pour une part, recouvrir le caractère insaisissable de la réalité du voile des mots. Dans le même temps la réalité ne cesse de venir contredire cette prétention de la langue à la recouvrir, l’excédant en tout à chaque instant.
Il en va de même avec l’autre face de ce que la langue permet d’exprimer, les phénomènes qui arrivent au corps vivant et pensant, qu’il perçoit, reçoit, éprouve sans pouvoir nécessairement les nommer.

12. La thèse 31
La thèse 31 de La société du spectacle présente de manière synthétique le fonctionnement du dispositif de la conscience. La conscience est ce mécanisme général par lequel la langue se manifeste comme l’interface entre la logique des propositions et ce qui arrive dans le monde et donc comme le champ d’effectuation de leur permanente régulation. Le spectacle est ce moment dans l’histoire de la conscience où cette langue, ayant permis d’établir un lien entre la pensée et les choses, ne nomme plus que le produit réellement imaginaire du travail des hommes et sert à décrire le mécanisme par lequel un concept, celui de spectacle, s’impose à travers un processus d’auto-engendrement.
Le concept est une force produite par le travail réel de la métaphore qui se retourne contre ce qui dans la métaphore constitue son référent et qui repousse la puissance propre de la réalité hors du champ de la parole et l’absorbe à travers les reflets d’elle-même que la multiplication des concepts produit. Le concept est le doublet halluciné de la métaphore qui se constitue comme le sol originaire d’une perception non sensible.
La thèse 31 identifie les trois mécanismes essentiels du dispositif de la conscience, le mouvement de retour sur soi de la perception sur ce qui est perçu, le processus de recouvrement de ce qui est conçu sur le perçu et l’exhibition de ce qui a été conçu comme forme originaire de ce qui est à percevoir.
Ce mécanisme est particulièrement complexe dans la mesure où il fonctionne à partir de l’occultation d’un double déplacement qui correspond à un double mouvement d’oubli. Le premier oubli est celui des conditions de production et de la dépossession originaire du travailleur de son travail et de ses fruits. Le second est l’oubli de la différence entre données de la perception et données de la pensée, entre métaphore et concept. Ces deux oublis sont rendus possibles non par ce qui pourrait être pensé comme une perversion interne au dispositif de la conscience mais par l’équivalence qu’établit le psychisme entre image mémorielle, liée à une sensation et image mentale, formée par le jeu mental sans association nécessaire directe à une sensation ou une perception réelle et qui redouble l’association voire l’identification faite à cause de leur similitude dans l’esprit, leur statut d’image, entre métaphore et concept.
En notant que « le spectacle est la carte de ce nouveau monde, carte qui recouvre exactement son territoire », Guy Debord indique que le spectacle est un dispositif identique à celui de la conscience. Il existe cependant une différence entre les deux dispositifs. Le spectacle ne prend pas sa source dans le rapport complexe entre sensations, perceptions et réalité, et leur devenir images, idées, concepts, mais dans le jeu auto réflexif qui en constitue la réplique. Ce sont des objets mentaux qui servent de base au déploiement de ce jeu dont le seul lien avec la réalité est une ressemblance d’un type particulier. En effet, le dispositif construit la forme même qu’il va venir ensuite combler des significations qu’il a conçues à cette fin.
En d’autres termes ce dispositif est une copie exacte du dispositif de la conscience. En tant que double il peut légitimement se targuer d’une dimension ontologique équivalente. Mais il ne fonctionne ainsi que parce qu’il oublie ou dénie à tout élément issu de la réalité matérielle la possibilité de venir contredire ce qu’il met en place ainsi que la véracité de ce qu’il tient pour vrai. Ce dispositif fonctionne comme une force qui n’admet pas de contradiction, c’est-à-dire comme une hallucination.
Le spectacle est donc la projection par le dispositif de la conscience d’une image mobile de lui-même par laquelle, s’apercevant, il se constitue comme sa propre origine. Il ne tire sa puissance que du fait d’être aux mains de personnes, groupes et réseaux qui pensent que l’hallucination est la forme de la punition qu’ils doivent adresser à ceux dont ils sont les dieux. Dieux, ils sont en ceci qu’ils servent de rouage à la forme hallucinée du dispositif qui constitue chaque individu comme conscience.
En ce sens le spectacle est installé dans chacun des dispositifs individuels de conscience comme son maître absolu. Dans le spectacle, le dispositif de la conscience met en scène sa puissance à réaliser ce qu’il désire. Niant les obstacles que la réalité dresse sur ce chemin, le spectacle réalise le vœu de tout psychisme, abolir la distance qui sépare le « je veux » de la réalisation de l’acte.
Le spectacle est donc le dispositif qui réalise ces vœux sous forme de montages d’images, et qui s’assure en retour que le dispositif de la conscience prenne ces images pour la réalité. Il s’assure du contrôle de la conscience, collective comme individuelle, parce qu’il fonctionne comme une hallucination continuée, artificiellement maintenue par le réseau, lui bien réel, d’appareils qui en assurent le déploiement.

13. Hallucination généralisée : l’image
Le spectacle agit sur les deux registres à partir desquels se constituent la pensée, les images et les mots. Produit de la pensée, le spectacle est la forme de pensée qui nie ses origines afin de se poser comme sa propre origine. Si comme le note W.R. Bion, « une pensée a pour réalisation une non-chose », le spectacle est donc un dispositif qui fabrique des non-choses en voulant leur donner le statut de choses et qui doit, pour cela, faire des choses, des non-choses.
L’image est sans aucun doute la non-chose par excellence. En elle la puissance de la reconnaissance associe la nécessité de la signification à l’évidence du visible. Le mécanisme de la reconnaissance fonctionne sur un oubli. Il occulte simplement le fait qu’une image technique est produite par un appareil.
Les images produites par les appareils que la saisie supposée de la réalité impose, lorsqu’on les regarde, qu’on commence par identifier leur référent et par reconnaître ce qu’elles montrent comme « étant » cette réalité. En d’autres termes, les images produites par les appareils engendrent un effet de croyance. On ne peut pas ne pas tenir pour vrai ce que l’on reconnaît sur une image, parce que, précisément on reconnaît cette chose.
La langue fait de la reconnaissance le phénomène ultime, le moment de la synthèse des éléments appréhendés et analysés au cours de la lecture par la formation d’une « image conceptuelle » et d’un jugement qui est une décision concernant la validité de ce qui a été appréhendé.
L’image est devenue l’élément dominant et premier de la perception du réel ainsi que la médiation qui fonde notre rapport à la réalité. En tant que surface sur laquelle sont associés de manière partielle et parcellaire des éléments n’ayant pas nécessairement de liens logiques ou ontologiques entre eux, l’image est une synthèse à priori. Une synthèse à priori signifie, ici, qu’elle opère à la manière d’un jugement sur les choses. Ce jugement ne pourra cependant pas être remis en cause puisqu’il est posé comme vrai.
Ce que la prise de pouvoir par l’image occulte, ce sont le fait que la connaissance est devenue une région de la croyance et que cette croyance, basée sur l’identification du réel saisi et présenté par les images, est médiatisée par des appareils. Ainsi, les images photographiques en noir et blanc par exemple ne sont pas des captures de la réalité, mais comme le fait remarquer Vilém Flusser dans son livre, Pour une philosophie de la photographie, « elles traduisent la théorie optique en image ; ce faisant, elles chargent cette théorie de magie et encodent des concepts tels que ceux de « noir » et de « blanc » en états de choses. » Comme il le dit encore plus brutalement, « pour le photographe, c’est justement le noir de la boîte qui constitue le motif à photographier. »
Dans le même temps, cette croyance en l’indicialité de l’image, qui sert de fondement à l’identification entre image et réalité, prend la place de la connaissance issue des textes et d’un usage logique et dialectique de la langue. Le dispositif de la conscience se trouve légitimé dans la mise en place de deux opérations. La première consiste à reconnaître une sorte d’identité fondamentale ou d’équivalence entre le processus de métaphorisation et de formation des concepts comme images mentales stabilisées et celui de la duplication supposée de la réalité dans l’image. La seconde consiste à choisir de tenir pour vraie la présence supposée des choses dans la non-chose qu’est l’image plutôt qu’à tenir pour vrai l’image stabilisée d’un divers complexe qu’est le concept.
En tant que mouvement général consistant à remplacer l’expérience directe qui s’exprime à travers la langue par un mouvement général de reconnaissance de ce qui est visible en tant qu’il s’incarne dans ces non-choses que sont les images, le spectacle est un processus de transformation du dispositif de la conscience.
Si donc, « le spectacle est la carte de ce nouveau monde, carte qui recouvre exactement son territoire », et que « les forces mêmes qui nous ont échappé se montrent à nous dans toute leur puissance », la prolifération des images techniques et des appareils qui les produisent et les enregistrent fait de la production de ce visible un processus de dépossession à un second degré.
En effet, dès lors que tout ou partie de la réalité est produit pour ressembler à son image, image qui la précède tant mentalement qu’ontologiquement en ce qu’elle est elle-même une possibilité des appareils, ce qui est laissé hors de l’image, à savoir la plus grande part de la réalité, pourtant programmée pour y trouver son reflet, se trouve exclue du visible et tend à échapper au divers modes de connaissances basés en particulier sur les textes.
Cet interdit pourrait se mesurer comme l’écart entre la puissance de reconnaissance imposée par la forme synthétique de l’image et la puissance de connaissance liée au texte, entre la connaissance confondue avec la reconnaissance d’une réalité dans une image et la formation d’une « image verbale », une métaphore devenant concept, comme processus de synthèse d’une analyse d’éléments réellement perçus et pensés.
Ainsi, le spectacle est-il devenu le territoire construit à partir de cette carte réellement « imaginaire » calquée sur les intentions et les projets des maîtres des images et des appareils. On voit alors apparaître un nouveau moment de la conscience, celui où la puissance des images est telle, que la langue est identifiée à la duplicité et l’image, par sa puissance magique, d’injonction et d’effectuation, à la réalisation d’un « vécu ».
14. Le vert et le rouge
La puissance renouvelée et accrue des images, en tant que vecteur majeur permettant aux hommes de s’orienter dans l’existence, ne serait pas possible si une perte de puissance au moins équivalente des mots et des textes ne se produisait parallèlement. Si l’invention et l’usage massif d’appareils de computation constituent l’élément déterminant de ce processus, c’est au cœur même de la langue qu’il faut chercher la raison de cette perte de puissance des mots et des textes. Non que la langue soit devenue soudainement plus faible, mais elle s’est simplement retrouvée impliquée dans un problème majeur, celui de devoir traduire des expériences et des états de choses ne trouvant plus directement leur source dans une expérience sensible.
La langue est en décalage vis-à-vis de la réalité. En effet, les connaissances scientifiques en apportant de nouvelles explications sur le fonctionnement des choses et des êtres ont transformé notre vision du monde et cette image du monde dont il faut désormais rendre compte est plus le produit du travail de computation et de simulation des appareils que celui de notre expérience directe. Souvent même, les connaissances contredisent la perception de manière si profonde que, en retour, la langue apparaît comme inadéquate pour en rendre compte.
Dans L’homme sans qualités, Robert Musil déjà faisait dire à Ulrich s’adressant à sa sœur Agathe au sujet de la pelouse de leur jardin : « C’est probablement ainsi que tu la décrirais, toi que le maniement des étoffes a habituée à ces évocations. Moi en revanche, je pourrais mesurer cette couleur : à vue de nez, elle devrait avoir une longueur d’onde de cinq cent quarante millionièmes de millimètres… Alors ce vert semblerait vraiment saisi, attrapé à un endroit précis ! déjà pourtant il m’échappe à nouveau, regarde : cette couleur du terrain a aussi sa matière, qu’on ne peut définir en termes de couleur, parce que ce même vert, sur de la soie et de la laine, serait différent. Nous voici renvoyés à cette découverte profondément éclairante que l’herbe verte est vert d’herbe. »
Dans son livre, Une carte n’est pas le territoire, Alfred Korzybski, écrira quelques années plus tard : « Si nous disons la rose est rouge, nous falsifions tout ce que nous savons en 1950 concernant notre système nerveux et la structure du monde empirique. Il n’y a pas de rougeur dans la nature, mais seulement des radiations de longueurs d’onde différentes. Notre réaction à ces ondes de lumière est uniquement notre réaction individuelle. Un daltonien, par exemple, verra du vert. Un individu atteint d’achromatopsie verra du gris. Nous pouvons dire plus correctement je vois la rose comme étant rouge, ce qui ne serait pas une falsification. »
Ce n’est pas la signification des mots ou leur capacité à communiquer des informations qui sont en cause, ce sont bien plutôt les limites du fonctionnement psychique et du dispositif de la conscience. En effet, c’est la manière dont la conscience fait fonctionner la langue qui atteint ici une limite. L’attribution des qualités aux choses s’est révélée être un processus ne correspondant plus aux connaissances que nous avons acquises sur ces choses. La langue de mode majeur de la connaissance s’est révélée être un processus de falsification. L’écart entre ce qui est perçu et ce qui est connu ne constitue plus seulement une zone d’ambiguïté mais une faille incommensurable. Le mot être, comme Alfred Korzybski aussi le remarquait, s’est révélé l’acteur et le témoin majeur de cette crise.
« Ici, suivant Russell, nous ne pouvons qu’énoncer approximativement que dans les langages indo-européens, le verbe « être » a au moins quatre usages entièrement différents :
1. Comme verba auxiliaire : c’est fait.
2. Comme le « est » d’existence : je suis.
3. Comme le « est « d’attribution : la rose est rouge
4. Comme le « est » d’identité : la rose est une fleur. »
Attribuer une qualité à une chose ou établir une relation d’identité se révèle être un acte de croyance. La connaissance, pour être partagée, doit se fonder désormais sur d’autres bases que sur les mots.
15. Hallucination généralisée : le mot être
Les premières pages de La société du spectacle semblent inscrire le propos général du livre dans un cadre philosophique classique basé sur une distinction entre être et avoir mais « l’évidente dégradation de l’être en avoir » d’une part et le « glissement général de l’avoir au paraître » ne laissent pas l’être indemne.
Le constat d’une faillite générale avait déjà été établi par Guy Debord dans son second film, Sur le passage de quelques personnes à travers une très courte unité de temps, dans lequel on pouvait entendre ces phrases : « Ce qui différencie le passé du présent est précisément son objectivité hors d’atteinte ; il n’y a plus de devoir-être ; l’être est à ce point consommé qu’il a perdu l’existence. »
L’être s’est effondré dans la faille de la séparation, celle qui se creuse, irréversible, entre le monde des expériences vécues et celui des images qui gouvernent les vies soumises aux lois de la marchandise et du spectacle. Si l’enjeu pour Guy Debord se trouve dans les combats qu’il mène contre la société spectaculaire, les effets de ce processus de désontologisation affectent toutes les strates de la vie comme de la pensée. Le déploiement de la destruction réelle des conditions matérielles d’existence s’accompagne de la destruction de certains mécanismes dans le champ même de la conscience et affecte radicalement les fondements de l’ontologie sur lesquels se basent philosophie et théologie.
En notant que « le spectacle est la reconstruction matérielle de l’illusion religieuse » Guy Debord indique que le processus de désontologisation va s’opérer sur deux plans. Le premier est celui de la réalité qui va voir sa consistance réduite à néant au profit de sa mise en scène généralisée comme sol originaire de l’expérience. Le second est celui de la pensée, où l’être se voit vidé de ses déterminations par la ruine des conditions de son instauration. En effet, l’être est la catégorie ou le concept qui assure au dispositif de la conscience sa légitimité comme écran protecteur contre l’angoisse face au néant ou au non-être. Entre principe d’attribution et principe d’identité, l’être est le terme qui assure à la métaphore sa double puissance, de connaissance et de reconnaissance. À lui seul il verrouille l’ensemble du dispositif en permettant à ce qui est séparé d’être lié. Il est le vecteur même de toute croyance dans la mesure où il assure la connexion entre des réalités de niveaux différents et où il permet à ce qui relève de la perception d’être mis en relation avec des phénomènes relevant uniquement de la pensée.
Mais l’être n’est pas autre chose qu’un mot, un mot essentiel dans un dispositif mais rien qu’un mot. Son existence se situe tout entière dans la langue. Il a permis au psychisme humain de jeter un pont et d’établir des relations entre des phénomènes et c’est en tant qu’opérateur « magique » dans la mesure où ce qu’il permettait de prédire se trouvait souvent vérifié, qu’il est devenu la clé de voûte d’un dispositif qu’il a permis de développer.
Il en va de même pour l’être, pour la vérité, l’histoire, ces mots, ces concepts, ont une histoire. Celle de l’être commence avec Parménide, et comme le montre Jean Bollack, l’être comme notion centrale permettant d’articuler les formes de la croyance à celles de la connaissance n’est pas antérieur à son élaboration dans Le Poème. Le Poème est même le lieu de cette élaboration.
L’attribution à l’être d’une puissance psychique et mentale proprement « magico-religieuse » se fera, au cours des siècles, par un processus de recouvrement de cette origine. Une telle origine ne répondra pas aux critères absolus dont la philosophie et la théologie chrétienne en particulier auront besoin pour en démontrer la dimension divine. Toutes deux occulteront ou interpréteront les textes comme les faits, afin de prouver l’aspect divin de cette origine.
Comme le montre Jean Bollack, cela se passe tout autrement, en particulier dans Le Poème. « La pensée se forme dans les mots et les mots répondent à la pensée. Ce n’est pas que la langue dise vrai ; on lui fait dire le vrai, en la maîtrisant et, en fin de compte, en la contrôlant et en la reconstituant. La collaboration suppose une réflexion sur ce que c’est que l’on dit ; par ce biais la langue, puisque c’est avec elle que l’on pense, contrôle aussi, dans l’autre sens, la pensée et peut paraître première. » L’être ne deviendra l’élément central du dispositif de la conscience qu’une fois pris dans le double jeu de reflet, celui auquel jouent sans fin le moi et le je et qui s’articule entre la peur d’un manque et le besoin d’une stabilité, et celui qui se joue entre réalité et projections mentales et qui s’articule entre mémoire et oubli, occultation, recouvrement et exhibition. Günther Anders, dans un texte de 1948, remarquait déjà que « seule l’être humain complètement abandonné est stupéfait par le fait d’être : une analyse plus fine montrerait que l’ontologie est une théologie de cette consternation-de et non une théorie du Sein. »
16. Désontologisation
La désontologisation n’est rien d’autre que la prise en compte forcée de ce va et vient constant entre ces deux pôles que sont la pensée et la langue. Il faut rapporter ce mouvement non plus aux formes imaginaires et faussement transcendantales de sa constitution mais aux éléments concrets, complexes et ambigus qui ont présidé à son instauration et à ceux qui ont permis ses diverses mutations.
La désontoligisation a deux aspects, l’un qui se situe dans la réalité l’autre dans le psychisme. Le premier naît de l’écart devenu incommensurable entre réalité et discours, et des effets en retour sur la réalité comme sur le psychisme des efforts constants visant à masquer cette vérité, c’est-à-dire l’existence même de cet écart, devenu gouffre. Le second, coessentiel au premier, comme la langue et la pensée le sont, est inhérent au fonctionnement psychique et au dispositif de la conscience, ou plus exactement il se met en place lorsque, la langue venant s’articuler à la pensée, la construction de ce pont, de ce lien entre les deux fait naître, comme son ombre portée, le gouffre de leur différence, de leur séparation.
C’est pour faire face à l’angoisse engendrée par l’ombre portée de ce gouffre, pour pouvoir à la fois en dénier l’existence comme figure imaginaire et se protéger de l’effet réel que cette ombre a sur le psychisme, que se met en place ce processus de recouvrement ou de déni de ce gouffre devenu originaire, de cette séparation devenue irréparable. Face à ce recouvrement se met en place un processus rendant le mensonge nécessaire en faisant, en particulier, de cette origine incertaine une forme de l’absolu, autant dire une non-source d’angoisse.
La désontologisation va se développer à travers l’histoire selon ces deux modalités dont elle constitue à la fois le secret et l’aveu. L’être va se trouver délégitimé par les mensonges accomplis en son nom et par l’épuisement de sa puissance magique au profit de celle des images techniques.










