
Accueil > Les rubriques > Appareil > Villes > Vêtement architectural
Vêtement architectural
Interview Claire Maugeais - Nathalie Viot
, et
Interview entre Nathalie Viot, conseillère art contemporain à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et Claire Maugeais...
Interview

Nathalie Viot, conseillère art contemporain à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris : Peux-tu nous rappeler la genèse de ton travail, tes grandes inspirations, les personnes qui t’ont aidée, celles qui t’ont influencée, tes plus anciens souvenirs qui ont eu une influence déterminante pour toi ?
Claire Maugeais : En 1993, j’ai été invitée dans une galerie à Frankfurt où j’ai expérimenté ma première installation éphémère : « Où es-tu, lorsque tu es là où tu es ? ». Cette installation se déployait exclusivement sur les murs au moyen d‘images photocopiées, de tapisseries et de peintures. La peinture était réduite à un monochrome. L’image finale était une photocopie géante. Le spectateur était au centre, il n’y avait aucun objet, seulement des surfaces.
Beaucoup de choses ont facilité mon travail sur l’architecture. Tout d’abord cette rencontre déterminante avec un étudiant des beaux-arts de Paris. Nous partagions beaucoup de choses sur la conception que nous avions de l’art. Je lui ai demandé où je pouvais voir son travail, et il m’a répondu : dans ma poche, et d’un geste, il m’a montré une disquette. Il suivait un des premiers ateliers multimédias de l’école.
Quand je me suis installée à Marseille en 1990, c’était le tout début des images virtuelles. Je me suis dit que désormais, je ne pourrais plus travailler de la même façon.
Finalement je n’ai jamais franchi le pas du virtuel, mais j’ai éliminé l’objet de mon travail pour libérer le spectateur dans ses déplacements et éviter l’œuvre comme centre. Je cherchais un art plus environnemental, un contact direct avec l’instant du « être ici ».
Ensuite j’ai réalisé des installations sur vitres, un lieu plus évanescent avec les reflets et la lumière naturelle. Cela m’a permis de travailler dans tous les sens : devant, derrière, depuis le dedans du bâtiment, ou depuis la rue etc....
Occulter une fenêtre me permettait de jeter un trouble sur la situation géographique, de complexifier le rapport à l’espace, de faire passer le spectateur de part et d’autre du travail quand il s’agissait de baies vitrées, ou encore de travailler avec la lumière (Université des Lettres d’Aix-en-Provence, « les entours » 1997).
De toutes ces installations, il ne reste que des images, tout a été détruit.
À l’époque je ne montrais pas les dessins et les collages qui servaient à leur élaboration. Aujourd’hui je suis moins restrictive, je montre ce qui me sert à penser. Ce sont des « dessins », je le dis avec des guillemets parce que je les nommerais plutôt des trames. C’est un travail sur le geste et la représentation où je prends en compte le déplacement de ma main, les deux côtés du support, la vision de biais etc.… Je les appelle aussi les portatifs, parce qu’ils sont des éléments autonomes.
Par contre je n’échappe toujours pas, dans ces travaux, à l’obligation de la présence physique du spectateur. Aucun cliché photographique ne peut rendre compte de ce qui y est mis en œuvre (cf. p. 14 – 15, série Paysage 4 et 5).

NV : Tu as, au début de ton travail, réalisé plusieurs œuvres éphémères. Qu’est-ce qui t’a poussée à arrêter ?
CM : La dernière installation éphémère en papier que j’ai réalisée sur l’architecture, c’était en 2001 sur la façade du Frac Alsace dans le cadre de Sélest’art. Le titre était : « Et tous ils veulent voir la mer ». Le Frac est un bâtiment tout en verre, une sorte d’aquarium vitré qui ressemble plus à un show-room pour concessionnaire automobile qu’à un centre d’art. Je n’avais jamais réalisé d’installation aussi monumentale, c’était très important pour moi. L’ensemble de la façade en verre était occultée par des photocopies et en grande majorité de papier blanc.
L’intégration de mon intervention à l’architecture du centre d’art était si totale qu’elle devenait invisible. J’avais franchi une limite. D’autre part les lieux commerciaux commençaient à utiliser les vitres comme supports publicitaires, je me suis dit alors qu’il fallait vraiment se positionner. Je devais choisir les lieux de mes interventions et me situer dans l’espace public, dans la cité, dans le politique.
La nature de la représentation que j’utilisais ne devait créer aucune ambiguïté sur l’enjeu du travail : les idées, les signes de la représentation et le rapport au corps. J’ai alors souhaité me rapprocher des architectes.
J’ai ainsi développé des techniques qui me permettent de réaliser des œuvres pérennes tout en gardant les qualités de mes installations éphémères. J’ai réalisé par exemple des sols imprimés qui évoluent ou non dans le temps.
La technique que j’utilise aujourd’hui avec le verre me permet de travailler aussi bien l’opaque que le transparent. C’est-à-dire que je peux varier l’impact sur le quotidien des personnes pratiquant ces espaces, la lumière y sera toujours prise en compte.
Je termine actuellement une œuvre sur le nouveau bâtiment des archives historiques de la Nièvre, une architecture de Patrick Mauger. J’ai utilisé un procédé verrier qui a toutes les qualités du vitrail, sans la matière.
Comme pour cette œuvre dans le Sentier, je suis intervenue sur les côtés du bâtiment et j’ai laissé libre la grande façade.
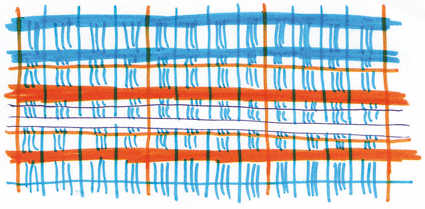
NV : L’architecture a toujours été très importante pour toi, peux-tu dire comment ?
CM : Dans les années 80, l’art proposait un retour à la peinture et à l’objet comme une critique du modernisme. Les propos sur l’architecture et sur la transformation du paysage et des villes me semblaient beaucoup plus intéressants, plus constructifs, plus engagés, plus proches de là où je souhaitais aller, c’est-à-dire m’inscrire dans la cité. Créer des œuvres qui sollicitent l’habitant dans son quotidien, le confronte à l’espace public, à l’espace politique dans son déplacement et dans son regard.
Il y avait de vraies interrogations sur les lieux d’exposition de l’art, les musées, les galeries… et c’est ce qui m’a poussé à développer des installations éphémères sur l’architecture.

NV : Cette commande est particulière, elle naît de la volonté du conseil de quartier d’un « désir d’art » comme l’écrit Christian Ruby, peux-tu nous dire comment tu as investi cette commande ?
CM : Tous les conseils de quartier des arrondissements de Paris se voient allouer une certaine somme d’argent. Ce conseil de quartier a mis de côté plusieurs années de budget pour commander une œuvre d’art.
Dès lors, on se doit de répondre avec beaucoup de générosité. Le conseil de quartier m’a fait visiter le quartier, m’a parlé des bâtiments, du développement de l’activité économique liée au textile et m’a fait découvrir les passages, les rues etc…

NV : Comment as-tu travaillé avec le quartier ?
CM : Paris est une ville-musée, elle a été épargnée par les guerres, le quartier en témoigne et les nombreux édifices classés au patrimoine historique compliquent la commande. La demande du conseil de quartier n’était pas précise en tant que telle. Le conseil de quartier souhaitait une œuvre, dans un périmètre défini, mais aucun lieu n’était pressenti. J’ai dû, au même titre que les autres artistes en concurrence sur ce projet, inventer l’espace de mon travail.
J’ai beaucoup circulé, arpenté les rues… J’ai d’abord élaboré un projet sur le non-alignement des façades des rues qui créent des décrochements. Et puis un jour lors d’une de ces promenades, alors que j’étais passée de nombreuses fois devant ce bâtiment, il s’est imposé comme idéal : ses lignes, ses trois faces sur rue, sa hauteur... Il me restait à souligner les choses. À rendre visible ce que j’avais vu.

NV : T’es-tu inspirée de l’histoire du quartier ? Quelles formes cela a pris ?
CM : Le titre de mon intervention est : Vêtement architectural. C’est une forme d’échantillon textile géant. Bien sûr cela renvoie à l’activité économique prédominante dans l’arrondissement. Depuis la rue de Réaumur, la vision d’une des façades est un vrai signe urbain.
Lorsque j’interviens quelque part, il faut que le travail trouve un cadre. Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi cet immeuble. C’est un ovni dans ce quartier historique. La façade n’est pas une structure porteuse du bâtiment, sa trame est un plan libre. Mon intervention la renforce, la souligne.
Cette trame en façade est tellement proche de mes préoccupations, et j’essaie toujours de créer des résonances entre mes différents travaux. On retrouve des trames au sol par exemple dans mon premier 1% artistique à St Vallier dans la Drôme, et aussi dans la série des mouchoirs d’homme et surtout aujourd’hui dans mes « dessins ». J’aurais pu également appeler cette installation : « échantillon géant », pour réduire le bâtiment à l’état d’exemple, de modèle.
Les « modernes » voulaient rompre avec tout ce qui n’était pas l’essentiel du matériau et de la forme (la pensée de la forme). J’ai intégré le post-modernisme dans mon travail, mais je ne suis pas pour autant dans le décoratif. Il y a des alternatives qu’il faut trouver. Je pense que je suis assez satisfaite de cette œuvre justement parce qu’elle amène de la couleur dans la ville, une interprétation, un point de vue sur l’espace et le déplacement… Mais jamais elle ne nie le bâtiment dans ce qu’il est, dans sa surface, dans sa composition. Je joue avec lui, je le révèle et nous travaillons ensemble…
NV : Quelle est l’origine du choix des couleurs ?
CM : Bleu, Orange… Je ne mets aucun sens dans la couleur, je veux dire que la couleur, c’est pour moi le moyen de différencier des espaces, tout simplement. Il n’y a pas de signification ou de symbole. Je m’intéresse plutôt à l’impact coloré, à la capacité visuelle des choses. J’ai longtemps travaillé en noir et blanc avec mes photocopies sur papier, parfois il faut révéler de façon plus significative.
En décembre 2007, quand j’ai commencé à travailler à la commande, il faisait froid, je portais une écharpe de laine usée, ajourée et de couleur orange et bleu (cf. p. 6). Les deux couleurs étaient égales en intensité, je n’ai pas cherché plus. Parfois, on peut simplement emprunter au réel.

NV : Quelles ont été tes relations avec le propriétaire du bâtiment d’une part et l’entreprise d’autre part ?
CM : J’ai eu beaucoup de chance parce que la recherche du propriétaire est une histoire magnifique. Le bâtiment appartient à un fonds de placement autrichien. C’est un vrai miracle que mon interlocuteur soit amateur d’art et enthousiaste sur le projet. Il a évidemment posé des questions, sur les couleurs, sur le fait de ne pas intervenir sur toutes les faces du bâtiment, mais il a accepté toutes mes réponses comme un choix artistique et je lui en suis vraiment reconnaissante. C’est très rare de trouver des conditions aussi satisfaisantes.
Lorsqu’on travaille dans l’espace public, on ne peut pas tout faire. Je me suis chargée de la conception et j’ai mis en place une équipe pour la réalisation. J’ai fait appel à des compétences diverses. Les entreprises qui ont réalisé l’œuvre sont les premiers spectateurs. Elles ont souvent des choses à dire. Les peintres ont compris par exemple que je ne souhaitais pas suivre les bords arrondis des fenêtres et que je créé un système graphique non systématique.
NV : Tu as une certaine habitude de la commande, en quoi celle-ci est différente ?
CM : C’est la première fois que des usagers (conseil de quartier) sont les commanditaires, en général les commandes émanent de collectivités territoriales. Entre mes premiers dessins de décembre 2007 et aujourd’hui, 5 années se sont écoulées. Cela peut paraître long mais il y avait beaucoup d’interlocuteurs : le conseil de quartier qui est à l’origine du projet, la mairie du IIe arrondissement qui finance, le département de l’art dans la ville, qui assure le suivi, le comité de l’art dans la ville qui émet un avis sur les artistes et les œuvres, le propriétaire, le Maire de Paris qui décide, les architectes des bâtiments de France, et enfin l’entreprise. Sans compter les autorisations de voirie... Cela fait beaucoup.
J’avais l’habitude de travailler avec un budget en étant responsable jusqu’au bout de l’ensemble de la réalisation. Là, il a fallu composer et j’ai beaucoup appris.

NV : Quand tu vois le résultat aujourd’hui après toutes ces années, qu’elles sont tes observations, ce que tu changerais maintenant avec l’expérience ?
CM : Je ne changerais rien. Lorsque les autorisations ont été réunies pour procéder à la réalisation de l’œuvre, je me suis évidemment replongée dans le dessin. Très vite, j’ai abandonné l’idée de retravailler le projet parce qu’il était juste et que cinq années n’avaient pas modifié mon point de vue sur cette commande.
Au départ, j’ai réalisé des études dessinées de lignes, à plat, puis des simulations in situ d’après photographies, des visions de biais puisque les rues sont très étroites. Le fait de devoir remettre le dessin à plat en vue du plan de réalisation pour les peintres m’a permis de voir ce qu’il était vraiment. Je n’ai pas fait le calcul, mais il y a peut-être moins de 30 % de surface peinte sur chaque façade. Ce sont des lignes étroites pour la plupart et seule la surface saillante du bâtiment est peinte.
Tout le monde me dit qu’il y a plus d’orange sur cette façade, en réalité il y a plus de bleu. La perspective réduit la perception de l’épaisseur des lignes hautes et crée un effet rétrécissant. Terminer par un bleu crée un passage avec la couleur du ciel et allège l’ensemble.
Le fait d’avoir laissé la façade principale rue des Jeuneurs vierge était très important. Les deux façades peintes encadrent le bâtiment. J’ai imprimé sur les côtés une nouvelle vision, j’ai révélé au spectateur ma vision des choses et je laisse la grande façade à la vision de chacun.
Mon intervention ne cherche pas à camoufler, à maquiller, à décorer, mais à révéler l’architecture. Nous n’avons pas procédé à une rénovation de la surface, nous avons juste lavé la surface pour un bon maintien de la peinture. Si certains défauts en façade demeurent présents, cela ne me dérange pas, c’est la réalité du bâtiment. Je ne crée pas d’illusion, je suis dans le concret de la surface. C’est le geste de venir pointer du doigt ce bâtiment qui m’importe.
Le fait que les deux faces peintes se fassent dos oblige les passants à circuler, ils ne peuvent pas voir la totalité de l’œuvre d’un seul coup d’œil. D’ailleurs ce que l’on m’a rapporté, c’est que l’on découvre d’abord une façade, on sait ou non qu’il y en a une autre. Lorsqu’on la découvre, on est alors tenté de revenir à la première, pour savoir si c’est la même…
Voir en ligne : http://www.clairemaugeais.com/
Claire Maugeais
Née en 1964, vit et travaille à Paris.

