
Accueil > Voir, Lire & écrire > VIII. La fractale du conflit
VIII. La fractale du conflit
Suite Lettre au tyran - VIII
,
Robert Musil, dans une conférence intitulée De la Bêtise, prononcée à Vienne les 11 et 17 mars 1937, pouvait distinguer deux types de bêtise, l’une naïve et l’autre intelligente. Ses propos sont toujours d’actualité.
Inutilité du savoir
Robert Musil, dans une conférence intitulée De la Bêtise, prononcée à Vienne les 11 et 17 mars 1937, pouvait distinguer deux types de bêtise, l’une naïve et l’autre intelligente. Ses propos sont toujours d’actualité.
« Ce terme englobe donc deux espèces au fond très différentes : une bêtise toute honnête, toute simple et une autre qui, assez paradoxalement, peut même être un signe d’intelligence. La première tient plutôt à une faiblesse générale de l’entendement, la seconde, à une faiblesse de celui-ci par rapport à un objet particulier ; c’est de loin la plus dangereuse. [...] Entre cette bêtise honnête et l’autre, la supérieure, la prétentieuse, le contraste n’est souvent que trop criant. Cette bêtise-là est moins un manque d’intelligence qu’une abdication de celle-ci devant les tâches qu’elle prétend accomplir alors qu’elles ne lui conviennent pas ; elle peut comporter tous les caractères négatifs d’un entendement faible, mais avec, en plus, tous ceux qu’implique une affectivité déséquilibrée, contrefaite, irrégulière, en un mot : maladive. [...] Cette bêtise supérieure est la vraie maladie de la formation — disons qu’en fait, pour éviter tout malentendu, elle est absence de formation, formation manquée, malvenue, déséquilibre entre sa substance et sa force ; et la décrire serait une tâche presque sans fin. Elle peut affecter jusqu’à la plus haute intellectualité ; car si la bêtise authentique est une artiste paisible, la bêtise intelligente, qui contribue à la mobilité de la vie de l’esprit, entraîne surtout son instabilité et sa stérilité. Il y a bien des années déjà, j’écrivais ceci : « Il n’est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage ; elle peut se mouvoir dans toutes le directions et prendre tous les costumes de la vérité. La vérité, elle, n’a jamais qu’un seul vêtement, un seul chemin : elle est toujours handicapée. [...] La bêtise dont il s’agit là n’est pas une maladie mentale ; ce n’en est pas moins la plus dangereuse des maladies de l’esprit, parce que c’est la vie même qu’elle menace. » (Robert Musil, Essais, p. 313-315).
Les dernières décennies ont été marquées par un prolongement et une accélération de ce processus, au point que les structures porteuses de la bêtise intelligente ont réussi à prendre un contrôle quasi-général sur les données du savoir. La bêtise intelligente se sent maintenant suffisamment sûre d’elle pour s’autoriser à prétendre être le véritable inventeur et le véritable détenteur de ces connaissances.
Elle livre donc un combat nouveau. Elle conteste leur statut aux structures du savoir porteuses de vérités, c’est-à-dire aux fondements même de la culture et de la conscience historique.
Pour la conscience historique, l’accord du savoir avec les structures affectives et psychiques constituait sinon un but du moins le principe recteur et le principe d’orientation permettant précisément d’ordonner les connaissances. La bêtise intelligente a perçu dans cette contrainte une limite à ses prérogatives. Elle a ressenti cette limite comme une atteinte à sa puissance et elle tente de lever cet obstacle par tous les moyens. Elle voit dans cette exigence un programme et une direction à suivre et elle tient la libération de cet impératif implicite contenu dans les formes traditionnelles du savoir comme un objectif à atteindre en soi. Ce programme est en tout point semblable au processus de désinhibition prenant appui sur une idée qui se trouve être une fiction, fiction à laquelle la bêtise intelligente « croit » comme à un dieu. Elle s’est donnée pour objectif d’éradiquer les fondements du savoir et les assises de la conscience qui constituent, pense-t-elle l’obstacle majeur à son déploiement « dans toutes les directions ».
À la forme historique de la continuité, la bêtise intelligente tente par tous les moyens de substituer une « continuité en étoile », anhistorique donc, mais totalisante. Mais à la différence du savoir historique et de la conscience historique, elle ne peut accepter qu’il existe quelque chose qu’elle ne contrôle pas.
La bêtise intelligente a une conception purement guerrière de la connaissance, là où le savoir lié à la conscience historique entretient avec les zones d’ombre de la connaissance une relation plus complexe et plus ouverte. Si le savoir « sait » quelque chose, c’est précisément qu’il n’est ni clos ni total. Il « sait » aussi que la condition de son extension de son devenir, de son existence, est précisément de n’être pas totalitaire. Il est d’ailleurs porté par l’exigence de vérité qui consiste à « croire ce que l’on sait », une fois les connaissances validées, mais à savoir les remettre en cause si de nouvelles données venaient à les invalider et à ne pas aller dans toutes les directions pour le seul plaisir de le faire lorsque cela n’est pas nécessaire.

La bêtise intelligente a besoin de se désinhiber afin d’oublier quelle ne sait ni ne contrôle tout. Le savoir et la conscience historique ont besoin, par contre, de prendre en compte cette nouvelle puissance de contrôle de la bêtise intelligente, s’ils ne veulent pas voir le monde qu’ils ont permis d’inventer, disparaître avec la vie même.
La bêtise intelligente « est » tyrannie
La tyrannie contemporaine prend sa source dans ce double phénomène qui affecte l’humanité actuelle, la peur devant les tâches qu’elle devrait affronter et la conséquence qui consiste à mettre ses mains devant ses yeux pour ne pas avoir à tenir compte de ce que l’on craint de découvrir. Dans le même temps, elle se trouve avoir accès à un stock illimité de connaissances qui devrait l’aider à s’orienter, mais cette quantité incalculable l’effraie et renforce la prégnance de la crainte elle-même. Elle invente pour tenter de réduire cette angoisse, des appareils et des images dont le fonctionnement n’est pas celui qui prévaut dans la conscience historique.
Héritière directe de la bêtise intelligente, la tyrannie niche et exploite ce décalage en le multipliant. Plus exactement elle prend appui sur lui et l’exploite en renvoyant à la conscience historique l’image falsifiée de son échec. Les moyens dont dispose la tyrannie étant d’une ampleur inconnue à ce jour, elle profite pour s’intensifier et se multiplier de la « faiblesse » native de l’intelligence au service de « la » vérité qui s’attarde inévitablement sur les dysfonctionnements liés à cette situation de crise et tente d’établir des formes de compréhension compatibles avec la continuité historique et avec le dispositif de la conscience.

Il n’en reste pas moins que la bêtise intelligente « sait » quelque chose qui lui sert de principe directeur : qu’elle ne disposera jamais des moyens dont dispose l’intelligence entée sur le savoir pour comprendre les choses parce qu’elle n’a pas créé les bases de la compréhension. C’est pourquoi la tyrannie ne peut considérer tout autre manière d’appréhender le réel que comme un danger à éliminer.
La bêtise intelligente est la source de la tyrannie car elle est en guerre contre tout ce qui lui rappellerait qu’elle est d’abord bêtise, c’est-à-dire incapable d’associer mental et psychique, ratioïde et non-ratioïde, compréhension et décision.
Elle a pour elle, pourtant, de passer pour rapide à « décider », au moins en apparence, c’est-à-dire pour se comporter comme le fait l’intelligence mais en allant plus vite qu’elle. C’est qu’elle décide toujours « par défaut ». Ce qu’elle a appris, c’est qu’il lui suffit de multiplier les occasions de prise de décision pour faire croire qu’elle prend des décisions, là où elle ne fait qu’entériner de faux choix ou des choix insignifiants, comme en sont remplis les jeux de toutes sortes qui ont envahi les écrans depuis quelques décennies.
Une tyrannie se révèle donc dans la manière qu’elle a concrètement de se positionner vis-à-vis du savoir, du travail compris comme effort en vue de la transformation de soi, de la transmission des connaissances et du partage entre connaissances et croyances.
Les mesures prises en Europe et en France en particulier depuis quelques années, dessinent avec une précision inégalée la forme d’un conflit et se révèlent d’une rare « violence ». En effet, elles tendent toutes à accroître les privilèges de la bêtise intelligente et à lui permettre d’étendre son empire en s’attaquant directement à ce qui sépare la bêtise intelligente, de la conscience historique, des sources du savoir et de l’exigence qui le fonde.
Dans un essai de 1918 intitulé La connaissance chez l’écrivain, Robert Musil écrivait : « Telle est la patrie de l’écrivain, où sa raison est suzeraine. Alors que son contraire cherche le solide et s’estime satisfait chaque fois qu’il peut établir, dans ses calculs, autant d’équations qu’il découvre d’inconnues, ici de prime abord, il n’y a pas de limites aux inconnues, aux équations, aux possibilités de solution. La tâche consiste à découvrir sans cesse de nouvelles solutions, de nouvelles constellations, de nouvelles variables, à établir des prototypes de déroulement d’événements, des images séduisantes, des possibilités d’être un homme, d’inventer l’homme intérieur. » (Robert Musil, Essais, p. 83).

En d’autres termes, la bêtise intelligente ne reconnaît pas l’existence de l’homme intérieur et c’est contre « lui » qu’elle mène son combat, ou si l’on veut contre la forme historique de la conscience. L’ampleur des moyens dont elle dispose lui donne simplement des chances plus grandes de réussir dans son entreprise qui consiste à attaquer les fondements mêmes de la conscience historique.
La fractale du conflit
Les formes contemporaines de la tyrannie ne tiennent donc pas à la seule figure du tyran. La tyrannie a besoin pour étendre son empire du soutien de ceux-là mêmes qu’elle opprime. En prise directe sur l’imaginaire pulsionnel, la tyrannie émet des signaux vers ceux qu’elle fascine. On ne peut faire de portrait robot de ceux qui soutiennent la tyrannie, mais on peut inventorier les points qu’ils ont en commun et qui font d’eux sinon un peuple du moins une masse compacte.
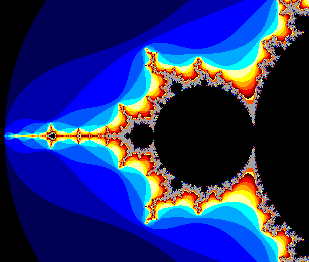
L’observation de la politique concrète menée par une tyrannie suffit à dresser une carte des zones de conflit. Ces zones de conflit sont au nombre de quatre. La première se situe dans le champ du savoir, la deuxième autour de la question du travail, la troisième touche à la mémoire et à la transmission, la dernière traverse les croyances et les comportements.
Les lignes de partage opposent certes ceux qui possèdent à ceux qui n’ont rien, mais elles se déplacent et se multiplient aussi à l’intérieur de chaque strate sociale. Ainsi ceux qui ont tout ou presque doivent se battre pour continuer à posséder ce qu’ils possèdent et à s’enrichir plus encore, lors même que ceux qui n’ont rien se voient acculés à se battre pour tenter de ne pas avoir encore moins. Les premiers comme les seconds sont mûs par les mêmes craintes, ne pas déchoir, ne pas se retrouver, moins haut ou plus bas dans l’échelle sociale. Cette crainte de la chute est le moteur « secret » de la tyrannie contemporaine. C’est en son nom que sont commis tant de crimes.
Cette crainte constitue le mode de propagation du modèle psychique dominant et détermine ce que l’on doit appeler la fractale du conflit, le fait que ses formes et ses modes de diffusion sont plutôt semblables dans toutes les strates et dans tous les champs.
Dans ce laboratoire dont la carte recouvre le monde, toutes les expériences commencent à se ressembler parce que c’est, en fait, la même expérience qui est poursuivie, celle de l’asservissement de la majorité des humains par des groupes de plus en plus restreints, connectés entre eux et complices, même lorsque, sur tel ou tel territoire, ou dans tel ou tel trafic, ils sont ennemis.
Cette unité paradoxale de l’expérience tient à un phénomène singulier que l’on pourrait appeler l’évolution de la conscience historique. Cette évolution atteint sous nos yeux, son point de rupture. La rupture a lieu autour de nous comme dans nos cerveaux. Elle affecte la totalité de l’humanité. Les régions du monde qui l’ont vu naître sont en position de domination. Elles transmettent aux autres régions ce qu’elles pensent être leur modèle de civilisation et qui n’est finalement rien d’autre qu’un virus dont elles ne peuvent plus guère ignorer être porteuses.
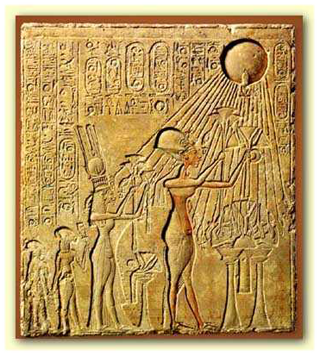
Chaque action menée depuis deux ou trois siècles par les pays européens puis par les États-Unis a eu pour objectif d’éradiquer dans les autres régions du monde les modes de fonctionnement aussi bien mentaux qu’économiques, culturels que perceptuels qui s’y développaient parfois depuis des millénaires. Ils étaient perçus par les puissances dominantes comme faisant barrage à leur domination. Sous couvert de les soigner d’un mal dont ils ignoraient être atteints, ils ont assuré la propagation d’une soi-disant bonne santé qui se trouve être ou être devenue une maladie.
Aujourd’hui, par un retournement prévisible de l’histoire, on assiste à une double prise de conscience ressemblant pourtant à un aveuglement de la part des pays dominants. Ils savent que c’est d’un virus dont ils étaient porteurs et ils découvrent qu’ils sont à leur tour touchés par la maladie dont ils étaient auparavant les porteurs sains.
La conscience historique
Ce virus attaque simplement la conscience ou plus exactement la forme historique de la conscience. L’esprit humain fonctionne par projection sur les phénomènes de données issues de l’espace mental. Ce que l’expérience renvoie est ensuite comparé à ces données préliminaires, puis le résultat des corrections est à nouveau projeté sur le monde, et ainsi de suite. De nombreux modèles ont ainsi été constitués par une série infinie d’essais et d’erreurs et de sélection des « meilleurs » résultats. L’essentiel reste que la mise en place d’un tel réseau a pour but d’assurer la continuité entre les différentes strates temporelles. La saisie de l’altérité s’effectue donc à partir d’un point de vue englobant supposé unique mais, cependant, toujours duel. La conscience est le dispositif psychique résultant de cet effort constant visant à relier les éléments épars de la connaissance, en essayant de les distinguer ou plutôt de les intégrer dans des formes de croyance mais sans pour autant parvenir à produire une « continuité » qui ne serait pas englobée par l’oubli.
La particularité de l’altération de la conscience historique que l’on vit aujourd’hui tient à la résurgence d’un conflit qui l’a cependant toujours agitée. Il oppose précisément les modes de connaissance aux modes de perception, conflit rendu particulièrement ardent depuis que l’homme s’est doté d’appareils qui sont comme des extensions de certaines de ses fonctions cérébrales. S’il contrôle les appareils, il est aussi contrôlé par eux ou plutôt doit se soumettre à eux en retour. Cela signifie simplement que les modalités de la transmission des informations par les appareils ne correspondent pas à celles qui prévalaient, il y a encore quelques décennies.
Le psychisme est profondément affecté par l’effet en retour tant des données que des modalités de leur transmission et il se retrouve à la fois divisé et incapable de prévoir ce qui va advenir. Certains semblent avoir anticipé sur cette situation et cherchent à en tirer profit afin d’accroître leur puissance. Ils participent ainsi de manière active à la transformation d’une mutation psychique en virus mortel.

Ce moment de mutation est marqué par l’apparition d’un « nouveau » mode de fonctionnement psychique. L’oxymore est sa signature. Il atteint, au cœur du dispositif de la conscience, chacune de ses zones constitutives qu’il déconnecte de l’ensemble, divise et fait fonctionner mais en les retournant contre elles-mêmes. Chacune de ces zones correspond aux grandes activités humaines que sont les gestes nécessaires pour assurer la vie matérielle, l’acquisition de connaissances, leur transmission et le partage des croyances.
Ce qui se produit à la fois sous nos yeux et en nous est donc une mutation brutale et profonde de notre fonctionnement mental. Nous en sommes les acteurs et les cobayes, les auteurs et les victimes et ne savons pas comment échapper au piège que, comme humanité, nous nous sommes tendus à nous-mêmes.
Si nous ne pouvons y échapper, c’est que certains ont repéré les bénéfices qu’ils pouvaient tirer de cette situation incertaine. Une telle attitude, profiter d’une situation pour en tirer des avantages, n’est pas nouvelle. Elle s’accompagne d’un partage inégalitaire que La Boétie en particulier a parfaitement expliqué. C’est le cadre dans lequel elle prend place qui lui fait changer de statut.
Le point de vue englobant qui assurait le lien « historique » entre tous les éléments participant au dispositif de la conscience et toutes les données qu’ils émettaient, est désormais perçu ou plutôt présenté par « certains » comme un obstacle à l’accélération de l’acquisition des données émises par les appareils qu’ils prétendent contrôler. Il est même présenté par certains « idéalistes totalitaires » comme l’obstacle unique, qui une fois levé permettrait l’accès à l’« infinité » des informations censées générer une infinité de profits. Cet obstacle est lié aux limites du psychisme. Il est même sous certains aspects, le psychisme lui-même en tant qu’il répondrait encore au schéma général de la conscience historique.

Il s’agit donc dans le laboratoire des temps post-historiques de porter cette nouvelle forme de division à l’intérieur du psychisme afin d’en faire un moyen de sélection en l’utilisant comme moteur de la déstructuration de la forme historique de la conscience, pôle finalement unique de la résistance à cette mutation aux allures de destruction généralisée.
En d’autres termes, l’enjeu est de faire considérer comme « normal » que la main droite ne sache pas ce que fait la main gauche et que le « sujet » ainsi divisé n’éprouve aucune gêne, à vivre dans cette « ignorance », soumis qu’il est en permanence au diktat de l’oxymore politique devenu la règle et la loi de la gouvernance tyrannique et donc aux voix du dehors qui lui dictent de manière directe ou subliminale ce qu’il doit faire.
Ceux qui en souffrent sont considérés simplement comme inaptes à certaines fonctions, celle de Divinant, mais aussi de représentant actif de la domination. Pour l’instant, ces souffreteux, on les laisse jouer avec les oripeaux de la conscience historique, vaste amas de fragments de connaissances disjointes. Aux autres sont octroyées les « joies » du jeu avec le principe de disjonction lui-même. Mais le besoin d’étendre la domination conduit « mécaniquement » à laisser croître l’accélération du processus. Ceux qui « croient » encore à la conscience deviennent alors tout simplement des ennemis. Il faut donc mettre en place un processus efficace afin de les éliminer.
Cela a donc conduit les tenants de la mutation forcée à jouer avec le principe, c’est-à-dire à jouer avec le jeu et avec les règles et à déterminer, sans que ceux qui jouent ne sachent qu’ils ne jouent qu’à un jeu sans importance, car ils sont en fait les pièces d’un autre jeu auquel s’adonnent ceux qui les dominent.
Le propos de la domination est donc double. Il s’agit d’une part de jouer sur et avec la conscience et donc de maintenir par discours officiels et médias interposés la croyance en son existence et en sa puissance régulatrice, et d’autre part de jouer « la conscience » pour pouvoir mieux « la perdre ». Dans le second cas, la conscience est à la fois mise en jeu et en joue. Elle sert de « joujou » dans une expérience complexe qui vise à son abolition en tant que principe régulateur des actions humaines, fondement de la continuité « historique » des événements et des connaissances et des possibilités de penser le « vivre ensemble ».

Dominer, c’est donc jouer mais au sens de faire la guerre à l’autre et de lui faire une guerre permanente. Il n’y a pas d’autre moyen pour assurer sa domination que de faire sentir constamment qu’elle s’exerce. C’est ainsi que les quatre champs constitutifs de la conscience font l’objet d’une tentative de déstabilisation permanente. Le signe distinctif de la tyrannie « est » cette guerre menée contre la connaissance, le travail, la mémoire et la culture. Ce n’est qu’en acceptant ces prémisses que la politique menée en Europe depuis quelques décennies peut devenir lisible. C’est aussi à cette condition qu’il sera possible de mesurer comment la conscience peut résister, non tant pour éviter de muter que pour accomplir « elle-même » sa mutation et non se voir contrainte de fléchir sous les assauts d’une bêtise avide de tout ramener à son niveau.
Il est possible de considérer que ces aspects sont déjà connus. En effet, la conscience est une structure complexe mais résistante et qui est le résultat d’un combat constant contre la bêtise, c’est-à-dire contre certaines tendances internes au psychisme.
Il se trouve cependant que certaines formes de bêtise ont réussi à se doter de structures nouvelles qui lui ont permis d’étendre leur empire. Paradoxalement, on peut dire que la bêtise intelligente a en quelque sorte réussi à progresser et à apprendre. Mais n’ayant d’autre légitimité que de proposer une version simplifiée des choses et de la vérité, seule censée pouvoir satisfaire les compétences supposées limitées de certains esprits, la bêtise intelligente ne peut étendre son empire qu’en menant cette guerre infinie consistant à se battre jusqu’à la mort pour gagner des parts de « marché ».
Une actualité brûlante
Il y a longtemps maintenant que l’on a pu remarquer que le système général de gouvernance en vigueur depuis la seconde guerre mondiale dans les pays dits développés était une forme rampante de tyrannie et en tout cas n’avait à voir avec la démocratie qu’à réduire celle-ci à des aspects comptables et formels. Il s’est trouvé que l’on n’avait pas encore besoin de tyrans pour gouverner ces pays-là. On laissait cela aux pays du tiers ou du quart-monde. Il se trouvait aussi que la plupart des gouvernants et des représentants de l’autorité publique étaient eux-mêmes encore des consciences historiques.
Il y a quelques années, on a vu apparaître sur le devant de la scène de certains pays riches et développés, des figures d’hommes désinhibés et proprement tyranniques. Il ne s’agissait plus seulement des membres de gouvernements ne prenant plus guère la peine de cacher la manière dont ils dirigeaient leur pays, il s’agissait de personnalités pouvant se targuer d’exercer un contrôle quasi intégral sur les rouages essentiels de leur pays. Le fait qu’ils aient pu bénéficier d’un soutien populaire semblait suffisant à leurs yeux pour les laver de tout soupçon. Il n’en reste pas moins que la Grande-Bretagne, les États-Unis et l’Italie en particulier ont connu ou connaissent encore de tels gouvernants.

Le précédent président des États-Unis a montré que l’on pouvait régner en tyran en n’étant soi-même qu’un pantin aux mains de groupes d’intérêts et de clans surpuissants. La tyrannie est une forme de gouvernance parfaitement adaptée à la situation actuelle d’autant qu’elle peut tout à fait se vêtir des oripeaux de la bonne conscience démocratique puisqu’elle en contrôle les mécanismes.
L’actuel président français incarne quant à lui le profil désinhibé de la tyrannie. Le président italien l’a précédé sur ce terrain en particulier, avec un certain succès puisqu’il a su revenir trois fois au pouvoir après en avoir été chassé. Mais la désinhibition de la personne et son comportement « officiel » sont tout au plus des aveux déguisés ou des lapsus réussis comparés à la politique désinhibée et tyrannique qui est mise en œuvre d’une manière tout à fait légale. Montesquieu l’avait parfaitement vu qui notait dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence : « Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. »
Un survol des lois votées depuis deux ans et des projets en cours suffirait à montrer, au-delà de la logique inhérente à une politique tyrannique, sa réalité concrète. La tyrannie, même si elle est revêtue de l’uniforme de la loi, se déploie dans la réalité en s’opposant aux formes du savoir, à l’utilité du travail, aux possibilités de transmission et maintient dans un obscurantisme médiatique le plus grand nombre de gens possible en les contraignant à croire ce qu’ils ignorent et à les empêcher de croire ce qu’ils savent.

Parmi les réformes mises en place ces dernières années relevons les plus emblématiques, celle des universités et de la santé, celle du code du travail, celle sur le contrôle d’internet, celles enfin concernant la fiscalité et les différents territoires constituant le pays.
Ces réformes peuvent parfois être de purs leurres au sens où elles mobilisent l’opinion par médias interposés et permettent pendant ce temps de faire passer d’autres lois, de loin plus scélérates, sans qu’elles ne soient présentées à l’opinion publique. Ce ne sont pas les soi-disant élus de la nation, petits Divinants de province muselés par leur propre parti, qui peuvent renverser cette tendance. Ils ont été dépossédés de leurs prérogatives avec leur assentiment, et ne savent plus comment reprendre la main pour faire passer des lois dont ils seraient les auteurs, car la main qui les muselle est aussi celle qui les nourrit et celle qui les punit.
Pour l’essentiel au-delà des lois et des projets de réforme, ce sont les mesures concrètes d’accompagnement, le plus souvent tenues secrètes et en tout cas jamais évoquées publiquement, qui forment la signature de la tyrannie. Ainsi la réforme interne de tel ou tel ministère, la vente forcée des biens de l’État en France et surtout à l’étranger, peuvent sans conteste être interprétées pour ce qu’elles sont, un pillage dont personne ou presque n’est informé et contre lequel personne ne peut rien dire.
Mais la marque la plus évidente d’une tyrannie reste l’appauvrissement rationalisé de son propre « peuple ». Il est vrai que cet appauvrissement se fait sous couvert d’une crise présentée comme planétaire.
Pour la première fois depuis la crise de 1973, une crise inventée de toutes pièces pour légitimer des mesures antisociales, on a vu apparaître dans le ciel bas et lourd de nos vies tremblantes, le nuage sombre d’une crise mondiale. En fait, il ne s’agit de rien moins que de l’application à la planète entière mais surtout à l’Europe, de la méthode et de la technique utilisée avec succès en Argentine en 2000 : le pillage des ressources monétaires d’un pays et la destruction de son économie productrice par l’intermédiaire des banques elles-mêmes. Nul besoin de forcer les coffres-forts à l’aide de chignoles rouillées lorsqu’il est possible de le faire par des jeux d’écriture et de savantes opérations boursières. L’objectif est à chaque fois le même : soumettre à la dure loi de la « nécessité » des populations avant qu’elles ne puissent avoir l’idée de se rebeller contre des conditions de vies déjà draconiennes et injustes ou avant qu’elles ne commencent, précisément parce qu’elles commencent à vivre bien, à vouloir enfin vivre à leur gré.

Viendrait-il à ces populations l’idée de se rebeller, tout est en place pour les en empêcher. La légalisation accélérée de tous les types de contrôles possibles, leur caractère évidemment outrancier, leur mise en œuvre aléatoire mais massive, pourrait paraître suffisante. Cela ne suffit pas à la tyrannie. Fondée sur la peur, elle n’échappe pas à la peur, la peur de se voir remise en cause en permanence. Du moins, elle se donne les moyens d’anticiper cette question et d’y répondre avant qu’elle ne vienne à se poser.
La dimension paranoïaque des tyrans et des tyrannies n’est plus à démontrer. Par contre ce qui semble faire défaut à la cohorte des Rumineux encore hantés par le spectre de la conscience historique, c’est la possibilité de « croire ce qu’ils savent ». C’est pourquoi la tyrannie qui agit en fonction de ce qu’elle sait tient à les empêcher par tous les moyens de pouvoir même goûter aux prémisses d’une telle « croyance ».
« Chers Rumineux, vous devez simplement prendre acte de ce qu’il est possible de savoir à travers les exemples que vous pouvez connaître et de ce qu’il vous est possible d’inférer grâce à un raisonnement construit mettant en relation ces exemples, et en particulier ce qu’il est possible de déduire concernant le schéma directeur de la gouvernance à laquelle vous êtes soumis. »
La signature de la tyrannie reste sa police. La France a connu en quelques années, en particulier depuis les émeutes à l’automne 2005, émeutes à but électoral évident et contrôlées de main de maître par des hommes de l’ombre, une évolution radicale du comportement de sa police pourtant déjà largement raciste, agressive et violente. Il apparaît que la police du tyran est autorisée à des actes qui jusque-là auraient été non seulement critiqués mais punis. En fait, pour la plupart ils n’auraient pas pu exister. À tyran désinhibé, police désinhibée. On l’a dit ce qui fait le tyran, c’est de savoir qu’il est invulnérable, c’est-à-dire protégé par ceux qui le soutiennent, tant qu’il travaille pour eux.
Si la police française peut s’autoriser à se conduire comme elle le fait depuis trois ou quatre ans, c’est qu’on l’y autorise. Elle se trouve dans la même situation que le tyran. Elle se sait ou se croit invulnérable, tant qu’il est là en tout cas. Cela signifie qu’elle sait, non seulement qu’elle sera couverte, mais qu’elle ne sera même pas condamnée officiellement et plus encore sera encouragée officieusement à poursuivre sa tâche. Cette tâche consiste, on le sait désormais, non pas à assurer la sécurité des citoyens, mais à générer l’insécurité qui est le mode même de la gouvernance tyrannique.

Cette insécurité à la base de laquelle elle se trouve, lui permet à la fois de maintenir les populations dans une forme d’angoisse permanente puisqu’elles peuvent être agressées tant par les tenants de l’illégalité que par ceux de la « loi », que de légitimer ses propres actes illégitimes et illégaux.
La ligne de partage qui existait entre légalité et illégalité ne sert plus à distinguer une marge externe d’un système général englobant et majoritaire, elle passe à travers chaque micro-espace social, chaque quartier, chaque banlieue, chaque ville, chaque État, fractale parfaite d’un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part et dans lequel, tous, nous sommes prisonniers parce qu’inclus.
