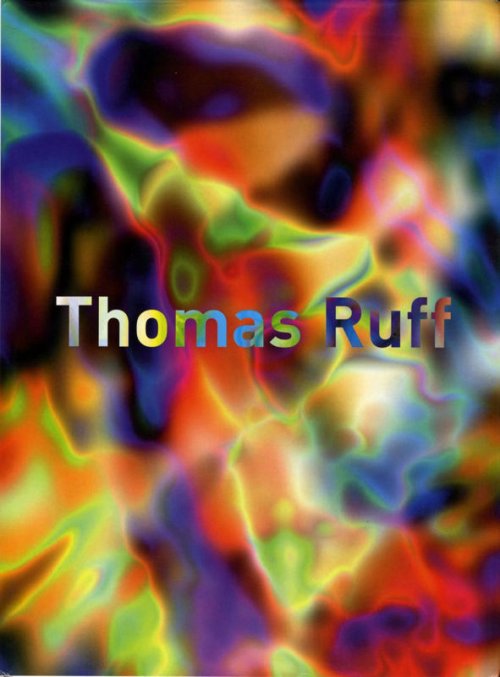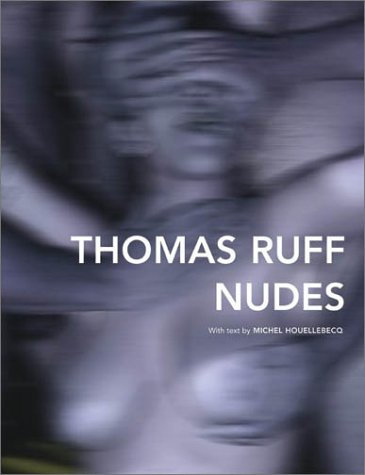Accueil > Inter-Action(s) > Expositions > Isabelle Hersant - Thomas Ruff
Isabelle Hersant - Thomas Ruff
Des pixels pornographiques qu’on prendrait pour des reflets astronomiques
, et
Il s’agira d’interroger la transformation paradoxale annoncée dans l’intitulé. Comment l’image pornographique, qui est image d’une chair hyper incarnée, peut-elle se faire l’image opposée que devient l’image subliminale produite par sa « simple » pixellisation ? Et dans la problématique que pose ce phénomène de transcendance, c’est au mécanisme de la fable que nous serons ramenés, productrice quant à elle d’images où se cristallise l’hyper présence du corps, entre un certain réel du rêve et une véritable fiction du fantasme.
Eminent représentant de la photographie contemporaine dite « objective » ou plus exactement en quête d’objectivité, l’artiste allemand Thomas Ruff apparaît des plus inattendus lorsqu’il ouvre une séquence d’œuvres réalisées à partir de simples, et somme toute banales, captures d’écran. En effet, relevant de la technique traditionnelle et du savoir très particulier qu’elle requiert, sa photographie s’inscrit à l’opposé de l’image de consommation telle qu’au-delà de la publicité, en produit désormais, et sur le même mode, l’univers de la pornographie.
Sur le même mode, ou plus encore peut-être. Cannibale par essence, n’est-ce pas sous l’espèce du tyran que la pornographie a plus encore triomphé, détrônant l’idée de consommation pour lui substituer celle de dévoration à travers le vertige infini des écrans qui l’ont rendue accessible en quelques clics. Historique moment que fut le tournant des années 2000, précisément celui où l’œuvre de Ruff connaîtra sa propre rupture. Après un parcours constitué de séries aussi diverses que des portraits, vues d’intérieurs et ciels étoilés, l’artiste né en 1958 commence alors un travail qu’il intitule Jpegs.
Sous ce titre explicite, le travail consiste à modifier des images qu’il prélève sur internet, paysages ou monuments, scènes de guerre ou vues touristiques. Et c’est à ce travail artistique que vient donc se rattacher l’ensemble issu d’images pornographiques formant ici la raison ultime d’une problématique qui sera élaborée au fil d’un plan découpé en trois parties. La première partie, tout d’abord, visera à déployer la façon dont l’ensemble des séries antérieures s’est construit par une succession de sujets différenciés, dont le traitement aurait peu à peu tracé la voie vers les captures d’écran.
Puis, la deuxième partie ainsi introduite s’attachera à distinguer les diverses ramifications du travail issues de ces captures, réunies pour constituer la série générique des Jpegs et dont l’analyse des enjeux se proposera en forme de théorisation. Enfin, la troisième partie sera consacrée à l’étude des Nudes, titre de l’ensemble réalisé selon le même procédé mais à partir de seules images pornographiques [1]. Ce faisant, la question de l’image par-delà la photographie sera reliée à celle de l’imaginaire par-delà l’image qui en résulte. Il s’agira de nouer le sujet même, celui du « déferlement des images », aux termes d’une interrogation existentielle de l’être face aux mondes fabuleux, fantasmatiques, qu’il édifie en tant que réalité du voir.
Séries antérieures, des Portraits aux Etoiles
Héritier du style documentaire en photographie, Thomas Ruff l’est devenu au plan international après avoir fait ses études d’art dans l’atelier des Becher. Bernd et Hilla de leurs prénoms, ce couple étant lui-même devenu mythique comme l’indique le fait que leur œuvre, soit leur œuvre en tant que style, a donné naissance à ce que l’on appelle en photographie contemporaine L’Ecole de Düsseldorf – du nom même de la ville où ils enseignaient dans les années 70 et qui est celle où vit et travaille jusqu’à aujourd’hui l’auteur des Jpegs.
A l’instar d’autres artistes formés à cette école, tels Thomas Struth ou encore Andreas Gurki, c’est aux racines d’un style exigeant que Ruff a fondé et développé son œuvre, la réalisant des années 80 aux années 2000 selon l’extrême rigueur qui le surdétermine tant au plan formel (composition, cadrage, lumière etc.) qu’au plan intellectuel – l’enjeu fondamental de l’image photographique comme œuvre artistique étant, selon ce style, la volonté d’objectivité contre toute tentation de subjectivité.
De fait, c’est là ce qui caractérise la grande série des Portraits avec laquelle il se fait connaître en 1984. Reprenant les codes de la banale photo d’identité, Ruff constitue un ensemble majeur où les traits distinctifs du visage de chaque personne représentée se confrontent à l’aspect répétitif du procédé. Et c’est à la notion d’un tel rapport dialectique que s’articulera toute l’œuvre de l’artiste. Ici, dans le rapport d’échelle qui porte le minuscule format de la photo d’identité à celui, gigantesque, des Portraits surplombant le spectateur, le caractère intime de la photographie en plan rapproché et qui n’a de valeur que personnelle, se trouve reporté à l’échelle hors échelle, justement, de la peinture d’Histoire – soit religieuse, mythologique ou politique, l’Histoire avec un grand H, et qui donnera d’ailleurs son format écrasant à l’imagerie de propagande initiée par le Réalisme Socialiste au XXe siècle, avant que n’advienne le déferlement de son avatar, comme on pourrait nommer l’imagerie publicitaire dans laquelle nous sommes désormais immergés.
Mais si les Portraits de Ruff nous arrêtent quant à eux dans une interrogation existentielle, c’est que leur froide « objectivité », leur neutralité dénuée d’affect, permet précisément d’en révéler l’intrinsèque vérité. Opérant le dépouillement de l’être qui se désincarne comme avoir contre l’artifice de l’avoir qui, à l’instar de la publicité, recouvre l’être jusqu’à l’asphyxier, Ruff crée le choc aussi invisible que silencieux d’une intimité confrontée à son exposition publique. Et dans cette confrontation sans concession, les Portraits qu’il réalise en nombre juxtaposent tout un jeu dialectique entre le soi et l’autre, le soi comme ressemblance et l’autre comme différence.
A partir de là, et tandis que des Sterne jusqu’aux Nudes des années 2000, les séries très différenciées vont se succéder dans le temps, Ruff ne cessera de donner corps à ce même questionnement. Comme le montrait déjà l’ensemble des Interiors qu’il avait commencé dans les années 70, c’est-à-dire avant les Portraits, nous voyons comment l’artiste cherche à ravir toute interprétation à son spectateur. L’extrême précision du cadrage venant soutenir l’expression de l’absence, de l’absence ou de l’attente comme fin du mouvement aurait peut-être dit Baudelaire, tandis que l’hyper-neutralisation de tout affect ainsi donnée à voir et à éprouver ne laisse plus aucune place à l’interprétation.
Mais s’il joue d’un rapport avec le minimalisme, c’est en écho inversé au célèbre axiome de cet historique mouvement qu’il s’inscrit. « What you see is what you see » disait le peintre Frank Stella [2] afin de signifier qu’il n’y a rien d’autre à voir que ce que nous voyons face à une œuvre où tout, y compris ce qui lui manque, y compris ce qu’elle n’a pas, est représenté. Et que nous dit quant à lui le photographe Thomas Ruff, sinon qu’il y a de même tout à voir dans ce que nous voyons face à son œuvre, y compris ce qui manque – mais nous manque à nous, cette fois. Non pas à elle, l’œuvre, mais bien à nous, spectateurs renvoyés à ce qui fait trou en nous face à elle.
Car ce que nous montre cette œuvre, au-delà de ce qu’elle représente, c’est ce que notre regard seul ne peut pas voir. A savoir, l’essence même de l’expérience photographique en tant qu’elle nous situe face à la nécessité de nous interroger sur notre place dans le monde, en nous situant face à la nécessité de nous interroger sur notre rapport au réel. Et pour autant qu’à ce monde où nous sommes tous en tant qu’il relève du réel, répond le réel en tant qu’il relève de tous les autres, tous les mondes que nous imaginons à l’égal des fictions que nous créons. En sorte que tous ces mondes, radicalement autres que ces fictions, n’en sont pas moins des constructions mentales au même titre qu’elles le sont elles-mêmes, ces fictions en question.
Pourquoi restons-nous en effet face à ces images évidées de tout affect et ainsi étrangères à ce que nous sommes, indifférentes à notre inaliénable désir d’empathie ? C’est qu’en dérobant le jeu des interprétations, elles laissent en nous la place entière pour l’interrogation sur le sens de notre existence. Notre existence, ce par quoi se forme la conscience d’un lien inaccessible, mais toujours invoqué si ce n’est espéré, entre notre monde et celui d’un au-delà qui nous est plus inconnu d’ailleurs qu’il nous est étranger.
Ainsi des Interiors, que l’on pourrait voir comme métaphore du monde intérieur qui nous habite à travers la saisie d’espaces domestiques dans lesquels nous vivons. Outre l’immobilité inquiétante dans laquelle Ruff les a arrêtés, on note la récurrence du motif. Faisant ainsi figure de décor, le motif prend une place de sujet en colonisant l’espace de l’œuvre. Bien loin de faire signe, le motif ici fait sens, sens de la mort qui attend ou du temps qui s’arrête, à l’instar des bougies éteintes dans les Vanités du XVIIe siècle.
Ici toutefois, nulle prémonition d’une fin de première partie pour l’œuvre de l’artiste. A peine les prémices d’un autre monde ouvert en cet endroit, à travers le motif qui scande et articule l’ensemble des pièces composant le tout. Le monde des Interiors donc, série quelque peu énigmatique où les plans coupés de cuisines et salons désertés se trouvent habités d’une insaisissable menace. Mais sans doute serait-il trop d’y voir une quelconque préfiguration du pixel de l’image numérique que l’artiste ira s’approprier dans les années 2000, avec la série des Jpegs à laquelle s’articule donc celle des Nudes.
Avant ces dernières toutefois, il y eut la série des Sterne, Etoiles en français, série réalisée durant les années 80 qui furent celles des Portraits. Et compte tenu de la connotation, à tort peut-être mais nécessairement poétique du thème lui-même – thème si cher aux Romantiques du XIXe siècle parmi lesquels l’autre Allemand Friedrich – on pourrait voir dans ces étoiles ou ciels étoilés où elles se perdent parfois, une rupture avec l’effet rationnel produit jusque là par la froide distance, si ce n’est coupante rigueur, de la photographie de Ruff.
Pour autant, ces compositions qui renvoient telles quelles à l’univers de l’astronome semblent aussi bien provenir d’images de télescope [3]. Et si nous y voyons un spectacle propre à nous transcender et nous interroger là encore sur notre place dans le monde, c’est que le contexte nous y invite puisqu’il oriente nos dispositions intellectuelles en même temps que notre approche sensorielle face à l’image. Certes douée de tous les pouvoirs d’émerveillement et que ceux-ci soient d’ordre intelligible ou sensible, la photographie scientifique n’en marque pas moins d’abord et avant tout le sens de ce qu’elle montre en tant que surdétermination de sa fonction. Alors que la photographie de l’artiste, c’est-à-dire désignée comme telle, suscite et étire en nous la capacité à se fondre hors rationalité de la raison, pour se livrer à l’appel d’un fantasme originel dans l’univers supérieur qu’elle déploie sous nos yeux, allégorie d’un au-delà qui nous fascine autant qu’il nous inquiète.
Aussi, loin de l’anonymat caractérisant les Portraits et les Interiors dont il renforce l’effet documentaire, nous voici confrontés à une première idée, un premier signe avant-coureur du sujet des mega data qui nous interroge en cet endroit. Car telle est la représentation des plus métaphoriques pour un jeu dialectique des plus en rupture : non pas traitée par le style documentaire en tant que forme artistique, l’œuvre peut ici se définir dans la dimension littérale du document en tant que finalité pratique. Si elle advient comme scène où le regard se fait créateur de ce qu’il regarde, chaque photographie des Sterne s’expose paradoxalement comme preuve, preuve irréfutable qu’est la preuve scientifique.
Et dans cette sorte d’antagonisme, s’inscrit la beauté à laquelle plus encore s’identifier comme étant la nôtre, celle de nous-mêmes et de nos propres vies à travers celle d’un monde qui nous échappe – comme nous échappe précisément celui des mega data dont l’idée pourrait se retrouver dans les trous noirs où s’engouffrent les images dont ils se nourrissent.
A l’opposé de la lumière étale, blanche et plate qui règne dans les photographies de Ruff, le noir intense pour caractéristique essentielle de la série des Sterne apparaît comme l’espèce d’une prescience subliminale, pour ne rien dire d’un pressentiment créateur du travail sur l’image internet, auquel le photographe va se dédier avec l’ensemble des Jpegs.
Entre image et photographie, série des Jpegs
Jpegs en effet. Un intitulé qui annonce la couleur si l’on peut dire. De quoi donner du crédit à la célèbre formule du cinéaste Godard. Au temps présent du règne de l’image où l’asignifiance de l’une disparaît dans le flux sursignifiant qu’elles forment toutes, on peut le redire si jamais on se le demande encore. C’est quoi une image, en ce sens ? Réponse : Juste une image plutôt qu’une image juste.
Pour autant, issue de l’imagination où elle permet — souvenons-nous de Kant [4] — de se représenter les idées et concepts, toutes choses abstraites ayant besoin de prendre forme concrète pour se réaliser en tant que productions de l’esprit, l’image résulte par conséquent, non pas de ce que nous voyons réellement mais de ce que l’œil découpe dans le réel. Aussi peut-elle bien être déterminée comme incidente, et plus encore relative en tant qu’elle est juste une image, c’est-à-dire rien de plus. Il n’en reste pas moins qu’étant pure fiction dans la réalité du monde, elle construit bel et bien celui-ci tout en l’instruisant de l’imaginaire dont il provient.
Et tel est ce que Ruff met en abîme avec cette série initiée donc à l’aube du troisième millénaire. Lui, artiste de l’Ecole de Düsseldorf qui s’est imposé par la précision d’un regard visant à neutraliser les sentiments et bien plus encore les émotions, voici qu’il va faire œuvre de l’image-signe. Soit l’image comme telle, ou à l’égal du sémaphore pour le marin dans la nuit, elle fait signe aux affects qu’elle appelle et conduit. N’importe quelle image banale autrement dit, banale d’être médiatique, mais néanmoins capable de créer le choc d’une émotion particulière en raison de sa dimension spectaculaire. Ainsi des images du 11 septembre 2001 que Ruff va extraire de l’indifférence des écrans, tout comme celles de la Guerre en Irak ensuite engagée par Bush en 2003.
Tant d’images qui se télescopent dans la mémoire collective du monde, le monde qui se confond alors à cet autre qu’il contient, le monde des images qui se reproduisent encore et encore. Tant d’images, mais toujours la même au fond. Car elle-même devenue emblème élu dans l’imaginaire collectif où elle se fixe, c’est ainsi qu’elle devient icône, image « à valeur de culte » [5] rendue telle par le processus de l’émotion ou du sentiment suscité autour de quelques signes seulement – ici des fumées, là des silhouettes, ou encore des bâtiments que ces images du bout du monde nous ont rendus aussi familiers que le décor de notre réalité la plus proche.
Le jeu du signe, c’est-à-dire le signe comme tel, en tant qu’il vient à la place du sens. Ou plutôt en lieu et place du sens, pour autant que le signe, c’est aussi en tant qu’il peut facilement se faire prendre pour le sens. D’où l’intitulé même, ce vocable Jpegs qui fait doublement signe quant à lui, terme technique d’une compression numérique et mot banal de notre vocabulaire usuel. Un acronyme qu’il suffit d’énoncer pour produire en même temps l’idée de ce qui définit notre voir contemporain. Un voir d’où n’en glisse pas moins l’idée du savoir. Ainsi de ce titre qui d’emblée, à lui seul, désigne l’image en lieu et place de la photographie. Lui prononcé, la voici convoquée, image-signe et sans racine, qui décompose son propre savoir en rabattant la notion du photographique sous la perte d’intégrité physique de l’image dont toutes, rassemblées sous ce titre et à l’égal de scènes de guerre ou d’avions qui explosent, font état.
Vues de la banquise en dérive ou d’un iceberg qui s’effondre, paysages touristiques de l’île Maurice ou panoramas du site d’Angkor, toutes se trouvent placées sur le même rang. Traitées par une décompression maximale qui amène chacune du microcadre de l’écran aux dimensions monumentales de la peinture d’Histoire, caractéristique toujours rejouée dans l’œuvre de Ruff, en sorte que celles-ci, à l’instar des autres, se réunissent par le format qui excède largement les deux mètres écrasant le spectateur. D’où l’hyper pixellisation qui s’exacerbe et l’image qui en résulte. A la fois dégradée et sublimée, une image où le voir se déconstruit face au sujet qui s’évanouit.
A la fois dégradée et sublimée d’être capturée comme image collective tout en étant questionnée comme image singulière, la série des Jpegs l’annonce pour ce qu’elle est : en deça de l’œuvre mais en tant qu’elle fait œuvre. Et c’est ainsi qu’elle se présente effectivement comme telle, image orpheline par définition et tautologique par essence. Soit l’image : objet de l’imaginaire et tout à la fois sujet du réel par quoi le chaos du monde peut aussi bien s’atomiser dans une poétique de la solitude – et comme cette série l’y conduit avec des œuvres que l’on pourrait qualifier de « crypto-photographiques ». C’est-à-dire contenant des traces résiduelles de la photographie, des restes infimes, à l’état de signes microscopiques pour ne pas dire quasi cryptés.
Vraies traces et faux souvenirs, l’image Jpeg si l’on peut ainsi qualifier chaque œuvre de la série [6], présente tous les signes du monde existant qu’elle reconstruit sous l’espèce d’une mémoire brouillée. Du monde connu qui se dessine avec le spectre d’une architecture dévastée comme avec la luxuriance d’une nature abandonnée, le signe en est aussi immédiat que son apparition est différée. Dans le flou de l’image où les formes viennent se constituer, c’est la rencontre avec le réel qui vient se suspendre.
De fait, si elle renvoie au monde connu, l’image en perte de définition qu’est l’image Jpeg opère néanmoins à l’encontre de l’image par définition. Déroutant le regard en tant que saisie instantanée de la représentation du monde, elle le recentre vers le temps du regard comme interrogation du monde représenté. Ce que l’on pourrait donc définir comme suspension du temps. Mais un temps suspendu sur le monde tel un prisme aplati, trous et raccords d’une mosaïque de mondes qui s’articulent en vision, plutôt qu’en vue, sur le paysage ou l’évènement.
Ainsi, avec le point de fuite qui disparaît entre les Tours jumelles effondrées au matin du 11 septembre, Ruff nous confronte à un écran opaque sous la transparence de la couleur, qu’elle soit brun d’écaille ou bleu azur. Comme jeu de métaphores, ce serait l’écran de notre savoir qui vacille et de notre regard qui trahit – savoir sur le monde mis en échec au fil de ces vues qui le font éclater, suggérant autant de mondes possibles qu’il y a de pixels, des pixels aussi alignés et réguliers qu’ils semblent vitrifiés et néanmoins exorbités parfois. Et regard sur l’histoire qui s’indifférencie comme mémoire face au spectacle du monde qui se recrée ainsi, de cette fracturation comme scène de sa création. Au prix de l’unité perdue dont il provient par l’image qui le représentait, voici l’autre monde qui apparaît de son propre éclatement, mais plutôt comme une idée, une vision ou fiction, une sorte de fiction du voir.
Car il y a ce trou du regard qui vacille entre croire et savoir. Et dans ce vacillement, l’allégorie qui surplombe le jeu des métaphores en s’exprimant par l’image fabuleuse qui se présente à nos yeux. Reconnue depuis les tréfonds de notre monde visible, ces fantasmatiques abysses où l’imagination de la pulsion rejoint le monde parallèle des data devenus mega, la voici, si simple et pourtant inconcevable, fabuleuse puisqu’à jouer comme fiction, elle opère comme sidération. Telle l’image de la fumée qui s’élève d’une scène apocalyptique, la fiction que devient cette image incroyable la produit plus encore comme fable, impossible réalité quant à elle. Mais la fable bel et bien, d’un coup réalisée à travers cette image de s’être simplement laissée imaginer face à elle, la fable donc, qui s’incarne à travers son pouvoir de sidération ainsi démultiplié entre croire et savoir.
Et d’autant plus ici, face à l’image où le signe se cristallise alors qu’il se désintègre pourtant sous l’effet de la décompression numérique. Des paysages et non plus des visages, des images en lieu et place de la photographie, voilà qu’à l’instar des Portraits, les Jpegs se reconvertissent de même à travers un format pictural qui monumentalise la dérisoire capture d’écran ou l’insignifiant dépliant touristique dont elles proviennent − images-tableaux, dont chaque carré de leur pixellisation devenue géante constitue en tant que tel une image dans le tableau. Sous la figure du morcellement pour celui du regard dépouillé de son savoir par ces images faites œuvres, vient alors l’instant fragile du monde, du monde comme une image en ruines que l’œuvre ainsi advenue convoque à travers son double effet de vitrification et de vitre fêlée.
Image-tableau en effet, et selon l’oxymore que produit l’assemblage de ces deux termes, eux-mêmes issus d’une dialectique entre le pictural et le photographique, l’un comme tableau faisant retour dans la conversion de l’autre comme image. D’où cette définition que nous pouvons donner à toute œuvre Jpeg. L’image-tableau contenant d’abord l’image seule, celle-ci se redéfinit de même, étant à la fois l’image et l’écran devant elle qui la protège comme un secret et la reflète ou la transforme comme une image — image issue quant à elle du monde de la fable et non de celui du tableau. Mais de la fêlure qu’elle présente invariablement à l’explosion ou l’éruption qu’elle représente souvent, l’image Jpeg vient plus exactement par l’idée d’une vitre éclatée en mille morceaux à l’intérieur même de son cadre qui les contiendrait tous, unis dans un ensemble organisé mais condamné à le rester sous peine d’effondrement. Et dans la dissolution du voir qu’elle réalise par métaphore, le monde qui en émerge, le monde qui simplement apparaît est tout à la fois insoutenable et sublime. Ou terrible et inintelligible.
Sous la double référence à l’abstraction géométrique et au pictorialisme photographique dont joue l’image hyper pixellisée des Jpegs, s’inscrit l’enjeu philosophique qui la fonde. Saisissable à condition d’être saisi comme incompréhensible, le monde vient ici par un voile qui fait un écran pour le voir. À la fois indifférente et ultime, l’image-tableau qu’est l’œuvre intitulée Jpeg organise une tension des contraires. Engloutissant le spectateur dans son gigantisme qui la transforme en océan immobile, mais le tenant à distance par ce flou qui la laisse dans un lointain inaccessible, elle comble le regard, corps et âme du spectateur, d’un enchantement de fable tout en le nourrissant d’un manque par lequel elle se l’attache plus encore, puisqu’il est le manque d’un désir jamais assouvi. D’un fond qui éclaterait en remontant à la surface, de la figuration qui ne saurait contenir toute la représentation, et de la double initiale qui l’encode pour un titre qui la nomme − ainsi de aa pour American Architecture ou wi pour War in Irak — n’est-ce pas désigner là l’énigme de l’image ? L’image qui sous nos yeux n’est rien de plus que juste une image alors qu’elle est en même temps, alors qu’elle est par essence, toute l’histoire du regard. Ou plutôt l’histoire même du regard par laquelle l’humanité se définit et, pour cette raison, continue indéfiniment de se construire, se détruire et toujours se recréer.
Ainsi, mais si l’on peut dire, aura-t-il suffi de quelques images-signes extirpées du chaos « megadatesque » et retravaillées en images-tableaux, pour que l’imaginaire du monde contemporain se trouve mis à nu dans sa double structure. Au règne de l’image comme production de pain quotidien pour ne pas dire d’opium ou plutôt méthadone journalière dont la surface des écrans offre le paradigme, répond l’image comme production de l’imaginaire dont elle permet la reconnaissance, magique création que celle de l’imagination dont elle active alors la possibilité de penser hors le seul concept.
D’où cette image virtuelle devenue actuelle, icône à valeur de culte et non d’exposition — pour reprendre ici encore Benjamin. Image inconsistante devenue sidérante, et d’autant plus fabuleuse qu’elle surgit du lieu sans lieu qu’est le réseau des réseaux. Ce lieu atopique qu’est internet, lieu sans lieu et néanmoins scène d’apparition pour l’imaginaire incarné comme substance – lui-même, l’imaginaire, appelé à se nourrir des flux qui alimentent l’impensable laboratoire que sont, au fond, les mega data.
De la pornographie comme lieu du sublime, série des Nudes
Contrairement à l’ordonnancement de la problématique qu’elle fait ici aboutir, la série des Nudes précède dans le temps celle des Jpegs. Réalisées au tout début des années 2000, cet ensemble joue sur la dématérialisation des corps à travers l’image elle-même dématérialisée qui les représente. Chairs et sexes en gros plans, des corps extraits de l’imagerie du film x, mais dont la saisie par capture d’écran offre là encore une définition qui va se perdre, évaporée parfois dans le traitement de son hyper pixellisation. Dès lors, ainsi défaite à moins qu’elle n’en sorte transcendée, l’image pornographique reprendra corps si l’on peut dire, image dématérialisée comme scène du voir en tant qu’il dévore ce qu’il voit, mais que sa transformation en image-tableau va re-matérialiser en scène du regard en tant qu’il pense. D’où le jeu d’un procédé reconduit avec les paysages et architectures tels les aa et wi réalisés ensuite, n’était l’intitulé qui s’inscrit là aux antipodes de l’indifférente et pure technicité de l’acronyme Jpegs.
Nudes en effet. Que signale d’emblée ce titre sinon la grandeur du sujet, grandeur de surcroît exprimée au-delà de la monumentalité du format puisqu’elle est redoublée par la référence au genre historique. Le nu en peinture donc, et tel que de Raphaël à Picasso en passant par Velasquez et Courbet, ce genre aura relié styles et époques – permettant d’ailleurs de mieux comprendre son articulation au règne actuel de la pornographie, articulation logique dans la mesure où celle-ci lui assure l’espèce d’une continuité [7]. Certes impensable du point de vue de l’art en tant qu’il est fondé sur le regard, quelle autre pulsion hormis celle du voir dévorateur, la pornographie ne vient-elle satisfaire en masse que le nu, et qu’il fut de Goya ou Manet, n’activait déjà en son temps et sous la forme de l’inframince ? Etant entendu que cette fonction de pur objet du désir n’exclut en rien ce qu’il est comme sujet du voir, mais d’un voir qui est du savoir quant à lui, et qu’il délivre alors en tant que genre artistique comme on parle du paysage ou de la nature morte.
Morte nature en l’occurrence, le corps de la pornographie pouvant se voir tout aussi mort, vidé de la vie que donne l’esprit, tant il apparaît le plus souvent mécanique dans ses soubresauts et contraint dans ses postures stéréotypées. Dans le plus total dénuement en ce sens, c’est là ce que montrent les images-signes à la source de l’œuvre dont elles constituent en même temps le matériau. Images venues d’internet et tout aussi proliférantes qu’anonymes, scènes de l’obscène répétées sans fin pour être rejouées encore et encore – et dans une froideur dénuée d’affect qui n’est pas sans rappeler alors celle des Interiors, où culmine une volonté d’objectivité également propre aux Portraits. Sauf qu’au-delà du simple effet de coïncidence et dans ce rapprochement inattendu, c’est le jeu d’inversion entre les termes qui rend leur rapport dialectique. La froideur caractérisant les Portraits et Interiors se constitue à partir de son opposé que produit le mouvement de la vie, la chaleur de son énergie qui est celle, intrinsèque, des personnes anonymes ayant posé pour l’artiste. Et celle, par conséquent, de leurs cuisines et salons où ils vivent, mais que Ruff a donc saisis dans une immobilité déserte où rôde jusqu’au froid de la mort. Tandis qu’à l’exact inverse, la série des Nudes venue de l’absence de vie, faux-semblant de son mouvement où se débattent des corps sans envie hormis le besoin, opère quant à elle la sorte d’une épiphanie en tant qu’œuvre d’art. Phénomène mystique aux yeux de certains, métaphore pleinement philosophique en réalité, manifestation de la vie s’il en est que cette élévation de lumière comme diffusée des corps maintenant déréalisés, et leurs sexes.
Des corps non plus destinés au sacrifice de l’émotion d’être voués à la seule pulsion, et leurs sexes, ouverts et offerts, pénétrés et pénétrants, mais ainsi désignés comme l’endroit même du point nodal de l’existence. L’endroit ultime de l’espace du sublime, sa grandeur faite d’effroi et de mystère où se retrouvent en effet les œuvres de la série intitulée Nudes. Et ce faisant, n’est-ce pas à l’imaginaire du lieu dont elles proviennent que nous-mêmes sommes renvoyés ? Ces images triviales, sans vie d’être sans durée à l’instar de la névrose où la durée s’efface au profit de la répétition, n’est-ce pas qu’ayant été extraites du néant par l’artiste qui les a capturées, arrêtées dans le flux qui les emporte toutes, n’est-ce pas qu’elles reproduisent en réalité le processus de cet imaginaire auquel elles réfèrent ? Celui de la scène quasi mythologique que sont aujourd’hui les mega data, scène de l’impensé que sont leurs milliards de données qui alignent les secrets Défense sur les faire-part de naissance, les tweets de djihadistes sur les forums de tartes au citron — à la fois fantastiques et effrayants, bien nommés mega data en tant qu’ils occupent les tréfonds virtuels de notre monde actuel, reprenant en quelque sorte le flambeau du rôle autrefois tenu par les dieux de l’enfer. Ou plus près de nous, par Faust et sa damnation. Le prix à payer pour la vie contre la mort, c’est-à-dire pour la vie et au prix même de celle-ci.
Mais ces images pornographiques, images-signes de corps soumis à la loi tyrannique du fantasme bien plus qu’à la libre subversion de l’imagination, ce qu’elles forment dans leur crudité brute, est la matrice des corps nus face à nous. Invisiblement nus, ces corps nus et tout à la fois invisibles pour nos regards d’où le voir s’est détaché, spectres insaisissables qu’ils sont devenus, transformés en ombres blanches ou colorés par le jeu de lignes flottantes qui tracent désormais leurs contours.
Les Nus de cette série le montrent alors. C’est avant les Jpegs que s’est opérée la radicale dissolution du voir par laquelle l’œuvre de Ruff accomplit sa propre mise en abîme. L’altération de l’image qu’il met ici en œuvre l’amène non seulement à déconstruire la photographie pour retourner aux fondements de l’image. Mais dans ce processus, c’est le sujet même du nu qu’il désarticule, lui faisant faire le chemin inverse que ce genre connaît depuis l’art et grâce à l’art. Déconstruisant l’image pornographique par l’hyper pixellisation qui désincarne les corps et avec eux, les sexes, invariablement ouverts et offerts, pénétrés et pénétrants, Ruff en reconstruit, comme sur les ruines d’une architecture Jpeg pourrait-on dire, la scène d’apparition pour des corps – mais des corps qui, ainsi désincarnés, nous échappent alors même qu’ils apparaissent. Dépouillés de leur consistance physique, ramenés à l’état de substance métaphysique, des corps qui semblent s’évanouir sans pour autant disparaître – et comme il en va du paradoxe de la présence en tant que halo invisible et néanmoins rendu perceptible. Ce que Benjamin désignait du nom d’aura, et qui manifeste la présence à l’instar de ce qui demeure après la mort, perte et défaite, l’abandon et le reste. « Qu’est-ce à vrai dire que l’aura ? Une singulière trame d’espace et de temps : l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il. » écrivait-il [8]
Sous nos regards, nous spectateurs face aux Nudes, les corps semblent si proches que l’on pourrait s’en saisir. Mais nous le voyons aussi, et nous l’éprouvons plus encore, ce sentiment de distance qui nous sépare d’eux, eux si proches mais rendus inaccessibles dans leur effet d’éloignement, le jeu de leur dissolution dans l’image à l’égal d’une eau devenue vapeur dans l’atmosphère. Ou de ces corps devenus images d’eux-mêmes dans leur montée vers l’espace de dieu comme on appelle les corps glorieux, ces corps en majesté qui s’élèvent vers le ciel dans la peinture religieuse, saintes et saints auréolés d’une lumière proprement divine afin de témoigner qu’à l’image de la Vierge en bienheureuse lévitation, ils ne meurent pas, pas plus qu’elle et contrairement à nous. Nous qui sommes attendus par la décomposition de la chair avant les cendres ou la poussière. Et eux qui passeront de l’état organique à celui de sublimation, éternelle et spirituelle sublimation de n’être dans ce cas pas plus alchimique que chimique.
Quant à eux, tout aussi sublimés ou répandus à l’état gazeux dans l’espace de l’œuvre, les corps pornographiques appelés Nudes figurent autant des esprits que des corps. Soit des esprits de corps qui auraient retrouvé l’être comme substance. Ou des corps en esprit traduisant la perte et le désir auquel nous destine le jeu de cette présence lointaine − et avec elle, l’espèce de mirage d’où surgit l’érotisme. « De l’érotisme, écrivait Bataille, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la vie jusque dans la mort » [9]. De l’érotisme donc, qui est invention du désir au-delà de la pornographie qui est répétition de la satisfaction, voici la métamorphose que Ruff opère avec la série des Nudes. Une métamorphose qui n’est rien moins que celle de la vie contre la mort, et qui se distingue en ce sens par la présence lointaine mais certaine qualifiant l’idée d’aura, plutôt que sa forme.
Non pas d’or cette aura, dont l’étymologie vient du latin ayant donné le mot d’auréole, or précieux tracé en cercle au-dessus de la tête des saintes et saints et valant pour la richesse symbolique de leur esprit voire de leur être même. Non pas d’or, mais de lumière ici, et tel qu’à l’instar des corps glorieux dans l’imagerie religieuse, le corps de l’imagerie pornographique devenu œuvre d’art en devient la manifestation incarnée. Dès lors, c’est à l’encontre de Benjamin que nous nous situons cette fois. Lui concluant que dans l’image à valeur d’exposition, image de consommation dirions-nous aujourd’hui, l’aura disparue trouve néanmoins « son dernier refuge » à travers le visage, lieu de « son ultime retranchement » d’où elle « nous fait signe, une dernière fois » [10]. Mais comme l’or se change en lumière lorsqu’il s’agit d’aura, nous voyons aussi combien les visages effacés des Nudes le sont par cette lumière qui semble venir des corps, le corps tout entier faisant signe. Signe de l’aura qui les habite, maintenant que leur métamorphose de la vie contre la mort les a fait passer du côté de l’érotisme et sa clarté.
Du clair-obscur comme procédé pictural, c’est le sexe, et le rapport à son imaginaire comme à sa réalité, que l’on peut aussi définir en reprenant la dimension symbolique de ce même procédé. A l’inverse de la pornographie qui s’inscrit dans une visibilité sans lumière, pleine visibilité qui n’est cependant ni clarté ni illumination, l’érotisme joue, lui, à ne pas rendre visible ce qu’il dévoile tout en s’en faisant le messager illuminé, à la fois porteur de mystère et porteur de lumière — au sens épiphanique qui revient ici, l’aura étant faite d’une lumière aussi métaphorique que l’or qu’elle désigne. Et dans ce jeu de clair-obscur où le clair est le terme contingent de l’obscur et l’obscur le contingent du clair, la pornographie qui affleure toujours dans l’érotisme s’y trouve ainsi attachée, liée à l’érotisme par le rapport unissant de même les deux faces d’une pièce de monnaie : les deux existent sous la forme d’une seule entité mais sans jamais se rencontrer ni donc se confondre.
Et comme on le dit de la menace qui se présente parfois avec son ombre propre, l’ombre de la pornographie en tant que versant obscur qui ombrage tout désir érotique qu’elle aiguillonne en même temps, cette ombre sombre que serait la pornographie ne forme-t-elle l’arrière monde de la lumière épiphanique, auratique lumière de l’érotisme ? Chute et élévation, inversion et métamorphose, la réalité totale de la vie que Ruff offre à nos regards tient à ce fondement existentiel, désigné d’ailleurs par l’expression clair-obscur.
De fait, la série des Nudes ne se borne guère à ce qu’elle montre, elle nous le donne à penser : la conscience de nous-mêmes en tant que corps peut se définir plus exactement comme la raison même de nous-mêmes en tant que corps. Car il y a quelque chose de nietzschéen dans l’idée du monde qui nous entoure, ce monde que nous habitons sans le percevoir le plus souvent ou le ressentir mais où se cristallise d’un coup, en une simple ou seule image, l’esprit du monde réel que nous avons créé. A travers la pornographie en tant qu’elle constitue le souterrain dangereux mais contingent au domaine de l’érotisme lumineux mais complexe, n’est-ce pas l’univers des mega data qui revient alors, comme en filigrane ? La tentation de leur mortel vertige, l’obscurité des temps inconnus, mais la lumière aussi bien. Le possible chaos mais la promesse dans laquelle ils nous élèvent, l’esprit de l’humanité qu’ils pourraient rendre sensible par l’expérience de l’humain qu’ils rendraient intelligible.
De l’imagination en forme de conclusion
Une fable alors, voilà comment s’achève ici l’histoire. Ou plutôt la fable, celle que Ruff déploie à partir de la fiction qu’est la pornographie et ses images. Car si l’une et l’autre, fable et fiction sont des modes de récit, visuel ou textuel mais producteur de sens dans tous les cas, leur distinction de nature ne saurait les confondre. A la différence de la fiction qui s’appuie sur l’anamorphose, la fable repose entièrement sur la métamorphose – la métamorphose étant la transformation de la forme tandis que l’anamorphose en est la déformation.
Et dans la fiction apparaît au moins la trame, si ce n’est le soutènement de la réalité qui se montre à travers la reproduction fidèle de cette même réalité, fidèle comme modèle, bien que modifiée suivant l’angle de vue adopté pour la recevoir ou la transmettre. Ce qui est la définition même de l’anamorphose, plus connue comme technique graphique et picturale. Tandis que la fable, elle, se définit au contraire par la rupture, cherchant pour ce faire à produire un univers propre au moyen de la métamorphose. Un univers hors champ si l’on peut dire, qui se crée par le passage d’une forme à une autre pour définition littérale de la transformation. Laquelle transformation permet d’échapper à la réalité comme seule forme ou forme de référence, afin de la dépasser autant que faire se peut. Et c’est ainsi qu’elle constitue le moment du processus d’où advient le surgissement d’une autre forme qui détermine la métamorphose, laquelle étant le parachèvement de l’opération.
La fiction est donc une transposition de la réalité dans un réel qui la reproduit, tandis que la fable est une conversion de la réalité en un réel qui la transcende. S’il s’agit dans les deux cas d’imaginer quelque chose tel un autre monde qui précisément réinvente la réalité, reste ce qu’il y a de plus, et non seulement de différent, dans la fable. A savoir, cette dimension de métamorphose par quoi s’opère le changement de la réalité en un réel qu’aucune réalité ne pourra jamais produire. Aussi, pour y revenir maintenant, l’image pornographique relève de la fiction là où l’érotisme relève lui de la fable. Confinement, voire enfermement dans une reproduction de la réalité déformée pour la pornographie, recherche incessante de son dépassement voire de sa transcendance pour l’érotisme, les nus de Ruff le mettent à jour. Aussi anonyme qu’asignifiante, l’image de fiction qu’était l’image pornographique au stade de la capture d’écran est elle-même devenue icône au sens benjaminnien de l’image à valeur de culte, riche de ce qu’elle rend sensible sans pour autant le dévoiler. Et c’est en paraphrasant de nouveau Baudelaire que l’on pourrait encore le dire. Triviale image que cette image pornographique vers laquelle se précipite la société toute entière pour se contempler dans la jouissance de son propre désir [11], voici que, sous le nom de Nude, sa banalité d’image triviale s’est métamorphosée en une fabuleuse image, riche du sexe et de sa jouissance comme monde du corps et de l’esprit qu’elle déploie en tant qu’œuvre d’art, élevant face à elle nos regards à la hauteur des reflets astronomiques où elle se situe désormais.
Sans doute, fabuleuse image et image de fable renvoient-elle à des significations différentes ou au moins divergentes. Mais nous l’entendons bien ainsi en usant de son spectre sémantique, nous qui parlons aussi de la fable comme terme générique pour les récits sans origine au regard du seul imaginaire dont ils sont issus. De sorte que la fable est plus exactement un récit allégorique par lequel on substitue à la réalité vécue l’aventure imaginaire, présentée de façon crédible. Elle réalise donc une forme de conversion dans la mesure où, contrairement à la fiction qui part du réel, la fable part de cet imaginaire pour le faire prendre comme réel. D’où le rapport ici avec l’image sans passé ni pensée qu’est l’image internet. Si cette image sans intérêt comme telle peut se faire paradoxalement des plus fabuleuses, c’est qu’elle provient directement de l’imaginaire, en l’occurrence collectif, celui-là même où se forgent les mythes et légendes, contes et fables. Et « l’œuvre nue » de Ruff ne montre rien d’autre en ce sens. Image sans auteur à l’égal de la fable sans origine, l’image immatérielle qu’il a capturée dans le flux de son engloutissement est ainsi saisie dans le mouvement de sa disparition. Un mouvement hors du vide d’où il la fera réapparaître sous la forme d’une image inversement matérielle, et plus encore hyper matérielle de par le format hors échelle où elle se transcende comme œuvre d’art tout en exacerbant, encore une fois, le jeu du pixel qui donne à cette image initialement sans matière, la présence d’un corps vivant, hors la chair et le sang.
Proche par ce format qui immerge le spectateur et lointaine par ce flou qui le maintient dans la distance, l’image faite œuvre, à la fois ultime et indifférente, est d’autant plus fabuleuse qu’elle crée un effet de frustration et d’enchantement tout à la fois. Si nous voyons en elle combien le monde réel s’est déréalisé, fragilisé, nous éprouvons en même temps comment la densité des corps est retrouvée, célébrée. A la frustration d’une évanescence qui rend l’appropriation de ces corps impossible, et impossible aussi le seul fantasme de leur possession, répond l’enchantement de l’autre monde ainsi produit. Issu du réel qui semble avoir perdu de son poids malgré les jeux de gros plans d’où les corps apparaissent se réincarner, le monde de l’imaginaire qui a pris place ouvre la voie pour une autre mémoire, expérience ou histoire de notre propre pouvoir de récit intérieur.
Personne ne sait ce que peut un corps disait en substance Spinoza [12]. Ici nous le voyons, les corps se sont métamorphosé en esprits de corps sans perdre ce qu’ils sont en tant que corps sans esprit, chair et jouissance jamais comblée. Leur intégrité semble pourtant ruinée par le jeu de la définition perdue qui finit par les dissoudre. Mais la densité du corps et de l’esprit que l’on dirait réconciliés se voit reconstituée à l’intérieur du cadre devenu l’espace métaphorique de la fable : l’image faite œuvre délivre la contradiction du sens, à la fois présence lisible du sujet métamorphosé depuis l’image pornographique qu’il continue de faire apparaître comme à la surface d’une eau qui le retiendrait. Et en même temps, désintégration de cette visibilité dans la perte de l’image comme scène figurative d’où le sujet se rend parfaitement énigmatique, et plus encore, aussi fulgurant qu’une apparition de lumière dans la nuit.
Mais de ces images à l’origine, il y a aussi l’approche par son envers sur lequel revenir afin de conclure. Issues des mega data de sorte qu’elles nous situent « face au déferlement des images » pour reprendre l’intitulé du colloque, on pourrait dire que leur durée de vie paraît comparable à celles de ces insectes qui meurent quelques heures seulement après avoir commencé à vivre, et que l’on appelle pour cette raison des éphémères. Dans le ventre de la bête, éphémères sont les images-insectes nourrissant les mega data. Images-lucioles pour nos yeux assoiffés, émerveillés quant à eux par la lumière qu’elles émettent, mais elles qui brillent dans les ténèbres pour disparaître aux premières lueurs du jour.
De fait, l’imagination sollicitée rend d’autant prégnante la question posée : au-delà des évidences, que vient nous dire l’art voué par essence à l’immortalité, lorsqu’il se réalise à partir de la quintessence même de la vie, son caractère éphémère qui définit aussi bien ces images indifférentes que notre humaine condition ? Non pas Dada créant avec des tickets de métro bientôt retournés aux oubliettes, non pas le Land Art réalisant des œuvres que la pluie ou les années feront disparaître, l’enjeu de l’art interrogeant les mega data s’incarne a contrario, hors la matière qui s’use ou se dégrade. Dès lors, ce qui s’exprime ainsi n’est-il pas de cet ordre, ordre de l’apparition que la disparition convoque de fait, selon le principe de contingence qui les unit ? Phénomène magique pour certains, mystique pour d’autres, technologique pour tous sans aucun doute, l’apparition étant la clé de voûte qui structure le principe de la fable, dont la métamorphose constitue en quelque sorte le nombre d’or. La fable comme mode de récit à la simplicité enfantine face aux intrigues complexes, ou supposées telles, de la fiction. Mais la fable cependant, récit du pouvoir de l’homme à s’identifier comme à se transformer, vaincre ses fragilités et recréer l’humanité.
C’est donc avec la fable comme modélisation de notre rapport au monde que nous aboutissons ici. Car c’est l’espèce d’une fable que les mega data écrivent en un récit invisible, et plus encore insaisissable, mais dont l’œuvre de Thomas Ruff apparaît néanmoins traduire l’expérience. Arrimée au travail du médium argentique, sa photographie aura connu le détour de l’image vouée à la déchéance. Image éphémère mais surtout, en ce sens orpheline d’être sans savoir ni racine, et qu’il va s’approprier pour l’élever à la hauteur de l’histoire de l’art, la dérobant à sa destinée d’objet de consommation, telle celle de la pornographie dont elle est représentative tant au figuré qu’au littéral.
Dès lors, n’est-ce pas à l’interrogation du regard comme possible paravent à l’obscénité du voir que tend tout son œuvre au-delà de la seule série des Nudes ? De la nature humaine soumise à la pulsion scopique, laquelle peut transformer le regard en créateur de ce qu’il regarde autant qu’elle condamne le voir à se faire dévorateur de ce qu’il voit, c’est là ce que met à jour l’ensemble de son art. A la fois détachée et vibrante, son œuvre nous invite à penser la sidération proprement mythologique qu’opère sur nous, non pas l’hypnotique Méduse prenant au filet de son regard les hommes passant devant elle. Mais bien « le déferlement des images » dont la fluidité en tant que flux n’est d’ailleurs pas sans rappeler les serpents qui ondulent, enroulés sur la tête de la déesse. Loin de l’imagerie du mythe car en continu de notre banale réalité, « le déferlement des images » nous saisit comme face à elle, médusés que nous sommes dans une égale fascination où s’arrêtent le temps et la conscience même de nos existences.
Notes
[1] Cette série d’œuvres a fait l’objet d’un livre au titre éponyme que Thomas Ruff a réalisé en collaboration avec l’écrivain Michel Houellebecq, ce dernier ayant donc produit les textes qui accompagnent les images. Nudes, Thomas Ruff et Michel Houellebecq, Munich, Schirmer/Mosel, 2003.
[2] Le peintre abstrait Frank Stella est considéré comme précurseur du Minimalisme des années 60 aux Etats-Unis, mouvement dont il sera membre tout en revendiquant une inspiration de l’op’art en Europe (optical art auquel se rattache l’art cinétique). Mais il ne pouvait deviner que cette phrase, énoncée en conclusion d’une longue interview sur son œuvre, connaîtrait une célébrité telle qu’elle s’est aujourd’hui transformée en quasi slogan artistique, sans plus auteur que de sens à l’égal d’une formule publicitaire. Pourtant, c’est au principe de tautologie que se réfère alors Stella avec ce fameux « What you see is what you see », lequel principe philosophique désigne le concept de répétition nécessairement généré par l’impuissance logique, elle-même produite par les nécessaires limites du raisonnement. Ainsi le principe de tautologie peut-il se redéfinir comme principe de littéralité, les limites dont parle l’artiste étant celles du voir, et partant, celles de l’œuvre vue. D’où le strict premier degré de sa phrase dont la construction circulaire exprime l’impuissance du voir en tant qu’il donne ses limites à l’œuvre, générant l’impossible dépassement qui la transcenderait. Enfin, ajoutons que le principe de tautologie sera plus encore le fondement de l’Art conceptuel, son artiste phare Joseph Kosuth le reprenant de même comme principe de littéralité à travers tout un ensemble d’axiomes parmi lesquels : « L’art et sa définition sont une seule et même chose. »
[3] Signalons que Thomas Ruff est un passionné d’astronomie, et cela depuis l’enfance. D’où l’effet de concordance entre l’objectivité scientifique pour condition même des clichés qu’elle produit, tels ceux de la NASA qui le fascinaient, et sa propre volonté d’objectivité en photographie qui n’aurait pas attendu la rencontre avec les Becher pour se révéler. Sachant que sur cette question, mais du point de vue collectif d’un style ayant fait Ecole auprès de nombreux artistes, la raison politique surgit du fait même que cette volonté d’objectivité ait émergé en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi contextualisée, l’intransigeante vision « becherienne » de l’art se conçoit comme l’exigence d’une recherche de vérité non corrompue, en opposition radicale avec le nazisme et sa culture du mensonge dont les lourds secrets seront d’ailleurs le fardeau de la « génération d’avant », celle des pères de ces artistes émergeant dans les années 70-80.
[4] Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, GF Flammarion, 1995, pp. 181 et suiv. Kant ouvre la section de l’Analytique de la faculté de juger esthétique par cette phrase : « Pour distinguer si quelque chose est beau ou non, nous ne rapportons pas la représentation à l’objet par l’intermédiaire de l’entendement en vue d’une connaissance, mais nous la rapportons par l’intermédiaire de l’imagination […] ». Et déterminant les limites de cette dernière qui donne forme aux concepts par rapport à l’entendement qui, seul, permet de les concevoir, Kant analyse plus loin « le pouvoir de l’imagination de rassembler l’appréhension progressive dans un tout de l’intuition » (p. 237).
[5] Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (1935), in Œuvres III, Paris, Gallimard/folio, 2000, pp. 67-113. Dans ce texte fondateur, le penseur et théoricien allemand détermine deux dimensions essentielles qui fondent l’œuvre d’art en s’opposant l’une l’autre. La valeur cultuelle qui renvoie à la dimension initiale, c’est-à-dire magique ou sacrée de l’art, exige que l’œuvre soit gardée au secret, dérobée à la vue de tous. Ainsi des sculptures de cathédrales gothiques faites pour élever les regards tout en leur restant inaccessibles. Alors qu’advenue avec l’ère moderne, la valeur d’exposition caractérise, elle, la dimension de l’œuvre ayant pour finalité d’être inversement montrée au plus grand nombre. D’où le médium qui permettra de la généraliser : « Dans la photographie, écrit Benjamin en soulignant, la valeur d’exposition commence à repousser la valeur cultuelle sur toute la ligne. » (p. 81).
[6] Sur le titrage dans l’œuvre de Ruff, précisons que chaque série ayant un titre générique porté au pluriel Portraits, Interiors, Sterne, Jpegs, Nudes…), chaque œuvre de la série est ensuite intitulée de ce même titre, mais porté au singulier et suivi d’un système d’identification propre. Ainsi des initiales de la scène représentée Jpeg aa, ou encore de l’heure (Stern 4 h 58 mn) voire d’un code chiffré (Interior C 11).
[7] Précisons toutefois que l’omniprésence de la pornographie ne saurait évidemment fournir toute l’explication à cette quasi disparition, le nu étant aujourd’hui réduit à l’apprentissage du dessin après avoir été célébré comme genre majeur depuis la Renaissance jusqu’aux avant-gardes non politiques du XXe siècle. Nécessairement plurielles, les raisons de ce désintérêt par les artistes s’accordent ainsi avec l’évolution du regard masculin comme puissance dominatrice sur le corps féminin. Mais si le Mouvement de Libération des Femmes des années 70 a permis l’autre révolution que fut le passage du statut de muse ou d’inspiratrice à celui d’artiste soit de créatrice, il n’en reste pas moins que le MLF, ironie de l’Histoire, coïncide exactement avec l’arrivée en masse de la pornographie. Laquelle industrie, des sex-shops aux magazines porno et du cinéma x aux peep-shows, étant alors exclusivement destinée aux hommes.
[8] Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art… », op. cit., p. 75.
[9] Georges Bataille cité par Dominique Baqué en exergue de son ouvrage, Mauvais Genre(s), Paris, Editions du Regard, 2002.
[10] Walter Benjamin, supra., p. 81.
[11] « A partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le miroir. » écrivait en 1859 le poète Baudelaire, ici critique d’art exprimant sa détestation de la nouvelle image mécanique qu’était alors la photographie, et qu’il opposait au tableau pour ultime forme artistique selon lui. Mais s’il apparaît donc bien peu intuitif au regard de la révolution du regard que vient inaugurer cette invention, reste l’aspect visionnaire de sa déclaration. Au regard de l’image comme fonction de miroir narcissique, c’est inversement à une pleine réalisation de l’idée que nous assistons aujourd’hui. Car autant l’obsessionnelle image du « petit soi » que l’écran du smartphone active en continu ne saurait se réduire à la seule vision baudelairienne, et loin s’en faut compte tenu des enjeux de notre contemporanéité, autant le même bien nommé selfie incarne la toute-puissance d’un moi dévorateur et exclusif, qui fait prévaloir dans tous les cas la soif d’identité sur la conscience d’altérité. « Une folie, un fanatisme extraordinaire s’empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil » poursuivait Baudelaire à propos de l’emprise collective exercée au XIXe siècle par la « triviale image sur le miroir ». Charles Baudelaire Critique d’art suivi de Critique musicale, Edition étable par Claude Pichois, Paris, Gallimard Folio/Essais, 2005, P, 277.
[12] « Personne, en effet, n’a jusqu’ici déterminé ce que peut un corps, c’est-à-dire que l’expérience n’a jusqu’ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la Nature […] le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d’être déterminé par l’esprit » écrit le philosophe du XVIIe siècle dans la 3e partie de son ouvrage majeur. Spinoza, L’Ethique, Paris, Gallimard Folio/Essai, 1997, p. 184.
Isabelle Hersant est enseignante et critique d’art. Ancienne chargée de cours à la Sorbonne et à l’ENS, c’est à l’université de Paris 8 qu’elle enseigne aujourd’hui la philosophie de l’art ainsi que les relations entre l’art et la psychanalyse, avec également un cours portant sur la question du corps dans l’art contemporain. Critique d’art (catalogues d’exposition, revue ETC à Montréal…), elle a participé à de nombreux colloques en France et à l’étranger.