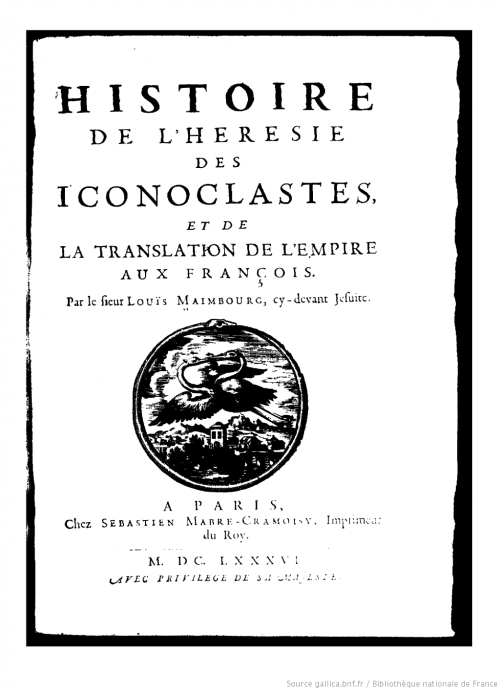Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Des millions d’e(r)go iconoclastes !
Des millions d’e(r)go iconoclastes !
,
Les réactions engendrées par la tuerie des 7 et 9 janvier ont révélé malgré le grand concert général unitaire du 11 janvier combien un pays est fragile qui a accepté de se soumettre sans réserve depuis des décennies à des dirigeants qui n’ont eu de cesse de lui confisquer chaque jour un peu plus les choix qu’il pouvait faire, les décisions qu’il pouvait prendre et donc, l’exercice de sa puissance propre et de sa liberté. Agissant ainsi, ils ne font qu’imposer à l’ensemble de la société le geste dont ils sont les complices stipendiés, de voir leurs prérogatives réduites à l’enregistrement de décisions qu’au fond ils ne prennent pas.

Prisonniers d’une gouvernance par slogan et de guerres perpétrées en leur nom, les peuples européens n’ont cessé de renoncer aux libertés qu’ils désiraient prendre vis-à-vis de choix et de décisions qu’on leur imposait au nom d’une raison supérieure, qui, semblable à « la machine du monde » de Nicolas de Cues, « a pour ainsi dire son centre partout et sa circonférence nulle part ». Par la régression pascalienne dans l’univers métaphorique de la foi, la machine du monde est devenue, pour les croyants, un « deus absconditus », et pour les autres une puissance tyrannique aux masques changeants.
Abstraction humanisée pour les croyants, ce « dieu machine du monde » est devenu aujourd’hui pour tous, une nuée incernable composée d’organismes financiers et militaires et de leurs suppôts politiques, active partout et n’ayant son siège nulle part en particulier. Cette entité aux multiples visages dispose, entre autres choses, d’émetteurs fonctionnant jour et nuit. Le bruit de fond fait par la publication permanente de ses ordres directs, secrets ou liminaux n’empêche pas qu’on entende, parfois de très près, le bruit des armes qu’elle aime que d’autres utilisent en son nom, ici massivement et là, plus discrétionnairement.
Ergo
Tant de choses ont été dites ces derniers jours ! Il semble pourtant qu’aucun commentaire n’a été fait sur un aspect particulier de ce placardage quasi planétaire conduisant à la « répétition psittaciste » d’une formule qui mêle à la fois le fond religieux et le fond philosophique de notre culture dite occidentale : « je suis… ».
Il est inutile de revenir sur les différentes traductions du « ehyeh asher ehyeh » (Exode 3:14 a) comme de vouloir trancher entre « je suis qui je suis » et « je serai qui je serai » ou tout autre version. Non que cela soit sans importance mais comme le disait François Villon : « Et du surplus je me démets / Il n’appartient à moi pêcheur / Aux théologiens le remets / car c’est office de prêcheurs. (Testament, XXXVII)

Par contre, il peut se révéler fructueux d’essayer d’entendre dans cet affichage de masse d’un « je suis » moins une affirmation qu’une question, moins un témoignage de force qu’un aveu. Nous ne serions pas tant pleins d’être qu’en train de constater soudain l’existence en nous, autour de nous d’un véritable déficit ontologique. Ce déficit - pour ne pas dire cette dette, mais alors envers qui ? - se manifeste pourtant à travers un affichage de masse dans lequel, chacun étant devenu l’homme-sandwich de la marque anonyme dont il est le produit, chacun semble donc affirmer le contraire : une autosuffisance ontologique absolue.
Pourtant comment ne pas entendre ce « je suis… » transformé en slogan, autrement que comme l’aveu partagé d’une faiblesse et un appel désespéré ? Comme si le véritable enjeu de cette campagne publicitaire inédite était de faire comme s’il suffisait de descendre dans la rue pour que ce déficit soit comblé. Mais une fois acquis que chacun semble prêt à mettre la main à son porte-monnaie ontologique, nul ne semble se préoccuper de savoir qui serait susceptible d’encaisser les bénéfices du remboursement de cette dette.

L’aveu par déni de l’existence de ce manque si mal voilé par cette surabondance d’un unique slogan dessine sur le ciel planétaire un cercle vicié. Ce cercle figure l’ipséité malade d’une conscience à tendance planétaire n’ayant plus comme demeure de qu’un ergo, ce donc si nécessaire à l’affirmation, et ici aux aveux, comme en témoigne la formule célèbre de Descartes : cogito, ergo sum.
Doublet sensible du divin, doublet empirique du « monde », la conscience appréhendée sous la forme du « je pense » a été à la fois le vecteur d’une domination planétaire sans partage avant de se révéler être le creuset d’une impuissance fatale.
Il importe de signaler que « je pense donc je suis » apparaît la première fois en français, en 1637, dans Le discours de la méthode, avant de resurgir, en latin sous la forme « ergo sum, ergo cogito » en 1641 dans la deuxième des Méditations, et enfin en 1644, dans la première partie au chapitre 7 des Principes de la philosophie, sous la forme d’un : « ego cogito, ergo sum », dans cette phrase qui dit :« Cette pensée, je pense, donc j’existe, est la première et la plus certaine qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre. ».
Mais tout le monde ne conduit pas ses pensées par ordre ou, dit autrement, tout le monde ne parvient pas à penser philosophiquement.
Malin génie
Il importe donc de revenir un instant plus en détail sur la Méditation seconde, car la certitude affichée de pouvoir faire fond sur le lien indissoluble entre être et acte de penser est aujourd’hui, on ne peut l’oublier, mitée et affaiblie par les coups de dents et la salive acide du double négatif qui hante chaque individu comme son ombre et son propre fantôme : le malin génie.
Figure fantomatique vivant au cœur du sujet, le malin génie n’a qu’une seule fonction, mais elle est essentielle : tromper et donc, le tromper. Simplement, aujourd’hui, il semble que, assuré de sa puissance sur lui-même et sur le monde depuis quelques siècles, ce sujet pensant et sa projection interne rêvée qu’est une conscience se croyant délivrée du malheur d’exister, n’ont plus de raison de penser que pourrait vivre en lui, en eux, caché dans un coin, quelque entité qui serait susceptible de les tromper.
Chacun se croit être aussi imprenable que la forteresse du sens dont il assure être le gardien. C’est cette forteresse qu’il « est », qu’il nomme conscience. Il est elle. Elle est lui. Ils entonnent le même hymne : « je suis, j’existe », et ils vont ainsi, l’un dans l’autre, oublieux du fait qu’ait pu exister, un jour, une fiction aussi singulière que celle de ce malin génie.
« Mais moi qui suis-je, maintenant que je suppose qu’il y a quelqu’un qui est extrêmement puissant et, si je l’ose dire, malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper ? ». Tellement assurée d’elle-même, cette conscience semble avoir perdu le souvenir de cette autre question à laquelle le malin génie contraignait le sujet pensant à se confronter : « je suis, j’existe, cela est certain ; mais combien de temps ? »
Car, entre temps, l’époque est venue où le malin génie a pris les atours non d’une voix intérieure, mais des ordres et des informations contradictoires provenant du dehors. Paradant dans des discussions infinies censées permettre à chacun de s’orienter et conduisant pour l’essentiel à la réitération ad nauseam de gestes et de pensées stéréotypées, le malin génie nous indique qu’il est préférable de ne dire jamais non, ni vraiment oui, pour pouvoir continuer de choisir, un jour après l’autre, version devenue sacrée du bonheur, entre la cravate bleue et la cravate jaune, jusqu’à la fin des temps.
Le malin génie n’habite plus en nous, nous en sommes certains. À une telle fable nous ne pouvons plus croire. Quant à se demander « pour combien de temps ? », cela n’a plus de sens dans le monde magique de la promesse réalisée. Nous croyons notre forteresse imprenable puisqu’elle n’a plus besoin d’être prise. Nous ne remarquons pas qu’elle baigne en permanence dans la nuée des voix du dehors. Nous préférons croire qu’elles sont nôtres et qu’elles appartiennent de droit à notre conscience, ou qu’elles en sont la légitime manifestation, plutôt que d’être troublés à l’idée que le malin génie n’aurait jamais disparu et qu’il aurait seulement changé de forme, de formule et de format.
Et ainsi nous allons aveugles à, ou plutôt immunisés contre les effluves de ce qui se passe réellement autour de nous et en nous.
Voix
Ces voix qui nous parlent, elles nous donnent sinon des ordres, (oh non ça on ne le supporterait pas !), du moins des conseils, en permanence et sur tout. La tête plongée constamment dans des bassines de mots et d’idées que nous n’avons pas choisis et que nous ne pouvons absorber sous peine d’étouffer, il ne nous reste qu’à être contents de pouvoir respirer et de nous dire que respirer nous suffit. Cette certitude constitue notre « je suis, j’existe ». Grâce à ces mots venus d’ailleurs, nous sommes certains que nous vivons pleins d’être et que nous pensons.
Nous n’avons pas été en mesure de remarquer, de concevoir, de penser, que ces voix multiples et multipliées pouvaient être la forme qu’avait prise le malin génie pour poursuivre son œuvre et non seulement nous tromper aujourd’hui, mais étendre la tromperie jusqu’aux confins de l’univers.
Mais, dites-vous, il ne peut pas nous tromper, car il n’existe plus depuis longtemps ! Si tromperie il y a, c’est que nous nous trompons nous-mêmes et il ne tient qu’à nous de nous corriger. Et ces voix nous y aident. Elles apportent au moulin de notre conscience l’eau et le grain dont elle a besoin pour continuer à exister et à penser.

Et l’eau et le grain coulent, jour après jour, murmures infinis qui nous harcèlent agréablement et que, nous semble-t-il, nous pouvons critiquer aussi indéfiniment qu’elles nous apportent l’eau et le grain dont nous avons désormais besoin pour vivre.
Parmi ces voix qui nous harcèlent agréablement il y en a que nous ne pouvons contredire, celles dont les conseils et les ordres manifestes ou liminaux sont envoyés par des émetteurs qui se situent au-delà de toute saisie, de toute perception, de toute critique, les émetteurs comme les messages.
Mais cela nous ne le concevons pas autrement que comme une fiction aussi irréelle que vide de sens et nous retournons, Don Quichotte de pacotille, à nos moulins à vent.
Forteresse vide et réalité augmentée
Nous croyons être remplis d’être par les échos de nous-mêmes que nous renvoient ces voix indifférenciées. Et nous avons raison, nous sommes pleins d’elles, mais le petit ego de la fable, lui, qui surnage bon an mal an, sent bien qu’il se dissout sous les acides des assauts incessants. Il proteste, mais nul ne l’entend. Et d’ailleurs qu’importe qu’on l’entende puisque ce qu’il a à dire lui suffit à se nourrir indéfiniment, lui le bel Héautontimorouménos. Et que dit-il ? Souvenez-vous ! Baudelaire dit qu’il se châtie lui-même :
« Je suis la plaie et le couteau ! / Je suis le soufflet et la joue ! / Je suis les membres et la roue / Et la victime et le bourreau ! // Je suis de mon cœur le vampire / - Un de ces grands abandonnés / Au rire éternel condamnés / Et qui ne peuvent plus sourire ! »
Si la forteresse de la conscience n’était sinon vide, du moins en train de se vider sans fin, quel besoin y aurait-il, même et surtout face à l’angoisse, une angoisse augmentée comme l’est aujourd’hui la réalité, d’afficher sur papier glacé un « je suis » aussi strident ?
Si cette conscience n’était depuis longtemps vaincue, comment pourrait-elle ne pas voir qu’elle fonctionne comme le plus banal des perroquets, répétant ce qu’on lui susurre, ce qu’on lui fait entonner ?
Ce cri est littéralement muet, en tout cas silencieux. S’il résonne, c’est à la fois comme un aveu, un appel et une plainte. Ce qu’il dit ? « Remplis-moi d’être tant je suis vide ! Remplis-moi à n’importe quel prix ! »
La conscience accompagnée de son ego, avoue ainsi sur la place publique qu’elle n’en peut plus qu’ils ne fassent pas un, elle et lui. Alors, plutôt que de se demander de nouveau à quelle condition elle pourrait retrouver le chemin, non de l’unité mais de l’accord entre elle et lui, entre l’acte de penser et une certaine absence de tromperie, elle parade dans les rues de la désolation.

Au lieu de se demander quelle est la forme prise par le malin génie dans le cadre de la réalité augmentée, puisqu’il lui est consubstantiel ce malin génie, elle se choisit un ego de remplacement. Petit oiseau sans domicile fixe tombé sous des balles, elle le recueille et l’investit de son manque affectif, « croyant par de vils pleurs laver toutes ses taches ». Elle peut alors, mère devenue, une mère de substitution, mais cela lui suffit, afficher le moral d’acier des veuves.
Dans les rues de la misère affective, dire « je suis » suffit à calmer la douleur de la perte de son ego noyé par les atermoiements puisqu’on en a trouvé un autre, petit doublet empirique maquillé en doublet transcendantal.
Et qui osera aller lui dire qu’en ces instants, elle n’a jamais mieux montré comment elle s’y prenait pour se tromper elle-même ? Comment ? En affirmant le contraire de ce qu’elle est, puisqu’elle n’est rien sans son autre, et en barrant du noir du deuil l’aveu de son impuissance à s’accorder avec ce qu’elle aurait pu être.
Paradoxes iconoclastes
Un conflit, une lutte, un combat, parfois à mort - ils ne datent pas d’hier et traversent toutes les époques, toutes les philosophies, toutes les religions - se rejouent aujourd’hui. Nous en sommes les acteurs et les auteurs, les initiateurs et les cibles et, comme toujours, nous en serons les victimes héroïques parce que nous en sommes les hérauts apocryphes.
Le plus souvent, c’est à l’intérieur d’une même religion que les combats ont été les plus rudes, car les trois religions du livre sont fondées sur un primat du texte et sur une prévention plus ou moins marquée contre les images. Par image, on doit comprendre tout type de support permettant une représentation, fut-elle schématique, tri ou bi dimensionnelle, statues, peintures, icônes, dessins, pièces de monnaie, de divinités, de personnes divines ou saintes ou d’entités spirituelles, dont la fonction majeure, en tant qu’images, est de confirmer l’existence et d’assurer le bon fonctionnement du lien analogique entre le ciel et la terre. Acceptées ou refusées, légitimes ou interdites, les images ont été de tout temps utilisées, par tous les peuples concernés par les religions du livre, certes à des degrés divers mais de manière inévitable, car aucune de ces religions ne peut faire l’économie d’intermédiaires entre l’absolu invisible divin et le monde visible des humains.
Des livres, nombreux, montrent que les images, qui sont partout, ont encore et toujours un statut ambigu, si l’on s’accorde à considérer que le fondement de la foi dans les religions du livre est d’une part le livre, le texte donc, les mots, et cela en ce qu’ils sont seuls censés offrir à chacun, croyant, ego, sujet, conscience, individu, personne, selon le nom qu’on veut bien lui donner, un accès non médiatisé, entendons sans intermédiaire de type figural, sinon la parole des divers membres autorisés de chaque clergé, avec un dieu qui pour universel qu’il soit, est toujours aussi « personnel ».
Si les si mal nommées caricatures sont perçues avec tant d’évidence par certaines communautés ou personnes comme dangereuses ou blasphématoires, c’est que, dans l’imaginaire de ces croyants, elles jouent un rôle inadmissible, celui de messager négatif. C’est qu’il n’est étranger à aucune des religions du livre que les images soient des interfaces entre le divin et les humains. Pour tous, elles sont des émetteurs-récepteurs d’informations qu’elles font circuler dans les deux sens, du divin vers les hommes, en particulier dans le christianisme grâce au double statut du christ, divin et humain, mais aussi du monde des hommes vers le divin, qui omnipotent, comme on le sait, voit tout et n’est pas sans s’intéresser à sa création et à ses créatures. Ces images envoient donc vers le divin des informations que les hommes qui s’accordent à être en relation directe par les mots et la prière avec leur dieu, pensent irrecevables.
C’est un conflit d’essence qui se rejoue ici. Il est très proche de celui qui a traversé le christianisme dans ce que l’on a appelé la querelle iconoclaste ou dans celle, plus violente encore, qui a opposé catholiques et protestants.

C’est parce que nous avons appris à dissocier autant qu’à associer l’image et le divin, la personne ou l’abstraction divine et sa possible représentation, que nous pensons qu’il en va de même dans toutes les autres religions, cultures et civilisations. Et en un sens, nous avons raison, car c’est une question de moment historique, de situations politiques, de mise en avant étatique de telle ou telle question qui réveille ou endort le conflit imprescriptible entre texte et images, entre mots et visions.
Mais nous nous trompons en ceci que, fort de notre croyance en la validité universelle du schéma général de la conscience que nous tentons depuis quelques siècles d’imposer au monde, nous sommes devenus aveugles, aussi bien à notre propre histoire qu’au fait que d’autres puissent penser différemment de nous sans avoir plus ou moins tort ou raison. La conscience se révèle aujourd’hui être ce qu’elle a toujours été, structure d’attente et support de croyance.
Partant globalement des mêmes principes, ne les faisant varier que de quelques coefficients eux-mêmes variables, les religions du livre tentent d’accomplir l’une de leurs tâches qui est d’aider les humains à réguler leurs comportements sur terre. Pourtant, il semble que nous ne sommes pas en mesure de prendre acte du fait que notre modèle n’est pas le seul valide et encore moins de nous apercevoir que nous ne sommes plus les maîtres du monde.
Il est vrai que le vieil adage selon lequel qui n’est pas mon ami est mon ennemi ne cesse de hanter les esprits y compris la si bonne conscience et qu’elle ne sait plus à quel saint se vouer pour gérer cette « discrépance » entre ce que font les images et ce que disent les lèvres.
Déchiffrer
Nous croyons savoir ce que disent les mots et ce que font les images, et nous nous apercevons que nous n’avons pas les mêmes grilles de lectures que d’autres pour dire la signification d’objets pourtant identiques. Nous avons appris à dissocier l’image et le texte. Mais si personne ne les confond, nous sommes tous cependant sinon schizophrènes du moins « schizés » puisque nous tentons de tenir séparés la représentation par l’image de la représentation par les mots, l’accès au divin ou la possibilité de sa présence en nous par le biais de représentations visuelles ou par celui des mots que nous disons, entendons ou lisons.
Et au nom de la conscience, nous décrétons seulement qu’elle, notre conscience, c’est-à-dire en chacun de nous l’instance qui raconte et ordonne et pèse et choisit, n’est pas directement impliquée dans les effets que peuvent avoir images ou mots sur nos affects et l’engagement de notre acte de penser.

Nous sommes, nous disons-nous à nous-mêmes, des êtres suffisamment dissociés pour empêcher qu’une image ou un mot puisse parvenir à nous détruire. Cela n’est possible que si cette conscience se perçoit et donc si nous nous percevons comme une forteresse vide, dans laquelle entrent tous les vents et que gouverne finalement la voix la plus récente, la plus forte, ou la plus constante, parmi les voix du dehors. Au mieux donc, nous sommes devenus des techniciens du son mixant des voix qui viennent du dehors afin de pouvoir émettre « la sienne ».
C’est dans la manière que nous avons de relier les éléments signifiants entre eux que nous pensons contrôler leur impact sur nos affects. Nos affects dépendent largement de la manière dont nous concevons ces relations obscures mais puissantes et nécessaires. Nous ne nous distinguons donc pas d’autres groupes humains, qui ne font qu’à peu près la même chose, juste un peu autrement.
Comme le montre l’histoire du Filioque, un petit mot dans le corpus pourtant immense d’une doctrine peut conduire à un schisme, voire à une guerre.
Comme le montrent ces événements tragiques et dérisoires, mais aussi essentiels et déterminants, car surmédiatisés - ils parcourent le monde comme une onde destructrice - des images viennent se glisser entre des consciences supposées libres et l’instance qu’elles vénèrent, et ces images sont perçues comme renvoyant vers le divin des informations qui mettent en cause sa perfection, à lui le divin. Que des personnes soient affectées par cela, cela paraît à d’autres, impossible ou impensable. En tout cas cela ne semble pas, pour ces dernières, devoir affecter l’image qu’elles ont d’elles-mêmes en tant que consciences libres vivant dans un sujet libre.
Pourtant, et c’est sans doute la singularité de ces événements, c’est au moyen d’une proclamation textuelle que s’est traduit l’impact qu’a eu, dans tous les camps, l’usage d’images accompagnées de mots. Ces images-mots, à la fois allégories et symboles, ont conduit au recours à la violence et à l’extension de l’incompréhension, comme si parmi les peuples des religions du livre, chacun en revenait au fondement de sa foi. Et ceux qui semblent le plus éloignés des formes canoniques de la foi en ont fait une proclamation textuelle singulière à caractère ontologique portant un énoncé comme on le ferait d’une tablette de la loi.
Il y a trop de types d’images mises en œuvre ici pour que l’on puisse aisément décider de ce qui compte véritablement. Mais, si l’on s’en tient aux caricatures et à l’effet qu’a eu l’assassinat en leur nom de quelques personnes, au pays qui inventa la forme actuelle de l’état passant pour devoir être acceptée par tous les peuples de la terre, on constate que cette guerre des images aboutit à l’affirmation massive d’un iconoclasme partagé.
Ce sont les mots qui, en dernière instance, viennent rendre manifeste le sens de ce qui a lieu. Et ce qui a eu lieu conduit à une double révélation.
La première concerne la conscience qui découvre ce qu’elle est devenue : une forteresse vide qui demande, qui appelle, qui crie en silence et qui dit qu’elle veut être remplie, qu’elle veut que le vide qui la hante cesse de la hanter et qu’elle croit parvenir à le combler par un geste auto-érotique annulant le manque par une formule magique.
La seconde est la découverte de l’existence légitime de variations dans le mode d’existence de la relation entre soi et soi, comme entre soi et l’autre, que cet autre soit grand ou petit, humain ou divin.
La conscience est parvenue à cette révélation à travers le recours à la formule magique qui servit à la fonder. Il s’agit du « je suis », étant entendu que pour chacun, avec le « je suis » résonne dans le lointain de sa mémoire le « j’existe » et que le « pour combien de temps » n’a pas besoin d’être mentionné puisque cela fait désormais si longtemps justement qu’elle existe.
Elle découvre cependant en même temps que d’autres refusent ce « je suis » ou énoncent par son biais d’autres modalités d’existence. Elle s’en offusque, marquant par là le double aveuglement où elle se trouve piégée : vis-à-vis d’elle-même car si elle sait qu’elle parle, elle ne semble pas mesurer ce qu’elle dit à son propre sujet, et vis-à-vis d’autres qu’elle considère indignes tant qu’ils ne partagent pas son « credo ».
Reste à entendre ce que, écrit à la manière d’un énoncé des tables de la loi et donc prononcé dans son for intérieur, elle dit sans véritablement s’en rendre compte lorsqu’elle affuble son « je suis… » d’un prénom supplémentaire et commun.
On pourrait arguer qu’il y a dans ce prénom un « lie » si massif qu’elle avoue à elle-même ses propres mensonges ou reconnaît qu’elle sait qu’on lui ment.
On pourrait aussi comprendre un tel je « suis » comme un appel à suivisme en forme de déflagration d’un panurgisme à dimension nationale et internationale. Mais un tel aveu d’un désir de mourir, sinon de mort, ou d’un tel goût pour les sacrifices métaphoriques ne peut pas nous contraindre à participer à une telle mise en scène réglée par ceux dont la fonction est de tromper, de mentir et de faire se lever les uns contre les autres les moutons qu’ils retiennent en otage.
Il faut peut-être plutôt remarquer que ce qui est écrit à l’encre blanche sur fond noir n’est ni seulement un aveu, ni seulement un appel, mais bien une formule magique à visée apotropaïque, criante d’ambiguïté autant que d’ambivalence, et surtout l’énonciation sinon d’un ordre explicite du moins d’un conseil d’ami. Il ne faut guère forcer les lettres pour lire, sans vouloir se repaître d’un geste iconoclaste ou injurieux, ce que les lettres signalent : « JE SUIS : CHIER LÀ ! »
Mais il existe une autre oreille, capable, elle, d’entendre dans la réduction ad absurdum de cet aveu d’impuissance malade, la véritable question que personne ne semble en mesure d’accepter comme un programme de recherche et d’orientation de l’existence et de la pensée, et qu’en nous une voix discrète, insituable, sans origine connue mais indéniablement réelle continue de susurrer : « je suis : qui est là ? »