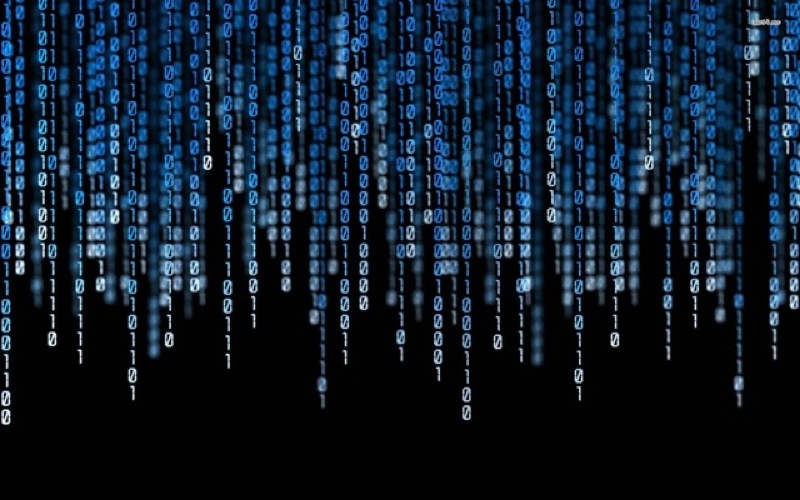
Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Vers la fin d’une spécificité - IV/V
Vers la fin d’une spécificité - IV/V
Conclusion (provisoire) - I/II
,
Ne pas nier notre plaisir ni le museler : glorifier le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion.
Charles Baudelaire
Le réel est moribond et l’imaginaire lui-même ne se porte pas bien, ai-je dit. Certes, mais le pessimisme n’étant pas dans ma nature, comme je le suggérais antérieurement, une autre forme de relation au réel est vraisemblablement en train de naître sur les ruines de l’ancienne qui n’a, par ailleurs, pas encore dit son dernier mot. On sait bien que ces mutations s’effectuent sur la « longue durée », que l’homme a des ressources innombrables, pourquoi n’en aurait-il pas contre ses propres tentations autodestructrices ? Des imaginaires nouveaux (ou renouvelés) se mettent en place sur un langage devenu différent et qu’on ne peut encore nommer mais, en tout cas, des attitudes se dessinent et qui ne vont pas forcément dans le sens que les apprentis sorciers du « village global » ou de l’« Organisation » semblaient espérer.
Les « autoroutes de l’information », le World Wide Web et autres minitels améliorés sont des outils, nous dit-on et d’abord les outils d’une nouvelle forme du pouvoir extrêmement dangereux, mais tellement fragiles et transparents (comme les pouvoirs eux-mêmes qu’ils servent, ils ont la particularité de s’exposer et de se remettre en cause d’eux-mêmes) qu’ils sont finalement à la merci d’un trop de transparence, de cette transparence qu’ils prônent par ailleurs. J’en veux pour preuve qu’il n’aura fallu que très peu de temps pour que des doutes apparaissent (très vite confirmés) sur le caractère prétendu ouvert et utopique de l’Internet pour que le contrôle universel des communications, la censure et l’univers marchand qui le motivent en réalité n’y apparaissent ouvertement. La fable, du moins chez nous, n’aura pas trompé grand monde et pas longtemps. Derrière toute utopie il y a toujours l’ordre forcé, fût-il subtilement diffus, et ils ont bonne mine aujourd’hui ceux qui chantaient l’avènement d’un monde nouveau et libre : les ex-hippies devenus informaticiens, mais toujours aussi nunuches dans le genre « peace and love » ! Il en va évidemment de même des prétendues réalités virtuelles mises au point pour l’armée et des jeux vidéo qui ne font que provoquer des réponses à des stimuli, quand bien même ils prétendraient à l’interactivité toujours programmée et dont les enfants, finalement, se lassent assez vite (d’où le besoin constant de renouvellement de ces jeux qui devrait bien rencontrer ses limites). Actuellement aux États-Unis, le chiffre d’affaires des « krafts », les « travaux de dame » : tapisserie, broderie, patchwork, crochet et autres macramés, a dépassé celui de toutes les cassettes de jeux confondues. Au Japon c’est le jeu de croquet qui bat toutes les consoles vidéo. Ils n’ont pas de quoi être fiers les accros de la bidouille ! Et sans être aveuglément optimiste, c’est tout de même réconfortant.
Cela dit, même vides, même nulles (et reconnues comme telles), les « images », pour le public, continuent à véhiculer leur manque patent de sens, donc à susciter son besoin, à démontrer sa nécessité. C’est ce que disent les vogues actuelles des « sciences » occultes et autres sectes qui font excellent ménage avec les technologies quand elles ne les suscitent pas. Je ne suis pas le seul à constater qu’au bout du compte, la « mondialisation », l’O.M.C., dont on peut ne retenir que le premier terme : l’« Organisation » et leurs prétendus outils de communication technologiques font parfaitement couche commune avec les superstitions les plus archaïques, les intégrismes de tous bords, les replis sur des mini-communautés closes et exacerbées et autres sectes délirantes et sont pour le moins objectivement complices dans leur même volonté de venir à bout de toutes les valeurs de notre vieux monde, à commencer par le respect de l’homme et par la plus fragile de toutes : la Démocratie. Mais aussi absurde qu’elle paraît c’est cette complicité même qui les dénonce en ce qu’elle suscite de besoin de réaction.

Aussi, même s’il convient de modifier notre regard, nos modes de réception et nos attentes, je ne commettrai pas l’erreur d’annoncer la mort prochaine de la photographie (qui n’est qu’une technique en pleine révolution mais l’image fixe, évidemment numérisée, ne me paraît pas en danger trop immédiat) et surtout pas celle d’un art photographique hybride, au contraire, plus vivant qu’il n’a jamais été, même si, déjà, c’est l’unification des arts de l’image au sein des techniques numériques qui est en train de l’emporter et, sans doute, à terme, la mort de l’image, du moins telle que nous la connaissions, en tant que représentation, qui me semble inéluctable, mais la fin de l’humanité aussi, après tout, même s’il n’y a pas urgence.
Je souhaiterais montrer, pour conclure, comment la création, qu’on l’appelle art ou ce que l’on veut (la « novlangue » va bien sûrement nous proposer quelque chose à la place d’artiste, le terme plasticien semblant déjà dépassé : un ignoble « numéricien », peut-être ?), est non seulement nécessaire mais heureusement inévitable dans le monde qui se met en place. Comment elle peut être un moyen radical si ce n’est de pallier les horribles méfaits que j’ai longuement décrits devant vous – ce qui ne serait qu’un moyen de faire passer la pilule et chargerait les artistes d’un rôle de collaborateurs et de garde-fous comme il en est des arts dits appliqués – du moins de contribuer à un renouvellement de l’imaginaire et à une consolidation de son emprise avec les infinies variations humaines qui auront toujours raison, j’espère, des technocrates qui ont de plus en plus tendance à s’infiltrer partout, y compris dans nos écoles dites d’art dont les instances qui nous gouvernent s’efforcent insidieusement de faire la peau depuis déjà pas mal de temps.
On verra aussi, incidemment, comment, à travers une littérature de plus en plus abondante, la critique théorique, dans sa dimension sociale et esthétique peut rendre conscience à tout ce qui fuit ainsi sous nous. Comment elle peut, indépendante, en approfondissant la connaissance des mécanismes technologiques et mentaux, des mécanismes sémiologiques et esthétiques, accompagner, orienter cette mutation s’il apparaît que c’en soit effectivement une [1], comment elle peut en brouiller irréparablement les « stratégies fatales » et maintenir très haut les exigences éthiques qui ont toujours, de mémoire de civilisation, prévalu au cœur même de toute la création artistique ou non.

On feint parfois de considérer l’art comme une sorte de transcendance migratoire : « il s’agit d’un art qui se manifeste à travers la photographie, ou à travers le cinéma, dit-on, comme il se manifeste ailleurs, à travers les concepts, par exemple ». C’est vrai, d’une certaine façon, car les artistes et leurs marchands ont compris aujourd’hui qu’il leur fallait sortir du champ clos qu’on leur avait assigné et qu’ils avaient, nouveaux nomades, la possibilité de se saisir de tout le champ du visible, de l’audible et du sensible pour l’exalter, comme les médias s’en sont déjà saisis pour tenter de l’annuler, ou la finance pour l’exploiter. Aventure douteuse et particulièrement risquée mais riche, pour certains, de tous les possibles. Et non, pas tout à fait, d’une autre façon, car c’est bien la spécificité de la photographie (qui comme vous le savez n’en a aucune), cette polysémie, ce caractère d’imagerie instable et quantique, tellement contemporaine, et son aspect mécanique et communicable qui séduisent a contrario les nouveaux créateurs, comme les séduisent les possibilités de la vidéo numérique et du cinéma dit expérimental.
Depuis les années soixante-dix, les artistes plasticiens ont développé de nouveaux usages de divers médiums et de nouvelles réceptions possibles à travers des approches de la réalité plurielles et mouvantes et de sa figuration plus incertaine encore, néanmoins indéniables et crédibles. La photographie apparaît un peu et paradoxalement comme une irrécusable citation de réel, dont ils ne seraient pourtant pas dupes, un brevet d’authenticité et d’immédiateté, concepts moteurs aujourd’hui, mais authenticité et immédiateté de l’artefact même. Ce qui intéresse le créateur contemporain dans la photographie, c’est le jeu sur l’effet, cet effet de réel, d’intimité, de mobilité et de modernité indéniables qu’elle véhicule et qui servent de support au contenu de l’œuvre. Ce contenu peut même, dans certains cas extrêmes, consister en l’analyse ou le simple constat de ce rapport même. En un sens, le « toujours-déjà-vu » photographique dispense l’objet photographié d’être en devenant objet photographique, objet de la pensée et de la réflexion, objet du sens ou simplement sensé. Ce n’est pas forcément une position si aisée à tenir, même si la simplicité apparente du résultat ouvre évidemment la porte à tous les abus ou opérations de brouillages. Tout comme il peut consister à feindre de jouer le jeu des médias eux-mêmes et à les utiliser (faux reportages, fausses publicités, détournements divers, etc.)
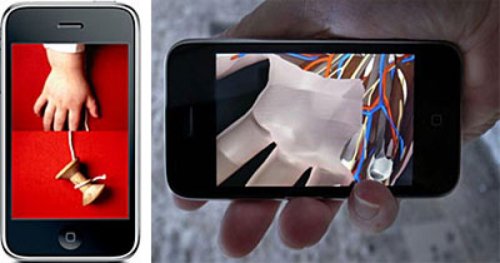
L’image optique permet une reconnaissance immédiate qui crée une complicité entre l’artiste et le récepteur quel que soit, par ailleurs, l’hermétisme de l’œuvre, ouvrant le chemin à une rencontre possible entre les multiples niveaux d’approches et de renvois.
C’est un concept vieux comme le monde moderne qui permet d’aborder cette pratique nouvelle de la photographie (mais aussi bien cinéma, etc.) : tenter d’analyser ou de montrer ce qui se passe entre la réalité et l’appréhension qu’en a l’artiste. Comment il la digère, la transforme (ou comment elle se transforme), quels que soient la forme et le statut du rendu. En fait, transposition à travers et par l’image d’un certain rapport social et du rapport au monde. C’est un des champs d’investigation, jusqu’à présent discret, qu’a ouvert en grand une mince frange de l’art contemporain qui, d’une façon ou d’une autre, n’a jamais cessé de s’interroger sur lui-même, en tant que rapport au monde, de se complaire à la mesure de l’écart (à scruter cette violence, évidemment sociale) entre réalité et mimésis, cette transformation du rien en support à communication intellectuelle et sensible. Comment l’idée de la réalité, dans sa déperdition plastique, devient langage où une société donnée peut se dire ? Passer d’une mise à jour du visible à un rendu lisible.
C’était déjà, faut-il le rappeler, l’une des interrogations fondamentales d’un Giotto ou d’un Piero della Francesca en leur temps et à leur façon.

Au moment où les médias confisquent la réalité et l’annulent, mêlant tout en un gigantesque spectacle, les plasticiens photographes, de Klauke à ses copains de l’école de Düsseldorf ou de Boltanski à Tromeur, les frères Starn (aussi médiatiques aient-ils été) ou Witkin, parallèlement, n’ont cessé de se pencher sur cette réalité même, sur ces invraisemblables rapports que nous entretenons avec elle. C’est Bayard lui-même qui, ayant inventé le moyen de mettre la réalité en boîte et en plan (et de ce fait, précisément, inventant la réalité même qui, jusqu’alors, en tant que concept n’avait pas lieu) et de la démultiplier, invente dans la foulée, un rapport différent, questionnant, conceptuel, à cette même réalité comme s’il avait senti le besoin de se faire pardonner et d’ouvrir une autre voie à ce qu’il pressentait peut-être comme un instrument majeur de déshumanisation.
Il y a déjà plus de vingt-cinq ans que ce « mouvement de la photoplastique », comme disent certains, chez nous, lié à ce qu’on a appelé la « Figuration narrative », existe parallèlement et mélangé à d’autres tendances éclatées et délocalisées. « L’ironie de la situation, dit Yves Michaud, est alors que l’autonomisation de la photographie comme médium spécifique la conduit à se fondre dans le mouvement général de l’art contemporain : ses ressources propres passent au service de l’inventivité formelle générale [2] ». C’est évidemment normal puisqu’il n’y a plus d’inventivité hors ce jeu de glissement des images après lequel tout le monde ou presque court.
Cela fait quelques années qu’après l’avoir longtemps passée sous silence et niée, la critique s’en est emparée pour le nommer, l’isoler, catégoriser, promouvoir quelques directions ou maîtres incontournables et, à égalité, inventer un grand nombre de mannequins sans consistance élevés au même niveau ou plus haut si possible, afin, comme toujours, de brouiller le jeu ; les effets de mode, les médias et de marché déboussolé faisant le reste.
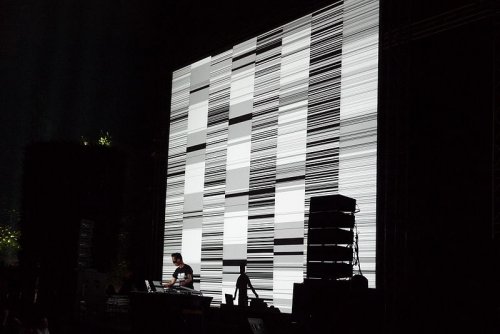
Il est raisonnable, de penser qu’aujourd’hui, en tant qu’épicycle, ce mouvement, a touché à sa fin depuis une bonne dizaine d’années. Après ou parallèlement à un « retour à l’ordre » officiel ou officieux dont on sent bien la franche instauration sous la forme d’un « post-photo-journalisme ou pseudo « vidéo-reportage conceptuel », faussement indépendants des médias (comme si nous n’avions pas déjà l’habitude de ces mouvements qui sont, en réalité, complètement dépendants des systèmes qu’ils prétendent mettre en cause), d’autres mouvements naissent et naîtront (ou le même sous une forme un peu différente, plus « fusion »), tout aussi hybrides, ou sans doute davantage, plus en rapport avec les nouvelles images proprement dites, de la vidéo numérique au multimédia, mais sur des fonctionnements encore inconnus, forcément différents de ceux actuels, balbutiants, et hybridant aussi les jeux de comportement entre science, art et politique comme un même ensemble tendant au dépassement des images qu’il n’est plus nécessaire de faire soi-même, les diverses banques en regorgeant.
Cela ne devrait pas pour autant annuler les autres médiums si on ne les interdit pas par voie autoritaire (suppression de la fabrication des matériaux et supports, par exemple), comme cela se produit actuellement en une sorte de course où chaque année voit disparaître, en photographie, papiers, films et chimies pour ne plus laisser bientôt disponible qu’un seul type de matériau, pauvre et ne permettant plus aucune variation. Certains, de plus en plus nombreux en sont venus à tenter de refabriquer eux-mêmes leurs papiers et chimies comme au bon vieux temps des pionniers et de l’artisanat militant. Recherches techniques longues et onéreuses, effectuées au détriment de la création et qui finissent, évidemment, par devenir un but stérile en soi (mais qui dira la beauté du concepts !). De la même façon, celui qui travaille seul à la maison en vidéo, fût-elle numérique, ne parviendra jamais à l’efficacité ni à la qualité du premier fabricateur professionnel venu, à moins d’y passer tout son temps et son travail ne sera pas pris en compte par les circuits de distribution ou de monstration (ce qui est peut-être un bien !). De toute façon, nous connaissons suffisamment le système pour ne pas être dupe : tout porte à croire, en réalité, que l’utilisation des technologies, pour accessibles qu’elles semblent actuellement, sera en fait de plus en plus coûteuse et, au bout du compte, forcément de plus en plus élitiste.
Je pense, et ça n’est pas du tout, de ma part, faire une concession, qu’il y a, entre autres, quelque chose d’extraordinaire à explorer et à détourner à partir de la photo numérique et des logiciels de retouche, tels que le faisaient, par exemple des artistes comme Nancy Burson ou Keith Cottingham, il y a quelques années, mais à la condition de conserver, à l’arrivée une matérialité et une richesse (fût-elle pauvreté volontaire) du support [3] ou de trouver une nouvelle matérialité. Quelque chose de tout à fait nouveau et totalement subversif puisqu’on peut générer et rendre visibles des images qu’on peut dire mentales, sans référent, et qui auront la structure testimoniale de la photographie, puisque, comme autrefois, plus aucune image, en apparence analogique, mais manipulée, ne sera fiable et crédible. Réellement et objectivement, le vrai sera instant du faux et vice-versa. Le référent sociétal y sera cruellement mis à nu.

C’est déjà un peu le cas avec la télévision où même le vrai n’apparaît plus vraisemblable et où tout ce qui apparaît sur l’écran est, d’une certaine façon, reçu comme fiction, ce qui, paradoxalement rend ce média encore plus coercitif. Cela n’a, évidemment, que la valeur d’un exemple.
Il y a là (et aussi dans les réseaux qu’on peut subvertir, infester de messages parasites, de virus créatifs et délirants, etc.) pour les créateurs et les artistes un champ fabuleux à investir et explorer si nous parvenons à nous en emparer au lieu de nous les laisser imposer sous condition par les chiens de garde du politique et les financiers aussi, sans doute, mais à cette différence que l’imaginaire n’est pas forcément de leur côté quand bien même quelques collabos trahiraient.
Espérons que notre nouvelle école [4], écrivais-je en 1996, saura devenir un de ces lieux de débordement créatif et de liberté, de résurgence du « mundus imaginalis ». C’est nous qui manierons et manipulerons la déréalisation de leur pseudo-réel dont ils se gargarisent comme d’une panacée. En fait, elle a failli, ses dirigeants et, sans doute, ses professeurs ayant préféré jouer le jeu du système en refusant toute réflexion et toute vraie création, d’où ma fuite éperdue dès 1997.
C’est pourquoi, malgré une vision qui s’efforce à la lucidité et qui n’est pas insouciante, je ne suis pas non plus pessimiste à moyen ou long terme. Une vieille confiance en l’homme et en son indéracinable faculté de dire NON, en sa faculté de créer et de subvertir, ce génétique besoin de fomenter des accidents pour survivre, rendront vite dérisoires toutes les tentatives de réductions binaires de la vie.
Les médias, c’est maintenant une évidence, sauf à se voir détourner, ne sont pas et ne seront jamais facteurs de liberté ou de démocratie. Ils en sont le leurre caricatural. Les télécommunications sont, paradoxalement, une clôture épouvantable aux effets pervers innombrables qui tuent la communication (si l’on conserve au mot son sens). Mais avec des difficultés, des reculs et des pertes de plus en plus considérables il est vrai, l’humanité n’a jamais cessé d’avancer vers une toujours plus grande vigilance et une toujours plus grande conscience (ce qui ne veut pas dire une plus grande efficacité).
Bien sûr, il faudra vraisemblablement un certain temps pour que les individus séparés et isolés dépassent le stade technologique et créent éventuellement de nouvelles formes d’organisation sociale et de nouvelles formes d’art pérennes (ou dont les effets le soient) à l’aide du numérique et qu’on arrive à retourner effectivement les « binary digit », ces fameux bits qui ne font qu’énoncer l’indigence et la vulgarité du propos qui les assume, cette « cinquième colonne » [5] d’un sur-fascisme yankee d’un nouveau genre [6]. De même qu’il faudra sans doute un long moment avant que le rêve démocratique – pris en otage et ridiculisé par la prétendue communication –, la politique, l’art et même la science (on commence à s’en apercevoir) vidés de leur sens et dépossédés par une apparente logique des marchés et des simulacres ne puissent retrouver une certaine réalité humaine et l’efficience qui fut la leur. Le principal obstacle est évidemment financier. Toutes les technologies (à un certain niveau d’efficience) sont hors de prix et donc parfaitement contrôlées (reste à savoir par qui, mais c’est tout vu), la culture naissante qui s’y rattache souterraine, mobile et, hors des lieux spécifiques (écoles ou centres où il faut montrer patte blanche), inaccessibles. Que penser d’un « art » contrôlé par l’économie ? D’une création sous condition de ressource ?
Photographies et nouvelles images, aussi dangereuses et intégrées qu’elles puissent être, constituent en attendant un réservoir de possibilités de vraie création et de jeux de contamination des images entre elles et il faudrait être criminellement inconscient pour les abandonner à d’autres mains que les nôtres. Les technocrates et leurs copains idéologues, consciemment ou inconsciemment techno-fascistes, peuvent bien installer avec le plus parfait cynisme tout un réseau de tuyaux et contrôler les flux, ils peuvent bien installer des centaines de chaînes de télévision thématiques et autres télévisions-kiosques prétendues interactives (je dirais plutôt interanesthésiques), jusqu’à tout noyer sous les effets visuels nommés abusivement « images », réduire le monde à ce qu’ils appellent un « village global » (et d’autres de Naples à Brooklyn, Belgrade ou Moscou, « la Famille ») et tout passer sous la loi du marché unique, en prétendant, non sans une certaine jouissance, que de gré ou de force, « au prix d’épreuves et de sacrifices, les êtres humains s’adapteront [7] ». La volonté de chacun de « voir quelque chose » dans ces prétendues « images » quand bien même il n’y a rien à y voir et qu’on s’en vante, est néanmoins des plus rassurantes. Paul Virilio en témoigne : « Les spectateurs ne fabriquent pas leurs images mentales à partir de ce qui leur est donné immédiatement à voir, mais à partir de leurs souvenirs, comme dans leur enfance, en remplissant eux-mêmes les blancs et leur tête avec des images qu’ils créent a posteriori » [8].

Images et littérature critique
Depuis le tout début des années quatre-vingt (publication de La Chambre Claire de Roland Barthes, puis début de la parution des Cahiers de la Photographie, des livres de Philippe Dubois, de Susan Sontag, etc.), on a vu s’instaurer un certain nombre de réflexions théoriques sur la photographie et parallèlement une réflexion dispersée et timide sur les nouvelles technologies qui commençait d’apparaître, réflexions vite interrompues. La photographie a été l’objet d’un assez grand nombre d’interrogations tout à fait diverses et sur des bases n’ayant que peu de rapport entre elles au point de passer aux yeux d’un grand nombre de gens encore nourris de culture traditionnelle, pour peu sérieuses et embrouillées.
Quel rapport, effectivement, entre les trois ouvrages habituellement considérés comme basiques : les trois « B », celui de Benjamin, celui de Bourdieu et celui de Barthes ? Vous l’avez constaté, chacun ne parle en fait, d’un point de vue totalement différent, que d’un certain type de photographie, celle qui lui est la plus familière à l’exception de toutes les autres, rejetées dans l’ombre puisque n’apportant pas d’arguments ou contraires à leur théorie. Les nombreux textes produits depuis observent la photographie toujours depuis leurs a priori, aussi généreux soient-ils, même en un certain sens Philippe Dubois ou Rosalind Krauss dont la réflexion est pourtant essentielle.
Je n’échappe évidemment pas à la règle, et même la revendique, puisque je n’ai traité, ici, finalement que des possibilités ou impossibilités de création avec la photographie tout en avouant d’emblée que ce n’est pas du tout pour ça qu’elle est faite. Ma réflexion est donc tout à fait marginale. On m’accordera néanmoins que j’ai cherché dans le même temps, peut-être et même sûrement en apportant des réponses évidemment partielles et, sans aucun doute, partiales, à comprendre effectivement ce pourquoi elle serait faite [9] Ces réponses sont paradoxalement en désaccord avec mes souhaits les plus profonds. Je suis conscient, toutefois, qu’il en est de nombreuses autres possibles, que j’aurais pu aussi prendre à mon compte. Cela ne relève pas d’une incertitude et d’une ignorance mais, en fait, de la constatation évidente que toutes les réponses possibles sont des réponses probables, donc aussi valables que non valables et équivalentes en fonction des circonstances et qu’il peut y avoir autant de réponses que de photographies et de gens qui les voient. L’expérience ici ne sert plus à rien, il suffit de simuler la question pour que la (une) réponse survienne.
Il n’y a de réponse, évidemment, que parcellaire, fragmentaire et distincte à un objet lui-même parcellaire, fragmentaire et totalement divers. Et il en va de même pour tout ce qu’on peut dire sur les « nouvelles technologies ». À objet quantique, réponses quantiques. Les bits ne sauraient être objets de la valeur. Ils sont, pour l’instant le véhicule même de la déculturation, si l’on accepte la culture comme mouvement vers une unité reconnue comme telle (à condition, sans doute, de ne jamais l’atteindre puisque c’en serait la disparition, l’important étant le mouvement même).

J’ai décrit, au départ (1er volume) et rapidement, quatre approches, quatre blocs d’occurrences à la fois successifs et simultanés par lesquels aborder les photographies, occurrences elles-mêmes, aux contours des plus flous et fluctuants, j’en suis tout à fait conscient. C’est là une façon arbitraire d’éclairer le terrain. Mais ne serait-ce que dans les exemples que j’ai donnés à propos des divers objets habituellement traversés par la photo dite « créative », il était évident que de nombreuses autres approches étaient possibles. Les miennes, même si efficientes par rapport à mon discours, n’en sont que quelques-unes parmi d’autres, pouvant se modifier en fonction de leur objet ou du prétexte d’étude de cet objet. Ainsi, pour citer quelques-uns de mes récents travaux d’écriture, mon approche de la photographie orientaliste est-elle différente de celle que j’ai pu faire à propos de Marcel Bovis ou des approches multiples dont je me sers actuellement pour travailler sur les photographies françaises des années vingt et trente ou du début du siècle, même si, fondamentalement, mon point de vue personnel demeure le même. Ce qui n’est peut-être pas sûr. Peut-être ces déplacements éventuels mériteraient-ils d’être étudiés pour eux-mêmes.
D’une autre façon, et je crois l’avoir montré en référant à divers reprises aux autres images, traditionnelles ou nouvelles, une approche de la photographie seule est, désormais, inenvisageable : il y a une indissociable pluralité de l’image aujourd’hui. D’une certaine façon tout est « image » et cette image est l’enjeu politique et économique mondial et prioritaire. D’où le nombre assez étonnant d’ouvrages et d’articles qui paraissent actuellement sur ce sujet. Mais tous, aussi intelligents et passionnants qu’ils soient, n’abordent l’image, au mieux que comme un faisceau de singuliers ou un ensemble tellement flou que s’y mêlent, évidemment sous le même vocable, images traditionnelles et technologiques, symboliques et indicielles, mentales et littéraires, peinture, photo et cinéma, etc. Brassage [10] fascinant, souvent intelligent et éminemment justifiable d’où l’on ne saurait, toutefois, tirer aucune réponse satisfaisante à cette question fondamentale, grave et désespérée : « que faire aujourd’hui avec l’image ? »
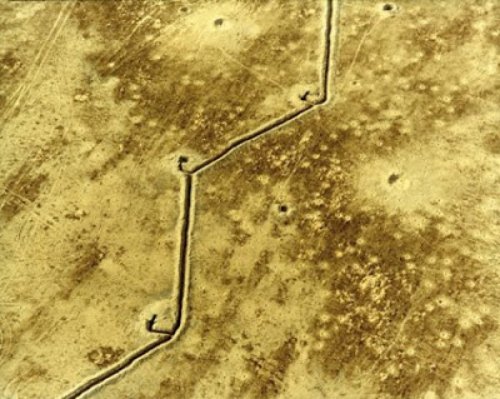
C’était évidemment la question à ne pas poser, mais ce n’est pas nous qui l’avons posée, on nous l’a imposée avec l’envahissement des pseudo-images, des médias et la trop flagrante boulimie américano-mondialiste dont les causes ne sont évidemment pas qu’économiques. Nous sommes, dans cet établissement, bien placés pour nous en rendre compte et c’est, évidemment, la question fondamentale qui traverse la plus grande part de vos travaux, qu’ils soient photographiques, de vidéo ou d’animation, voire d’imagerie traditionnelle.
C’est pourquoi l’analyse critique, à partir de la photographie et de la photographie même, en tant que modèle de fonctionnement, me paraît essentielle aujourd’hui. Puisque celle-ci a pour caractéristique d’exporter sur les instruments théoriques qui sont en charge de l’analyser, son propre mode de fonctionnement, un peu comme si l’on jugeait un criminel du point de vue de l’utilisation qu’il a faite du couteau ou du revolver. À ceci près que les instruments de la photographie, eux, sont innombrables et, séparés et distincts (quantiques), ne sauraient être appréhendés comme système.
Ce dérapage est visible et lui, analysable. C’est le mode de fonctionnement des appareils, de tous les types d’appareils, tel que nous les avons abordés à propos des programmes de production et de diffusion : l’évidente confusion entre le véhicule et le voyage. Tout appareil est manipulatoire et hégémonique [11].
Notes
[1] En fait depuis la naissance de la photographie, le matériel des images techniques n’a cessé d’évoluer et à une cadence relativement rapide, jamais il ne s’est fixé, frappé d’obsolescence tous les vingt ou trente ans et il s’est toujours métissé avec ce que lui offrait l’industrie vers toujours plus de simplification d’emploi, fût-ce au prix d’une sophistication de plus en plus grande, voire énorme, en amont : la belle utopie, tout de même inquiétante en ce qu’elle met en jeu, de l’image pour tous ! En ce sens, la « révolution numérique », pour nous n’en est pas une, ce ne sont pas les outils qui sont essentiels, avons-nous dit, mais ce qu’on a à dire, à montrer, à faire sentir avec, quand bien même les rhétoriques de création et de monstration en seraient-elles affectées. Toutefois il est évident que l’envahissement des pseudo-images dans toutes les sphères humaines, la disparition du temps (le temps réel) et le fait de ramener toute activité à des jeux d’algorithmes, transforment profondément notre civilisation, même si elles n’affectent que superficiellement et techniquement nos pratiques de l’image désormais unifiables (photo, vidéo, cinéma, animation pouvant ainsi s’enrichir directement l’une de l’autre). (Note de novembre 1999).
[2] Yves Michaud, opus cité.
[3] On peut même imaginer, si l’on veut vraiment considérer comme obsolètes les vieilles techniques photographiques, que les technologies nouvelles puissent aussi servir à améliorer, rendre plus riches ou renouveler les supports en question, rendre l’information effectivement solidaire du support et non plus seulement déposée, etc. Mais il ne saurait y avoir d’art sans matériau et sans matière. La forme naît de la résistance de la matière à l’information. Il ne saurait y avoir d’ « art conceptuel » si ce n’est sous forme d’une simple étiquette. Mais les logiciels opposent des résistances, parfois fortes, et il y a une matière, fût-elle immatérielle, dans le numérique. Le matériau numérique pour être encore un de ces collages à la mode, existe bien dans son infinie fragilité et le faire, en un sens, exploser n’est pas un jeu vain même si cela ne saurait suffire et combler le besoin d’une « vraie » matérialité, d’un rapport physique à la création (et aussi à la pérennisation car, si le message n’est en rien altéré par la copie, tous les nouveaux supports sont, eux, très rapidement dégradables, à la même vitesse ou presque que l’obsolescence des systèmes qui les permettent. Sans doute, là encore, n’est-ce pas innocent que cette menace de violence prévisible, désormais permanente, sur l’œuvre et son éphémérité probable, la perte programmée de toute trace dont déjà, par exemple, nombre de vidéos des années soixante-dix sont victimes. Les bandes terriblement dégradées existent encore, pour certaines, mais il n’y a plus de matériel capable de les lire. – Ajout, novembre 1999 –)
[4] L’EESATI.
[5] Cf. Alain Woodrow : Quatrième pouvoir ou cinquième colonne. Paris, Éditions du félin, 1996.
[6] Qu’on ne croit pas que j’exagère, déjà l’Amérique s’est dotée des moyens surpuissants, via tout un maillage de satellites, de surveiller la totalité du monde, au décimètre près, mais elle peut aussi contrôler la totalité des images et des informations diffusées sur les divers réseaux existants : hertziens ou via l’Internet (Googlehearth). Par ailleurs, tous les systèmes permettant de produire ou de diffuser les images technologiques sont évidemment américains. Aujourd’hui, l’image est américaine ou n’est pas.
[7] M. Raymond Barre, cité par Le Monde Diplomatique, janvier 1996, p. 10.
[8] Paul Virilio : La Machine de vision. Paris, Galilée, 1988.
[9] À l’instant (13 octobre 1996) où je terminai la première mise au point de ces textes, je viens d’entendre sur la 5e chaîne de télévision le physicien Jean-Marc Levy-Leblond expliquer, en forme de boutade, que « l’inquiétant avec les technologies c’est que si on arrive à peu près à savoir pourquoi ça ne marche pas, on ne sait jamais pourquoi ça marche. »
[10] L’inverse est également évident : traiter l’image du seul point de vue des photographies, convoquerait-on de multiples sciences et théories à son étude, a prouvé depuis longtemps son inefficacité. Ce fut l’échec des Cahiers de la Photographie et de certains théoriciens qui en sont issus de François Soulages à Gilles Mora.
[11] Après la guerre du Golfe et celle du Kosovo, je ne puis, à ce propos, que renvoyer aux divers ouvrages et articles de Paul Virilio.
