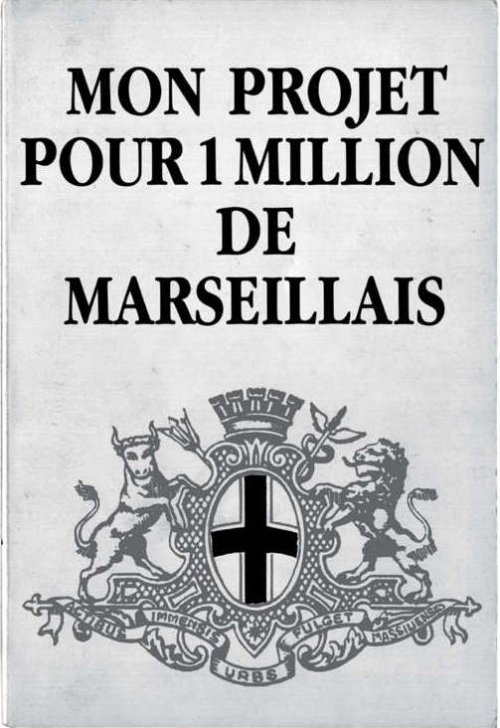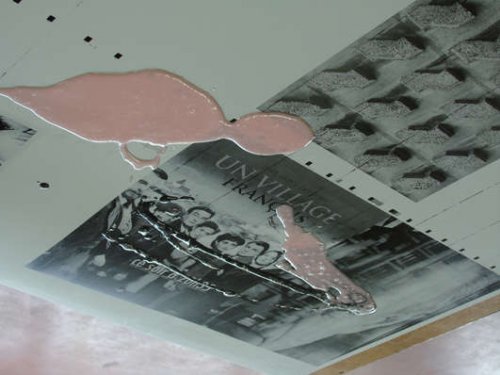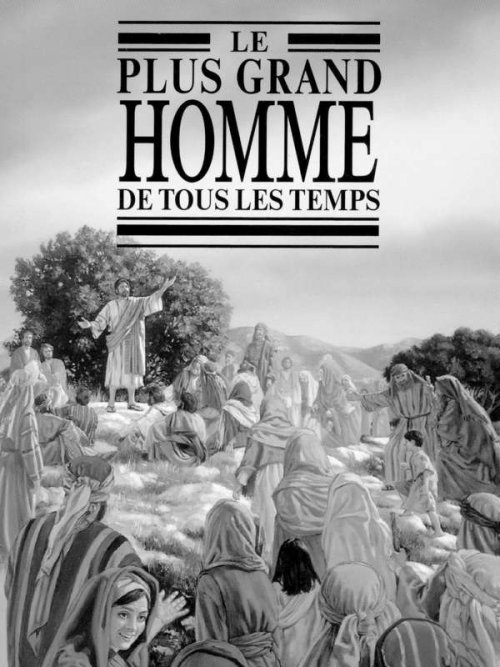Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Informer en « état » d’urgence
Informer en « état » d’urgence
la revue fondcommun
,
En ligne, sur papier éclairée par l’écran, éclairée par le soleil, mobilisant les doigts qui cliquent, attirant la main qui balaie, irradiant ses volts, épuisant ses noirs, ses blancs, ses gris, deux pratiques de la revue se croisent ici, celle qui insiste et creuse le papier et celle qui déplie les pages en autant de présences volages à l’écran. Mais toujours face à nous le déploiement des images, des mots, des césures, des plis. Le corps simplement est positionné différemment.
Ils se présentent ainsi à fondcommun : « fondcommun est un organe de presse problématique, une espèce “hors-norme” de journal — entre la revue d’artistes et le gratuit urbain. Il se constitue de faits qui formalisent, dans l’espace de la page imprimée, des problèmes. Intempestifs, hétérogènes et partagés, actuels et anachroniques, bruts et sophistiqués, ces faits sont produits par des personnes engagées dans des processus de création — la création étant pour nous un moyen, pas un but. Ils sont choisis d’un commun accord avec la rédaction. »
Dans les faits, on a entre les mains des hautes pages en noir et blanc, des images pleine page et des textes déployés en questions à tendance irrecevable ou fragmentés jusqu’à l’énigme. Et d’images en mots, de mots en phrases, aveux ou questions se mettent à voyager, satellites incertains, heurtant-ci, déchirant-là, le mur des évidences et du sens commun.
Ici, le commun s’oppose au commun, le sens au signe, l’évidence au cliché, l’affirmation au doute, le jeu au jeu.
Dans le numéro zéro un deux on peut lire : « On confond souvent collectif et commun, prenant l’un pour l’autre. Par exemple, il existe des collectifs d’achats, de vente, de cinéma, de musique ; on parle aussi de travail collectif, d’action collective, de valeur collective, pour désigner diverses manières de se coordonner les uns aux autres. Cependant le mot commun conviendrait mieux. Pourquoi cela ? Pour la raison que “collectif” à proprement parler, est un mot qui désigne une “collection” d’individus qui ne sont pas nécessairement en contact et qui,s’ils le sont, le sont tous de la même manière ; tandis que “commun” qualifie ce qui résulte d’une mise en contact entre des gens qui, pour entrer en relation les uns avec les autres, n’en perdent pas pour autant leur personnalité et souvent, au contraire, tirent de leur union avec d’autres une dose supplémentaire d’individualité. »
Un programme ? Peut-être. Une orientation en tout cas !
Ainsi de page en page, se déploie un réseau d’images et de mots qui scindent les évidences en autant de possibilité de jeu et les affirmations en autant de questions orientées. Mais orientées vers quoi ? Ou pointant dans quelle direction ?
Dans toutes les directions, puisque c’est le geste même de prétendre savoir qui est ici mis entre parenthèses. Pourtant, quelques lignes apparaissent, en pointillés comme le montre la page première du numéro capitale et chaque ligne est en fait l’extension d’un point et chaque point une épine dans le pied de la réalité.
« Nous affirmons qu’in-former, c’est d’abord produire une forme. Cette forme cherche de nouveaux usages en dehors de ceux institués par les mondes de l’art, de la politique, du commerce, du spectacle, de la finance et des médias. »
Ainsi se poursuit leur présentation générale, indiquant donc qu’ici on ne croit pas, en tout cas pas dans les vertus supposées de la vérité marchande et de ses divers suppôts.
Par contre, donc, les pages nous mettent en passant le nez sur l’inferno simple dans lequel nous errons, sans pourtant nous perdre, argumentant qu’ici ou là, encore, il existe quelque chose qui s’appelle encore et toujours des situations.
À la page 27 du numéro zéro un deux, des cartes qui semblent de visite promettent des rencontres en s’étalant en phrases-questions et lancent des appels au jeu en une vision chinois-anglais-français du monde, portant des mots qui rappellent les heures perdues d’une jeunesse qui ne passe pas : « Agencer l’improbable / Poser la question / Fall gracefully / Mettre le hasard de son côté / Commencer par le milieu / … »
Chaque page semble avoir pour objectif de se mettre à ajourner le temps ou du moins de combattre la croyance que nous développons dans l’idée de temps, sans doute la plus énorme tromperie inventée par les tenanciers du grand bordel de la marchandise.
Dans le même numéro, on peut lire, poème arrimé à l’inconstance de l’oubli : « Ajourne toute chose. On ne doit jamais faire aujourd’hui ce qu’on peut aussi bien négliger de faire demain. Il n’est même pas besoin de faire quoi que ce soit, ni aujourd’hui, ni demain. Ne pense jamais à ce que tu vas faire. Ne le fais pas. »
Comment ne pas entendre là un écho au « ne travaillez jamais » qui fleurit, tracé à la craie, en 1953 sur un mur de la rue de Seine ?
Dans le numéro Il n’y a que des disparitions, coordonné par Stéphane Lemercier, ce n’est pas seulement un hommage à Perec qui se dessine mais une question lancinante, celle de savoir comment s’entretenir avec ce qui fait défaut, l’autre, le mort, la page raturée, le mot manquant ou la lettre volée. Parce que le passé est trop encombrant pour ne pas dire qu’il leste d’une ombre incommensurable le cheval avant qu’il n’entre dans le champ de bataille, condamnant ainsi et la bête et son cavalier à s’effacer dans la boue.
Mais on n’efface jamais tout, on ne détruit jamais tout, on n’emporte jamais tout dans la mort, on laisse parfois malgré soi sans doute avec son image mortuaire, un mot de billet, une veste ou simplement un blanc un peut trop blanc entre deux phrases incomplètes.
À la page 27 du numéro Il n’y a que des disparitions, on peut lire : « Où peut donc se trouver l’écriture du futur quand on ne connaît que celle du passé à l’aube dans un livre fluide de verbes, d’adjectifs, de conjonctions et de mots à peine solaires où tout prolonge un monde qui n’est plus dans ma mémoire languide de sommeil et de phrases torrentielles, une main écrit les mots qui séparent définitivement le jour de son immense passé de nuits sauvages et d’ombres. »
Oui le monde est peuplé d’ombres, même si de peuple on n’en voit que le souvenir dans les yeux de quelques rêveurs et d’ombre on n’en voit que sur les murs des villes. Pourtant, c’est entre ombre et absence que se trament ces pages qui n’ont de cesse de réveiller quelque chose noir comme un fondcommun.
Ils poursuivent ainsi leur présentation : « fondcommun veut s’immiscer dans des lieux de vie quotidienne où l’on est amené à attendre, à prendre, perdre son temps — comme les cafés, bars, les salles d’attente médicales, chez des particuliers, les espaces de lecture, les services publics et privés. Nous voulons concrétiser un réseau de diffusion, dont les protocoles sont le prêt, la consultation, la reproduction et la circulation. »
Et en effet, on s’y promène dans ces lieux de vie mais par le prisme d’images si noires et si blanches qu’on sait qu’on est, là, tout entier plongé dans le souvenir sans auteur qui trame notre mémoire commune si bien recouverte par les oripeaux des rêves qui se vendent.
On sait les débuts et la suite et de la suite, on sait le suspens qui préside à chaque respiration entre deux moments de la fuite. Parce que traquer l’absence au cœur du monde réel ne signifie pas qu’il faille s’en tenir là et laisser la place, toute la place aux fossoyeurs du brillant cosmétique.
La fin pour laquelle ils publient, ils la disent donc ainsi : « Nous cherchons à travailler des approches problématiques de notre monde : pointer les problèmes, les problématiser en leur donnant une complexité par une formalisation la plus concise et exacte possible. Ce dont on ne peut ou ne veut parler, il ne faut pas le taire, mais essayer de l’écrire, le voir, le dire. Rendre lisible et visible ce qui fait problème aujourd’hui, c’est pour nous chercher à susciter des paroles et des actions publique : comment pourrait-on construire et partager un fond commun ? Nous voulons mettre en branle cette recherche opératoire et collective. »
On se souviendra alors, ici et maintenant, de cette phrase de Montaigne, (Essais, III, 2, « Du repentir ») : « Le monde n’est qu’une branloire pérenne : toutes choses y branlent sans cesse, la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte, et du branle public, et du leur. La constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant. »
Et l’on se balancera sur l’escarpolette du temps qui ne passe pas, croyant voir bailler sous les froufrous l’origine sinon du monde du moins d’un battement de paupières.
Ainsi, chaque page se révèle-t-elle pour ce qu’elle est au-delà comme en-deçà de ce qu’elle prétend être : une mise au point. En voici deux, glanées encore dans le numéro Il n’y que des disparitions, à la page 55 : « dehors ou dedans, idem » et à la page 35 « La pellicule est solarisée sur le denier plan. »
Simplement nul ne sait qui le verra ce dernier plan, ni si bien sûr, mis à part le soleil disparaissant, il y aura qui ou quoi pour regarder voir.
Parution : bi-annuelle • mille cinq cent exemplaires • minimum de 28 pages au format 240 x 320 mm avec reliure titre • fondateurs : Vincent Bonnet et David Bouvard • mise en œuvre commune et collective (avec les artistes) • coordination générale : Vincent Bonnet (07 77 05 07 29)