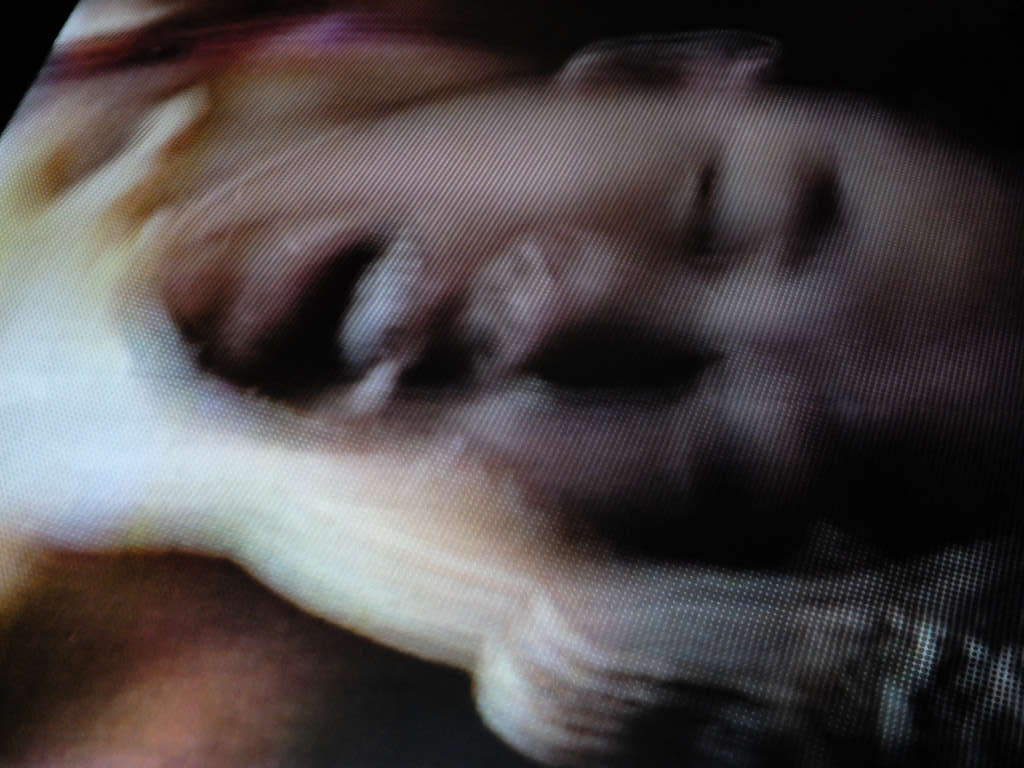
Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Biennales
Biennales
Quelques remarques sur notre relation au monde
,
Toutes les versions de cet article : [English] [français]
Corée 2014 : deux villes, Gwangju et Busan, deux biennales et deux titres qui sont comme l’envers l’un de l’autre. À Gwangju, le titre est "Burning down the house". À Busan, le titre est "Inhabiting the world".
À Gwangju, on propose de brûler l’endroit où l’on est censé habiter pour dégager un espace qui permettrait à la pensée et la création de se déployer, l’acte de destruction étant le prélude à un renouveau. On suppose donc que le monde est inhospitalier et qu’il faut sacrifier la maison, c’est-à-dire le territoire du quotidien et de la sécurité, pour retrouver le monde, supposé habitable donc. Mais quel monde ? La biennale ne nous le dit pas sinon qu’elle présuppose qu’il est possible de le sauver (mais de quoi ? de la destruction ?) et de « se » sauver, au moins par l’art.
« Burning down the house examines this potential of art as movement by exploring the efforts made by contemporary artists to address personal and public issues through individual and collective engagement, as well as demonstrating how challenging these efforts and their impact have become » writes Jessica Morgan in her introduction in the catalog.
À Busan, on suppose que le monde est suffisamment rassurant pour qu’il soit possible encore de l’habiter. On ne passe pas par la case destruction, mais on dégage les formes positives qui l’ont rendu habitable et qui, continuant à être actives, font que ce monde persiste à l’être, habitable. Ces « figures » présentées comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde, ont pour nom : movement, the cosmos and the sky, architecture and object’s mobility, identities represented, history and war, animal’s dialogue, nature and witness.
Dans les deux cas, on maintient la croyance dans le projet moderniste. Cette foi est, dans un cas, censée jaillir d’une catharsis ignée, et dans l’autre émerger d’une lecture synthétique, positive et raisonnable des figures constitutives du monde. Il faut donc supposer que notre foi en ce monde est largement mise à mal par l’état du monde, mais cela on ne le dit pas directement. Cette foi qui serait donc en danger, on nous dit qu’elle peut soit renaître de ses cendres, si elle accepte de se jeter au feu, soit reparaître rajeunie après un lifting, si elle accepte la chirurgie esthétique.
Crise et attente
La question qui se pose, tant aux artistes qu’aux critiques, est de savoir comment se positionner pour créer et ce qu’il importe aujourd’hui de créer.
En effet, cela ne va pas de soi. Pour deux raisons principales. La première, c’est que nous vivons dans un monde dit globalisé dont l’ordre encore difficilement perceptible ne répond en tout cas plus au modèle hérité de la modernité. La seconde raison, c’est que nous sommes réellement désorientés. Pour nous rassurer et dans l’espoir de retrouver une forme ou une autre d’orientation, nous sommes en permanence à la fois en quête de racines, tournés vers le passé, et portés par l’espérance que quelque chose de nouveau, un miracle peut-être, pourra nous y aider, et alors nous sommes tournés vers l’avenir.
Cette situation, cette désorientation donc, n’est pas sans produire des effets sur le psychisme de chacun et sur celui des artistes en particulier.
Cette désorientation nous semble inconfortable. Elle est la forme actuelle que prend la crise. Dans cette crise, personne ne peut plus dire qu’il habite un seul monde. Chacun est contraint de convenir qu’il en habite au moins deux et, en fait, plusieurs. Ceci nous permet d’énoncer que notre situation réelle, c’est d’être en permanence « entre deux ».
Crise, contrairement à ce que l’on pense, est un mot positif, à condition de l’entendre comme le définit le grand philosophe des médias, Vilèm Flusser. Dans le chapitre intitulé « Lune » de son livre, Essais sur la nature et la culture, il évoque le fait que la lune est devenue un satellite appartenant à la NASA, alors que nous continuons à voir en elle « un satellite naturel de la terre : ma vision n’intègre pas ma connaissance. Cette absence d’intégration de la connaissance à la vision est caractéristique des situations déterminées que l’on appelle “crises”. » (op. cit., p.62)
Cette remarque nous est très utile, car elle nous indique que l’enjeu, celui auquel sont confrontés la pensée comme l’art, et au-delà toutes les formes de création, consiste à instaurer, rétablir ou transformer les liens ou les connexions entre connaissances et visions du monde. Il faut entendre ici les connexions entre les informations que nous offrent en particulier les sciences dures comme les sciences humaines et l’image acceptable d’un monde, acceptable également, que nous essayons de composer. Et la difficulté tient à ce que ce monde dans lequel nous vivons est non seulement difficile, violent, instable, mais aussi difficile à embrasser d’un seul regard.
Cette tension nous conduit à comprendre que ces choses évidentes ne sont que d’anciennes croyances. On pourrait aussi dire que ce sont des stéréotypes, ancrés en nous par l’usage singulier que nous faisons du langage ou, si l’on veut, des langages.
L’art, qui n’est autre qu’une sorte de tentative individuelle ou collective de comprendre ce qui a lieu en projetant sur le monde ce qui relève pour chacun de ses connaissances et de son besoin de s’orienter, l’art donc, se trouve aujourd’hui dans une position nouvelle. Il n’a plus pour fonction première de relier directement une proposition plastique, littéraire ou musicale, aux sensations, aux émotions et à partir du champ psycho-affectif, au beau voire au vrai, au champ intellectuel.
L’art est aujourd’hui essentiellement voué à cette tâche difficile mais grandiose de traduire ce qui est encore peu ou mal connu dans un vocabulaire qui serait mieux connu, ou si l’on veut, de conduire les formes connues de langage ou d’expression à se renouveler afin de pouvoir être à la hauteur de cet inconnu qui approche.
On peut ici évoquer l’œuvre magistrale d’anticipation visionnaire de Nam June Paik et en particulier Moon is the oldest TV ( 62-95).
Cette image de la lune est en fait une surface éclairée. Il est facile de faire le lien, à peine métaphorique, avec une projection. La surface de la lune nous plonge dans l’attente d’une image qui serait projetée sur une sorte d’écran suspendu dans le noir infini du ciel, comme dans une immense salle de cinéma. Pour Paik, la Lune est ainsi le « plus ancien téléviseur ».
La Lune est là depuis toujours, enfin presque. Mais on sait aussi que Paik pousse plus loin le refus des divers paramètres attachés au média TV – transmission en direct, enregistrement, rediffusion, flot permanent de toutes sortes d’images – puisque les prétendues images des phases de la Lune n’existent pas en réalité. Les formes que l’on prend pour des croissants lunaires ont en fait été obtenues grâce à des aimants placés sur le tube cathodique. L’image de la Lune relève de notre faculté d’association, de notre système d’inférence. L’image sur ces écrans est nettement issue de notre imagination, même si elle s’appuie sur un phénomène lié au média TV. La télévision devient alors la transcription dans notre monde d’une forme originaire, qui existait bien avant que l’homme ne puisse la regarder, comme phénomène naturel, comme image ou comme satellite de la NASA.
Il faut ici évoquer en écho le dernier film du cinéaste Jean-Luc Godard, dont le titre à lui seul est un programme très ambitieux mais très ambigu, Adieu au langage. Ce qu’il pointe ce sont les écueils, les poches de résistances, les lieux de frottement entre mots et images, repérables parfois à de minuscules trous noirs ou à des éclairs électriques inattendus.
Car ce qui constitue l’enjeu ou l’un des enjeux majeurs et que ni l’une ni l’autre de ces biennales n’interroge, c’est le statut, la fonction, les effets des images devenues dominantes tant sur notre vision du monde que sur nos modes de pensée et sur notre psychisme. La véritable question est donc de savoir si habiter le monde ne se dit plus du tout sur le mode de la croyance moderniste en la puissance salvatrice de l’art et du langage, mais sous la forme schizée, radicale, fluide et insaisissable portée par les images, par le flux des images qui à la fois défait le monde ancien, reconfigure notre perception et instaure un monde nouveau.
Habiter le monde suppose une conscience qui le pense et le rende habitable. Cette conscience est obsolète. Une autre forme de pensée est en train d’émerger. Habiter le monde, c’est en même temps tenter de la décrire et tenter par-là même de dessiner un peu de la nouvelle carte du monde.
Schize et désinhibition
Peter Sloterdijk, dans un texte resté célèbre, « Règles pour le parc humain », a défini notre situation d’une manière simple : « Deux mille cinq cents ans après la période où écrivit Platon, on dirait que non seulement les dieux mais aussi les sages, se sont retirés, nous laissant seuls avec notre absence de savoir et nos demi-connaissances en toutes choses. » (op. cit., Éd. Mille et une nuits, p.51). Ceci est à la fois précis et vague. Le véritable enjeu est en fait la saisie de notre situation existentielle à partir des éléments les plus récents de nos connaissances. Et, paradoxalement, cela nous renvoie aussi à notre préhistoire. Sloterdijk remarque en effet dans ce texte que « l’on pourrait aller jusqu’à désigner l’être humain comme une créature qui a échoué dans son être animal et son demeurer animal. En échouant comme animal, la créature indéterminée est précipitée hors de son environnement et acquiert ainsi le monde, au sens ontologique. » (op. cit., p.32).
Mais cette acquisition ontologique n’est pas sans réserver des surprises. La principale est que toutes cultures confondues et donc toute croyance en la toute puissance de la modernité enfin « bue », on doit accepter de regarder en face notre situation qui est la suivante : « Dans la culture contemporaine aussi s’accomplit le combat titanesque entre les impulsions qui apprivoisent et celles qui bestialisent, et leurs médias respectifs » (op. cit., p.43).
Et ce partage est mis en place et activé aujourd’hui à la fois techniquement, ontologiquement et psychiquement par les images.
En fait, nous habitons le monde « à travers » ce que nous en permet de percevoir un média dominant. Si auparavant on le faisait à travers les mots et les récits - c’est sur eux que notre foi moderniste se fonde - nous le faisons aujourd’hui principalement à travers les images. C’est cette nouvelle donne, ce nouveau médium et ses effets qu’il faut prendre en compte.
Ce médium détermine à la fois la zone de conflit entre impulsions qui apprivoisent et celles qui bestialisent, les modalités du partage, car les mots n’ont pas disparu mais leur statut a changé, et la forme de la crise, cette schize qui traverse notre cerveau, et le divise à nouveau, nous renvoyant à un état qui sous certains aspects ressemblerait à celui qui était le nôtre avant l’invention de l’écriture.
La schize est à entendre en un sens positif, délié de son ancrage dans le champ psychiatrique. La schize, c’est l’état de notre cerveau aujourd’hui, l’état de notre pensée divisée à la manière dont est divisé le monde. Il nous faut donc inventer une nouvelle manière de penser ce qui arrive et ce qui nous arrive. La schize est à la fois une source de tension et la forme centrale de l’invention.
La critique doit prendre en charge la crise comme étant une manifestation de la schize, et l’art lui, doit prendre en charge la schize comme expression de la crise. L’art multiplie les lignes de schize, là où la critique les repère et tente de leur conférer sinon un ordre, du moins une forme, une figure, une lisibilité articulant affects et percepts.
Cette approche positive de la schize nous conduit à comprendre qu’elle se manifeste à la fois comme une faille profonde entre deux mondes inconciliables, et comme un réseau de fêlures. La schize ne croît pas, elle se multiplie. Autrement dit la schize est la signature du double et du multiple dans un univers que certains persistent à croire toujours « monothéiste ».
Images et mutation psychique
Les médiums ne s’annulent pas, ils s’accumulent, se déposent les uns sur les autres, bougent à l’intérieur des strates, passent entre elles, se défont, se recomposent, se transforment, mutent et nous entraînent, nous qui en sommes à la fois les auteurs, les récepteurs et les « fonctionnaires » au sens que Vilèm Flusser donne à ce terme, dans leurs mutations.
Il y a ce qui est ancien, ce qui semble nouveau, ce qui revient et rétroagit sur ce qui est actuel, ce qui est abandonné, ce qui ressurgit d’un passé lointain. Oui, la situation est complexe. Penser, c’est plonger dans la complexité. En tout cas, c’est s’interdire des simplifications abusives au prétexte que la complexité serait trop complexe et donc impensable. Mais c’est aussi savoir appréhender la complexité à partir de synthèses efficaces. Sinon, comme c’est le cas en général, on se contente de ressasser de vieilles chansons, des chansons sur l’être, sur le sujet, sur le monde, sur la raison, sur les images, sur les mots, de vieilles chansons qui repeignent un peu les murs, mais ne touchent pas à l’agencement des éléments qui s’y trouvent exposés, à leur mise en scène.
Occupons-nous un instant du mot image, de la chose image, de la complexité qui nous explose au visage et nous effraye, que contiennent et le mot et la chose, pour parler la langue du siècle passé.
Il y a au moins six sortes d’images qui ne relèvent pas toutes du même champ, de la même strate. Par exemple, les images, au temps de Platon, ne sont pas les mêmes que celles d’aujourd’hui. Mais on ne peut nier que sous un certain angle, elles les prolongent, mais aussi en dissemblent fondamentalement.
Donc, six types d’images, d’images matérielles. Car il y a aussi la question des images mentales que nous ne pourrons pas évoquer ici.
1. Il y a les images qui relèvent du trait, de l’ombre, du premier dessin, de la skiagraphia, du travail de la main, de la peinture. Elles disent, pour nous, l’écart entre un modèle, absolu mais absent, et une inscription inévitablement dégradée par rapport au modèle, puisque médiatisée par le corps et la matière.
2. Il y a les images chrétiennes. Elles sont nées des symboles et accompagnent les mots. Elles forment le cœur secret de la promesse, elles sont l’arme secrète de l’économie divine qui permet en effet, après la mort, le retour à une image redevenue lumière.
3. Il y a les images techniques qui relèvent d’un mélange savant des deux premières, mais qui, en leur adjoignant la chimie, et les dépassent et les conduisent ailleurs. On les nomme photographies. Elles ouvrent un nouveau registre à la parole mais ne cessent de venir buter sur le texte, invisible, qui les porte.
4. Il y a les images qui sont mises en mouvement en vue de retenir la leçon de l’histoire. Elles sont toujours portées par la puissance du langage. C’est le cinéma.
5. Il y a les images vidéo qui permettent de s’inclure dans le mouvement de ce qui se produit et donc de devenir des acteurs. Mais ces acteurs se révèlent vite être en fait des fantômes, ou au moins des doubles d’eux-mêmes dont ils regardent les frasques sur l’écran de leur télévision.
6. Il y a enfin les images des ordinateurs et des téléphones portables qui ne sont pas seulement des images vidéo. En effet elles jouent un rôle absolument nouveau, en ce qu’elles nous permettent essentiellement de nous orienter dans une réalité devenue trop complexe, trop multiple pour être appréhendée par un seul individu, pût-il se prétendre libre et conscient. Ces images servent donc à s’orienter, c’est-à-dire à se retrouver dans la cacophonie chaotique du monde, c’est-à-dire donc à l’habiter. Mais ces images gardent aussi en elles certains aspects et certaines fonctions des images des précédents niveaux, qu’elles ne cessent en même temps de réorganiser, sur lesquelles elles ne cessent de rétroagir, dont elles transforment en nous et pour nous le statut et la fonction.
Voilà en quelques mots, autour de la question des images, comment nous habitons le monde aujourd’hui. Elles sont toujours des versions dégradées d’un modèle inaccessible. Elles continuent toujours de faire vivre un peu de la promesse d’une résurrection. Elles nous montrent encore des fragments de beauté, choses vues immobilisées pour nous, offertes donc à notre contemplation. Elles rappellent à l’existence des êtres inanimés contents de retrouver la parole, mais effrayés par le mouvement et qui sont, en tant qu’images, perçus justement comme actifs, efficaces, réels et avec lesquels nous nous identifions. Entre ces fantômes et nous, nous apprenons lentement à concevoir qu’il n’y a pas de différence fondamentale, que nous sommes « et » l’un, « et » l’autre.
Mais ce que font surtout ces images, c’est de remettre en question le statut ontologique des images anciennes. Car leur effet principal, c’est de passer à travers tout, de tout couper en deux, de diviser en deux notre perception, de trancher dans notre cerveau au point de nous en rendre deux. Comment cela ? Parce que les images sont devenues les juges qui disent, à chaque instant, à chacun d’entre nous, ce qui est autorisé et donc quelles impulsions apprivoisent, et ce qui n’est pas, à ce moment, encore autorisé et donc quelles impulsions bestialisent. Elles divisent le cerveau en deux, et aussi en deux notre corps vivant, puisqu’il ne peut vivre sans son double devenu visible à chaque instant et présent partout dans ces images de lui ou qui parlent de lui parce qu’elles lui parlent.
Et alors ?
Et alors ? Justement, on se demandait ce que pouvait bien signifier « inhabiting the world » ou « burning down the house » ? Ce que l’on constate, c’est que ce n’est sans doute pas la bonne question, en tout cas pas la plus importante, la plus actuelle, la plus urgente.
Ce n’est pas la bonne question, parce qu’elle n’évoque pas ce que nous sommes devenus, en quoi nous nous sommes transformés, en quoi cela a fait muter notre vision du monde. Cette mutation tient en ceci que nous vivons en même temps ici, dans ce que l’on s’ingénie à croire être le seul véritable monde, et ailleurs. Cet ailleurs, c’est le monde que fait exister cette infinité d’images auxquelles nous devons avoir recours pour nous y orienter, que l’on croit réel et unique, et qui est devenu multiple.
Il est vrai que ces mondes, c’est nous qui les avons inventés. Ainsi, ce n’est pas seulement dans « ce » monde que les images nous aident à nous orienter, mais à vivre « entre » l’un et l’autre. Car c’est dans cet entre-deux, invisible souvent pour nous, que pour l’instant nous sommes un peu perdus.
C’est pourquoi nous devons repasser par la case de ces injonctions qui inhibent et qui désinhibent, que nous devons revenir à cette préhistoire de l’homme. Mais nous pouvons le faire munis cette fois d’instruments d’orientation extraordinairement poussés. Sans l’apprentissage de leur usage, dont le désapprentissage de la lecture, qui n’est qu’un effet connexe, nous ne pourrons aller nulle part. Nous perdrions alors et nous et le monde.
Les mots ont été démonétisés, même si nous nous en servons encore. Les images ont « désontologisé » l’existence. Sans « argent » et sans « être », nous sommes la proie des flammes qui ont envahi la maison, celle de notre corps-pensant. Mais nous ne pouvons le quitter, car cela reste toujours mourir. Pour vivre, il nous faut accepter d’être « face » à nous et « hors » de nous, plutôt qu’« en nous ».
Cette double extériorité est devenue notre demeure. Et c’est elle que nous devons connaître et désirer, apprendre et parvenir à « habiter ».
Cette conférence a été prononcée dans le cadre du Forum du 15 octobre 2014, événement de la biennale de Busan.










